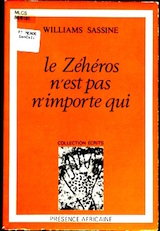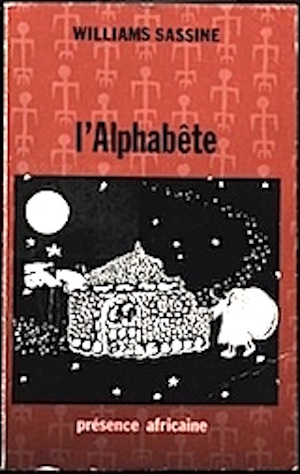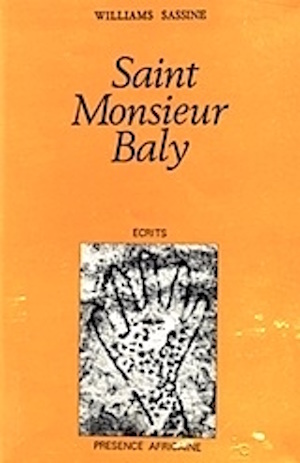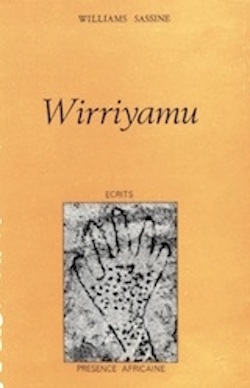Jacques Chevrier
Williams Sassine, écrivain de la marginalité
Editions du Cerf. Toronto. 1995. 335 pages. Collection L'un pour l'autre, n° 2
Chapitre Trois
L'Afrique des Indépendances :
Saint Monsieur Baly, Le Jeune Homme de sable
et Le Zéhéros n'est pas n'importe qui
Si l'on peut considérer que les phénomènes que décrit Sassine dans Wirriyamu constituent des anachronismes dans une Afrique s'éveillant à l'aube d'un jour nouveau, force est bien de constater que le tableau des indépendances que déroulent les trois autres romans, Saint Monsieur Baly, Le Jeune Homme de sable et Le Zéhéros n'est pas n'importe qui, ne nous entraîne pas dans un monde d'harmonie et de liberté. Une autre forme d'oppression plus insidieuse et plus révoltante nous y attend, engendrée cette fois par les nouveaux maîtres de l'Afrique. Comme le remarque en effet Bernard Dadier dans un texte publié en 1967 :
Qu'elles sont lourdes, lourdes les chaînes
Que le Nègre met aux pieds du Nègre 1.
Dans ces trois oeuvres, au demeurant assez disparates, le romancier s'est en effet attaché à décrire le fonctionnement impitoyable d'une machine répressive fondée sur l'ensemble des institutions dans lesquelles s'incarne le pouvoir — armée, police, propagande, bureaucratie, églises —, sans omettre évidemment le personnel politique et son chef divinisé, le « Guide »…
Le bilan qu'il dresse est lourd, violence, misère, corruption, terreur, avec pour conséquence un clivage dramatique entre, d'une part, les bourreaux, de l'autre les victimes, aux côtés desquelles Sassine se range sans hésiter. On retire même le sentiment que, dans un élan quasi apostolique, le narrateur s'identifie aux plus misérables et aux plus démunis d'entre les démunis de cette société féroce pour en faire les interprètes et les héros d'une quête désespérée.
Qu'on ne s'attende pas toutefois à trouver sous la plume du romancier guinéen ces fresques épiques et vengeresses qui ont fait la réputation de plus d'un écrivain de la première génération. Si, dans la comédie du pouvoir qu'il évoque, Sassine prend acte des injustices et des turpitudes du monde contemporain, il nous installe rarement in medias res [au milieu des choses], préférant le plus souvent à la description réaliste le détour par l'onirique, l'allégorie ou le mythe.
Une autre oppression
La trame de Wirriyamu, nous l'avons vu, est inextricablement mêlée à l'une de ces guerres coloniales résiduelles qui ont marqué la fin du glacis portugais en Afrique noire. L'essentiel de l'action de ce roman se déroule en effet au cours d'une période marquée par les affrontements sanglants qui ont opposé les différents mouvements de libération de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée-Bissau (MPLA, PAIGC, etc.) aux forces coloniales portugaises, d'ailleurs elles-mêmes divisées, on l'aura noté, sur le· sens de leur entreprise.
Toutefois, aux dernières pages du roman, dans la partie intitulée « Quelques mois après », nous nous trouvons brusquement projetés dans l'espace d'un camp d'entraînement qui préfigure la libération prochaine de la colonie portugaise servant de cadre à Wirriyamu. Ce camp n'est-il pas symboliquement coupé en deux par un petit sentier que les combattants ont baptisé « chemin de l'indépendance » ? D'ailleurs, au cours d'une conversation, les personnages évoquent le « prochain départ des troupes portugaises », tandis que Kabalango qui, avec le chien Patience, a miraculeusement échappé à la mort, n'en finit pas de ressasser les images de cauchemar du massacre de Wirriyamu. Transfiguré par le combat qu'il a mené aux côtés de guérilleros, il a composé un long poème à la mémoire des suppliciés du village martyr et, désormais serein, les poumons inexorablement rongés par la tuberculose, il attend une mort qui ne saurait tarder. Mais il était écrit que Kabalango ne mourrait pas dans son lit. Un soir, tandis que son médecin lui rend visite, en compagnie du « chef », un commando de tueurs surgit à l'improviste et abat Kabalango, sans doute par méprise.
« Les Portugais ne sont pas encore partis que déjà on commence à s'entretuer pour le pouvoir », constate, lucide et désabusé, le chef des guérilleros, faisant ainsi peser sur l'épilogue de Wirriyamu une note d'amertume qui laisse augurer des lendemains difficiles.
Sans doute est-ce parce qu'on ne se débarrasse pas de siècles d'humiliations et d'exploitation aussi facilement que « s'il s'agissait d'un fagot de bois », que l'Afrique des indépendances décrite par Sassine dans Saint Monsieur Baly, Le Jeune Homme de sable et Le Zéhéros n'est pas n'importe qui, n'échappe pas davantage à ce constat désabusé dressé à la clausule de Wirriyamu.
Le procès intenté aux régimes issus des indépendances nourrit une grande partie de la création romanesque africaine, depuis le célèbre roman d'Ahmadou Kourouma, Les Soleils des indépendances, publié en 1968. Qu'il s'agisse d'Henri Lopès avec Le Pleurer-Rire, de Tierno Monénembo, avec Les Crapauds-brousse, d'Alioum Fantouré avec Le Cercle des Tropiques et Le Récit du cirque de la vallée des morts, de Sony Labou Tansi avec La Vie et demie et L'État honteux, ou enfin de Tchicaya U Tam'Si avec Ces Fruits si doux de l'arbre à pain, pour nous limiter à ces quelques exemples, tous ces écrivains, contemporains de Williams Sassine, procèdent, chacun en fonction de sa sensibilité, à la dénonciation des régimes mis en place un peu partout en Afrique, après le départ du colonisateur.
Toutefois, si l'auteur de Wirriyamu inscrit chacun de ses récits dans un contexte politique, social, religieux et culturel parfaitement identifiable aux réalités africaines d'aujourd'hui, il n'accorde au fait politique proprement dit, et à ses acteurs, qu'un rôle second. On sent bien que là n'est pas l'intérêt du romancier qui nourrit, semble-t-il, peu d'illusions sur la capacité- et la volonté- des politiciens à faire le bonheur des hommes.
N'écrit-il pas, en exergue à son dernier roman — après avoir déjà placé la phrase dans la bouche d'un personnage du Jeune Homme de sable — « La confiance est un manque d'imagination, surtout en politique » !… Il ne faut donc pas s'attendre ici à ces mises en scène, tragiques, comiques, ou tragi-comiques, qui sont devenues en quelques années, il faut bien le dire, l'un des lieux communs du roman africain. Ce qui prime en effet chez Sassine — et nous aurons l'occasion de développer plus amplement ce point —, c'est l'homme, et nous dirions, plus précisément, l'individu dans son irréductible singularité. C'est autour de lui que tout se construit, a fortiori s'il s'agit d'un individu marginalisé par le destin, par la maladie ou par l'infirmité, etc., à moins que ses choix propres ne le placent délibérément en dehors de la norme généralement admise.
Dans ces conditions, l'oppression peut venir de partout, et en particulier, bien sûr, de l'appareil politico-administratif et juridique qui est la marque de quasi toutes les sociétés. Les trois romans que nous étudierons plus spécialement dans cette section se situent, pour deux d'entre-eux (Saint Monsieur Baly et Le Jeune Homme de sable), dans des pays qui ne sont jamais explicitement nommés, mais dans lesquels il ne doit pas être difficile de reconnaître des états de l'Afrique de l'Ouest situés dans la zone soudano-sahélienne. De nombreuses allusions et un certain nombre de détails climatiques, ethnographiques, voire politiques, permettent en effet de situer Saint Monsieur Baly dans un pays à dominante musulmane et dans une région frappée par la sécheresse. Mali ? Burkina-Faso ?
Avec Le Jeune Homme de sable, compte-tenu de l'importance du thème du désert, omniprésent et menaçant, on penserait davantage à un pays comme la Mauritanie ou le Niger 2.
En revanche, aucun doute en ce qui concerne Le Zéhéros n'est pas n'importe qui ; il est parfaitement clair que le héros, Camara, est un Guinéen vivant en exil dans un pays proche de son pays natal. A l'annonce du décès du « PDG », le président Sékou Touré, il décide de rentrer dans son pays et se rend successivement à Conakry, puis à Kankan, sa ville natale. Quand on connaît un tant soit peu la biographie de Sassine, on reconnaît là un parcours qui, sous le voile de la fiction, dissimule à peine l'itinéraire personnel du romancier, qui, après plus de vingt ans passés en exil, est effectivement rentré en Guinée au lendemain de la mort de son président.
La violence omniprésente
Quelle que soit la localisation des romans, réelle ou fictive, il n'en demeure pas moins que le monde qu'ils nous donnent à voir apparaît, dans tous les cas, profondément marqué par une violence qui s'inscrit la plupart du temps dans un cadre institutionnel, qu'il s'agisse de l'armée, de la police, de la bureaucratie ou des « prêtres », toutes religions confondues.
L'armée et la police
C'est sans doute parce que, dans bien des cas, les civils qui s'étaient emparés du pouvoir au lendemain des indépendances en ont été chassés par les militaires, à la suite de pronunciamentos, que l'armée semble l'un des principaux acteurs de l'oppression ou de la répression dont pâtissent les personnages mis en scène par Sassine.
A dire vrai, si l'on s'en tient au premier roman, dans l'ordre chronologique, Saint Monsieur Baly, il faut bien reconnaître que les allusions à caractère politique y sont assez peu nombreuses. Encore ne concernent-elles, la plupart du temps, que des rappels de la période coloniale antérieure, comme si les personnages traînaient derrière eux le souvenir gênant de fautes inavouables. Monsieur Baly ne rétorque-t-il pas au maire, qui lui reproche son comportement provocateur, « nous savons tous, dans cette ville, ce que vous faisiez au temps des colons 3 » ? Mais ici les règlements de compte s'effectuent de manière plutôt directe, chacun tirant vengeance de ses ennemis sans avoir recours à la force armée.
L'armée et la police, en revanche, sont beaucoup plus présentes et opérationnelles dans le roman intitulé Le Jeune Homme de sable. D'entrée de jeu, à travers la longue séquence onirique qui sert de prologue au récit de Sassine, nous devinons en effet, à certains détails, l'omniprésence d'un régime qui ne lésine pas sur les moyens pour conserver son pouvoir.
Le cauchemar que nous rapporte le narrateur évoque en effet à plusieurs reprises des« montagnes de cailloux » qui, dans l'esprit du dormeur, jouxtent « l'école ». Sur les treize pages que comporte ce chapitre d'introduction au roman, il n'y a pas moins de quatorze occurrences de la phrase sibylline « l'école est juste à côté des montagnes de cailloux » ; encore ce leitmotiv est-il redoublé aux trois dernières pages du chapitre. Si le lecteur ne dispose pour l'instant d'aucune information objective permettant d'éclairer le sens de cette phrase, le contexte, en revanche, ne laisse guère subsister d'équivoque.
Avec ce mélange déroutant d'étrange et de familier qui caractérise les rêves, le narrateur suggère, par certains détails, l'atmosphère d'un camp de détention où s'exercent des tortures. On y entend des « hurlements de suppliciés 4 », « des bruits d'abattoir, le claquement des fouets » (JHS, p. 20), on y côtoie des hommes et des femmes « nus ou misérablement vêtus », on y respire une « odeur écoeurante de sang » qui gicle et se répand dans des proportions hallucinantes : « La flaque de sang s'étale de plus en plus […]. [L]e sang monte aux genoux » (JHS, p. 18).
D'ailleurs, à bien y regarder, on s'aperçoit vite que les silhouettes se précisent et que les rôles respectifs de ces protagonistes de cauchemar ne tardent pas à se dessiner : d'un côté des bourreaux, de l'autre, des victimes. Ainsi croit-on comprendre que des tortionnaires s'acharnent sur plusieurs personnages aux contours flous : un vieil homme revêtu d'un grand boubou blanc et porteur d'amulettes, un mendiant, une femme… L'espace est celui, classique et stéréotypé, des lieux de torture, « une immense salle rectangulaire, inondée de lumière aveuglante » (JHS, p. 17). Là des corps sont ouverts, brisés, martyrisés :
On s'approche d'une femme. Ces hommes sont très nombreux. Ils tirent violemment ses cheveux. Elle se tait Seul son ventre ballonné, strié de longues gerçures, se contracte. Un homme s'approche avec un bâton et se penche sur elle. Des sanglots, puis un long cri asexué jaillit (JHS, p. 17).
Enfin, selon une logique onirique assez couramment observée, le narrateur lui-même participe à la scène, à la fois victime et témoin horrifié :
Et dans cette forêt de troncs humains que l'obscurité a taillée dans le même bloc, partout où je regarde, je ne rencontre que des formes vagues et inquiétantes dans leur sinistre similitude. J'essaie d'écarter un de mes barreaux humains : un bras me repousse à l'intérieur de ma cage et les corps se ressèrent (JHS, p. 16).
Des bribes de ce qui — nous le comprendrons plus tard — constitue son histoire personnelle se trouvent ainsi associées à des épisodes parfaitement hallucinés. Ainsi le narrateur est-il brutalement confronté avec « le corps décapité » de Tahirou, l'« ancien proviseur», tandis qu' « au fond de la salle se dresse un géant à épaisse crinière, sa main brandissant un énorme couteau» (JHS, p. 22) .
Sans entrer plus avant dans l'analyse de cette séquence d'ouverture, il faut noter qu'elle fonctionne comme un épitome de toutes les turpitudes post-coloniales qu'évoque Sassine dans Le Jeune Homme de sable, dans le temps même où elle prend valeur d'avertissement et de prémonition. Le romancier, on le remarque dans d'autres textes, nous installe rarement in medias res, préférant le plus souvent le détour par l'allégorie ou par le mythe.
Toujours est-il que plusieurs des visions de cauchemar entrevues dans le portique du roman seront confirmées et précisées dans la suite du roman. Ainsi le leitmotiv de « la montagne de cailloux » se trouve-t-il éclairé et explicité au cours d'une scène de la seconde partie intitulée « Le mouton », scène au cours de laquelle le député Abdou morigène son fils Oumarou pour ses prises de position et ses engagements révolutionnaires, et lui rappelle quelques-unes de ses incartades. Pendant que son père discourt, le héros se remémore, au cours d'un monologue intérieur, certaines des circonstances qui ont conduit à l'affrontement avec son père :
Au début de notre grève nous avons tous haussé les épaules. Mais deux jours plus tard, l'établissement était cerné par les militaires. Il nous traînèrent sur la grosse montagne de cailloux où nous restâmes assis quatre jours sous le soleil (JHS, p. 92).
Cet épisode de la grève sera à nouveau évoqué au cours de la conversation qui a lieu à l'hôpital, où le proviseur du lycée, Tahirou, a été transféré au sortir d'une captivité de huit années dans « la prison la plus abominable du pays », et où Oumarou est venu lui rendre visite :
Notre mouvement s'est rapidement étendu dans toutes les écoles. Alors le Guide a eu peur. On nous a tous arrêtés pour nous amener sur la grosse colline de cailloux. Et pendant quatre jours, personne n'a mangé ni bu. Chaque matin, on nous faisait asseoir en rangs sous le soleil, et jusqu'au crépuscule personne n'avait le droit de se lever (JHS, p. 103).
Ainsi, à mesure que progresse l'intrigue du roman, se dévoilent les circonstances qui ont conduit à l'explosion de violence dont les éléments épars et disparates hantaient le cauchemar d'Oumarou. Ce qui n'était, à l'origine, que fantasmes à valeur prémonitoire, prend peu à peu corps sous les yeux du lecteur. A la grève, qui a entraîné la déportation des élèves sur la montagne de cailloux, ont succédé d'autres sévices, autrement dramatiques. Nous apprenons, en particulier, qu'Ousmane, un camarade d'Oumarou, soupçonné à tort d'avoir rédigé un tract anti-gouvernemental, a été tué, et que la grève a été brisée. Les espoirs des lycéens se sont donc heurtés sans merci au pouvoir, symbolisé par le Guide — omniprésent à sa façon — et par ces « hommes casqués, farouches et muets », militaires ou policiers, peu importe, qui incarnent l'ordre.
Mais bientôt, c'est autour du héros que se resserre l'étau
de la répression et, peu de temps après la mort de son père, il est à son tour arrêté : « Le Guide en fait une affaire personnelle. Et ton père n'est plus là pour te sauver » (JHS, p. 142). Le cauchemar du prologue devient alors réalité.
Réalité carcérale banale, serait-on tenté d'écrire, tant elle ressemble aux descriptions véridiques et méticuleuses qui nous parviennent de ces trop nombreux pays, du Tiers monde et d'ailleurs, où la liberté et les droits de la personne sont quotidiennement bafoués et piétinés.
« Des hurlements de terreur et des bruits de course » (JHS, p. 140), telles sont les premières expressions et manifestations de la violence qui affectent le héros au moment même où, après avoir été « frappé, interrogé, insulté, humilié », il est jeté dans « un cachot pas plus grand qu'une niche de chien » (JHS, p. 140). Commence alors pour lui la lente découverte de cet univers secret et occulte que constitue le monde des prisons et des camps. Un monde ordonné, faussement rassurant, avec ses règlements, son personnel mensualisé, ses rituels, comme n'importe quelle société humaine. Mais également un monde fantastique, traversé d'« ombres dantesques » :
Des ombres se nouent dans un coin, y grossissent et se propagent jusqu'aux deux étages du bâtiment d'en face, à présent bordé d'hommes aux poignets liés, visages crispés dans la lugubre clarté des flambeaux (JHS, p. 155).
Dans ce décor infernal évoluent des silhouettes furtives
et diligentes, dignitaires du régime et leurs sbires engagés dans l'accomplissement de leur sinistre besogne. L'anonymat le plus total caractérise ces grands prêtres de la violence qui relèvent, tantôt des forces de sécurité, tantôt des services administratifs. A peine sont-ils évoqués par leur costume — « des hommes à casquettes » — ou leurs attributs, fouet, sifflet, machine à écrire, petit carnet, etc., sans que jamais accéder à une véritable identité.
Ainsi le tortionnaire-bureaucrate du prologue cauchemardesque n'est jamais désigné autrement que comme « l'homme-au-carnet », tandis que le commissaire, bien réel celui-là, qui mène l'enquête au sujet des activités d'Oumarou, nous est simplement désigné comme étant « l'Homme »…
La bureaucratie et le personnel politique
Si les représentants de l'armée et de la police sont délibérément traités par le romancier à la manière d'ombres chinoises, il n'en va plus tout à fait de même avec le personnel politique installé aux commandes de l'appareil de l'État et du Parti.
Le parti unique, dont on connaît l'importance et le poids dans toutes les dictatures, s'offre d'abord au regard par le rôle, en quelque sorte monumental, qui est le sien.
« Le grand bâtiment du Parti », nous est-il dit dès le prologue, jouxte « la grosse montagne de cailloux » ; plus tard, Oumarou contourne cet édifice en compagnie d'Hadiza, la troisième épouse de son père, et il en imagine « l'intérieur, tapissé de photos du Guide et de slogans, rempli de bancs avec, au centre, un flot de fraîcheur qui réduisait peu à peu l'étouffante chaleur de l'extérieur. Comme dans le cauchemar» (JHS, p. 31). Ce bâtiment, orgueilleuse représentation du pouvoir, est lui-même rehaussé, renforcé par une double emblématique — d'une part celle du soleil, d'autre part celle du lion — qui apparaît ici affectée d'un signe négatif et intimement liée aux forces du Mal :
« Devant l'entrée, flottait l'emblème du parti: un énorme soleil au-dessus d'un magnifique lion, prêt à bondir »
(JHS, p. 31).
Quant au personnel politique qui hante ces lieux, il ne vit, ne respire et n'agit qu'en fonction d'un personnage central, « le Guide », dont il sera question un peu plus tard. Autour de cette figure insaisissable et obsédante évoluent des personnages satellites placés dans la dépendance absolue de ce « roi-soleil ». Le système, commente le père d'Oumarou, « ressemble moins à un homme qu'à une pieuvre » (JHS, p. 51) ; le député Abdou parle en orfèvre, puisqu'il constitue lui-même la parfaite incarnation, non dépourvue toutefois d'épaisseur psychologique, de ces hommes d'appareil qui ne doivent leur existence qu'à leur appartenance et leur stricte inféodation au parti en place. A lui seul, il résume tous les excès et les vices du système : l'exercice sans partage du pouvoir, l'arbitraire, la corruption, l'hypocrisie, le cynisme… « Mon père est devenu de plus en plus important », observe Oumarou, pour aussitôt noter qu'il frappe régulièrement la vieille Fati, sa première épouse. Nous apprendrons un peu plus tard qu'en pleine période de sécheresse et de pénurie, il détourne à son profit les dons en céréales de l'aide internationale :
« Il se souvint de la remarque de Moctar : “est-ce que ton père vend toujours du mil ? » Oui, son père vendait le mil à distribuer aux pauvres. Comme tous les dignitaires du régime […] (JHS, p. 98).
Enfin, sous des allures de dévot, ce faux musulman boit de l'alcool, ce qui, d'ailleurs le perdra, puisqu'il consommera, par méprise, la bouteille de vin empoisonné que la seconde épouse d'Abdou, Mafory, destinait à Oumarou :
« Dès qu'il fut sorti, le jeune homme souleva le couvercle de la bouilloire. Ce qu'il sentit le fit sourire : du vin » (JHS, p. 98). Son secret ? « Apprendre à se ranger du côté de ceux qui gardent leurs dents intactes » (JHS, p. 87), comme il l'explique à son fils rebelle.
Le discours officiel
Ce dernier propos du député Abdou à son fils est évidemment réservé à l'usage domestique et il s'oppose radicalement au discours officiel, celui de la radio et des médias entièrement dévolu au culte de la personne et de l'action du « Guide ». Sous une forme à la fois fragmentaire et insidieuse, ce discours pénètre et imprègne la trame romanesque de toutes les oeuvres de Sassine ; il est présent dans le cauchemar d'Oumarou, tout comme il accompagne de ses formules stéréotypées les moindres épisodes de l'intrigue du jeune Homme de sable.
La séquence onirique sur laquelle s'ouvre le roman est en effet traversée et hachée par des bribes de slogans
détachés de tout contexte. On se souvient que le cauchemar qui agite Oumarou a pour cadre un lieu carcéral où des hommes et des femmes sont méthodiquement torturés.
Et dans cet enfer éclate de temps à autre une formule stéréotypée à la gloire du « Guide », sans qu'on sache qui la profère : « Vive notre Guide, le Lion du Désert », « Tous ceux qui ont foi en moi m'aideront à purifier notre beau et grand pays. »
Parfois la voix anonyme exaltant la grandeur du « Guide » est relayée au discours indirect : Le Guide a dit que pour la survie et la grandeur de notre cité, tout le monde doit se débarrasser de sa nature humaine et de toutes ses faiblesses, pour ressembler un peu plus chaque jour au Lion de notre invincible Parti […] (JHS, p. 16).
Mais la « langue de bois » du régime s'impose également sur les ondes de la radio, où les journalistes font preuve de la plus totale servilité à l'égard du régime. Ainsi en va-t-il lors de la proclamation du communiqué annonçant l'exclusion de certains élèves, au lendemain de la grève avortée :
On avait déclaré : « les élèves dont les noms suivent sont exclus jusqu'à nouvel ordre, en attendant que notre Guide bien-aimé décide de leur sort… » Comment traduire « nouvel ordre » sans inquiéter davantage ? Le speaker de la radio s'était cru obligé de commenter : « Il est temps de mettre de l'ordre dans notre pays. Il ne sera possible de le faire que quand les brebis galeuses, les élèves pervertis, etc. » (JHS, p. 17).
Mais la référence à la pensée et à la personne du « Guide » se fait encore plus explicite dans le dernier roman de Sassine, Le Zéhéros n'est pas n'importe qui, où le personnage directement visé n'est autre que le « PDG », l'ex-président Sékou Touré, bien connu, entre autres, pour ses discours-fleuves, soigneusement recueillis et publiés de son vivant dans ses Oeuvres complètes, elles aussi volumineuses.
Et puis il y avait le Livre blanc, L'Impérialisme et sa
cinquième colonne, longue et navrante litanie de suppliciés :
[ …] Je m'appelle Général Kéita Noumandian et j'avoue … et je demande pardon … je m'appelle Zoumanigui Kékoura, Emile Condé, Diop Alassane, Sagno Mamadi, Dr Diallo Abdoulaye … J'avoue. J'avoue. J'avoue. Je demande pardon. Pardon. Je suis récupérable. Récupérable. Récupérable… (JHS, p. 212).
Bien que la mort de Sékou Touré ait été annoncée officiellement — certains personnages du roman la jugeant toutefois improbable — la figure du tyran hante les survivants de ces vingt-cinq années de terreur. Le romancier évoque tour à tour les lettres de délation qui, dit-on, affluaient chaque jour à la présidence, les « télégrammes de soutien », enfin les formules stéréotypées par lesquelles étaient désignés les opposants au régime, comme Camara lui-même, poursuivi pour avoir revendu quelques paquets de cigarettes : « [J]'étais devenu aux yeux de la loi un ennemi-fossoyeur-de-l'économie » (JHS, p. 31).
Ce que semble vouloir nous dire Sassine dans ce roman, largement autobiographique, comme on l'a noté précédemment, c'est qu'un peuple se remet difficilement d'un quart de siècle d'un tel système.
Curieusement, en effet, ce qui survit dans la mémoire collective, c'est bien sûr le souvenir des atrocités commises par Sékou Touré, mais peut-être plus encore cette logomachie qui est la marque de toutes les tyrannies. « Les traîtres sont démasqués » avaient coutume de répéter les thuriféraires du régime, à chaque nouvelle vague d'arrestations et de pendaisons ; et maintenant que le tyran est mort, un autre automatisme verbal lui a succédé, « on est libres maintenant », qui traduit par sa réitération machinale, le plus souvent hors de propos, la survivance des peurs tapies au plus profond de l'individu, et que la parole aurait pour effet de conjurer.
« La vie, commente amèrement le héros, elle contient trop de douleurs pour des survivants» (JHS, p. 193).
La misère et le contre-pouvoir
Présente dans le discours officiel comme dans les atteintes aux plus élémentaires des droits de l'homme, la violence se manifeste également chez Sassine dans la condition qui est faite au peuple. A lire ses romans, et en particulier Le Jeune Homme de sable, on a très nettement l'impression que l'humanité des pays africains se compose de deux catégories rigoureusement distinctes , d'un côté les pauvres perpétuellement asservis, exploités et humiliés, de l'autre les nantis solidement agrippés à leurs privilèges de caste.
Aux premiers, victimes d'une injustice séculaire, tout ou presque est refusé. Bandia, le vieux serviteur du député Abdou, n'a pas le droit de bénéficier de l'eau courante, pourtant proche de sa case, et doit aller puiser, très loin, une eau rare et boueuse dans un puits à demi asséché.
La sécheresse qui frappe les hommes et les femmes de cette « cité vaincue par le soleil » et cernée par le désert, n'apparaît pourtant pas comme un phénomène inéluctable.
Cette sécheresse était prévisible, les moyens d'y pallier réels, et seuls, apparemment, l'incurie et l'égoïsme des dirigeants expliquent l'ampleur et la gravité de la catastrophe :
Cette sécheresse n'est pas tombée du ciel du jour au lendemain, commente le narrateur. Tout le monde l'a vu avancer, et tout le monde l'a laissé avancer.[…] Aujourd'hui on tire la sonnette d'alarme pour détourner la responsabilité vers les nuages parce que la colère des paysans affamés risque d'ébranler le pouvoir néo-colonialiste en place et de dépouiller les hauts fonctionnaires de leurs biens volés (JHS, p. 107).
La substitution des cultures commerciales aux cultures vivrières, sans parler de la spéculation sur les grains entreprise par les commerçants féodaux expliquent en effet, mieux que les carences d'un ciel désespérément vide, l'état misérable des paysans et des travailleurs réduits à la famine et à l'humiliation quotidiennes. À l'attente angoissée de ce peuple brisé, le pouvoir ne sait pourtant répondre que par un surcroît de répression et d'austérité. C'est au « Guide », véritable messager du malheur, qu'il revient, une fois de plus, d'annoncer « d'une voix un peu molle » les mesures destinées à aggraver l'injustice :
Je vous assure, chers compatriotes, que c'est la mort dans l'âme que je décide la suppression de la gratuité de l'enseignement et celle des soins médicaux dans les hôpitaux (JHS, p. 41).
Honte de la cité, l'hôpital où ont été transférés, en piteux état, les opposants au régime fait pourtant déjà figure de mouroir, tout au moins à « l'étage des pauvres » où un véritable spectacle dantesque s'offre au regard du visiteur :
La grosse femme traversait rapidement, dans un mouvement de dégoût et de crainte, le couloir jonché de crachats… Pendant qu'elle montait les escaliers qui conduisaient à l'étage des pauvres, à travers les barreaux de la porte de l'asile, deux bras implorants chargés du poids d'une voix accablée se tendirent vers elle… Elle l'entendait secouer les barreaux puis ricaner… La première fois qu'elle était venue, elle avait entendu un bruit de chute dans une chambre. Curieuse, elle était entrée : au milieu de quatre moribonds, un vieillard désespérément accroché au rebord de son lit luttait pour se relever… (JHS, p. 99).
Ce mépris de la vie humaine s'exprime au reste dans les faits et gestes les plus quotidiens de la vie de la cité. A cet égard, le moindre incident trahit le clivage entre riches et pauvres, comme dans cet accident de la circulation dont Ousmane est témoin : un chauffeur renverse un petit mendiant, contourne le corps inanimé, puis prend tranquillement la fuite, dans l'indifférence générale. Au policier venu s'enquérir des causes du rassemblement et demandant « que se passe-t-il ? », le héros, découragé par tant d'apathie devant la morgue des puissants, ne peut que répondre : «c e n'est rien… Quelle heure est-il Monsieur ? » (JHS, p. 44)·
Le renforcement de cette société à deux vitesses, où la misère côtoie l'opulence la plus ostentatoire, explique donc parfaitement le mécontentement qui s'empare d'une partie de la population et se traduit par un embryon de contre-pouvoir organisé par les syndicats et les lycéens en colère.
Aujourd'hui, observe un journaliste étranger évoquant le « Guide », il compte de plus en plus d'opposants qui lui reprochent un peu de tout : la faillite économique, la corruption des notables de son régime, le vol des deniers publics pratiquement autorisé, sa tyrannie, et j'en passe (JHS, p. 35).
Dans cette « cité affamée et assiégée par le désert » (JHS, p. 84), les opposants décident donc de passer à l'action et organisent grèves et défilés. Une pancarte, brandie en tête du cortège par Oumarou, proclame « Le gouvernement est contre les pauvres » (JHS, p. 85). La suite se laisse évidemment deviner : intervention des « hommes casqués », arrestations, fusillade, victimes, restauration de l'ordre…
En de telles conditions, il ne reste que l'action clandestine qui s'exprime tantôt par des opérations de commando dérisoires — les mottes de terre jetées sur l'ambassadeur au cours d'une cérémonie officielle — tantôt par la rédaction et la diffusion de tracts injurieux pour le pouvoir, comme celui-ci, qui vaudra d'ailleurs la mort à son auteur présumé, Ousmane :
Le militaire qui n'a pas de couilles
Pendant que le peuple fait ouille
Sous les coups de l'imposteur
Se cache de peur
De perdre ses faveurs…
Les militaires qui n'ont pas de couilles
Ne ressemblent qu'aux grenouilles.
Le jour comme la nuit
Ils fuient… (JHS, p. 57-58).
La religion
Enfin, la religion et ceux qui la cautionnent constituent un facteur supplémentaire d'oppression. A bien des égards, l'ensemble de l'oeuvre romanesque de Sassine — à l'exception de son dernier texte, Le Zéhéros n'est pas n'importe qui — apparaît placée sous le signe de Dieu. Mais s'agit-il du Dieu des chrétiens, de celui des musulmans ou encore des dieux tutélaires de l'Afrique traditionnelle ?
La question, complexe, et à laquelle il n'est pas aisé d'apporter une réponse tranchée, sera abordée un peu plus loin dans le chapitre « Une tragédie africaine ». Pour lors, la religion, en tant que facteur d'oppression et de violence, s'incarne surtout dans l'institution cléricale à l'égard de laquelle le romancier ne nourrit pas une sympathie particulière, dans la mesure où elle lui semble le plus souvent synonyme de formalisme, d'hypocrisie, de charlatanisme et, à la limite, de superstition, parfois cruelle.
« Dans ce pays, l'Islam est mort. Il ne reste que des musulmans » (JHS, p. 111), déclare Oumarou, en réplique à son ami Tahirou, qui vient de lui expliquer que sa longue captivité dans le désert l'avait rapproché d'Allah. Si le retour de foi de l'ancien proviseur du lycée peut se comprendre par les dures conditions de sa détention, il est clair, en revanche, que la plupart des dignitaires du régime pratiquent la religion davantage par habitude que par conviction. Attachés à la routine du rituel, ils sont par exemple incapables de comprendre la démarche humanitaire de Baly, qu'ils s'emploient, au contraire, à contrarier par tous les moyens en leur possession.
Après lui avoir gravement nui en répandant à son sujet les pires calomnies, et en fomentant la grève des maîtres, ces hommes de pouvoir obtiennent finalement l'expulsion du vieil instituteur de la concession où il avait fini par construire son école pour les pauvres. « Accablés et résignés », les petits orphelins dont il demeure en quelque sorte le « papa », se retrouvent donc sur le pavé, livrés à nouveau à la rue et à la mendicité. Pour la plus grande joie des « bonnes gens » :
Les bonnes gens, en vérité, furent heureux de retrouver leurs pauvres, car depuis leur adoption par le vieil instituteur, notre ville avait pour ainsi dire perdu son âme et on devinait dans la mine inquiète de nos concitoyens une conscience agitée, que leur petite aumône quotidienne suffisait apparemment à apaiser (SMB, p. 177) 5
Quelques jours plus tard, Monsieur Baly, cet empêcheur de tourner en rond, sera même d'ailleurs menacé de lapidation au moment même où il longe la mosquée de la ville :
[D]es exclamations retentirent et toutes les têtes se tournèrent d'un seul coup vers la petite mosquée. Il se leva et le coeur battant, reprit sa marche le long d'un chemin de regards furieux. « C'est encore lui, il veut souiller notre mosquée. » Un enfant se baissa, ramassa une pierre […] (SMB, p. 185).
Dans ces conditions on comprend mieux l'éloignement du romancier à l'égard des religions — ici l'Islam — qui n'engendrent que haine et intolérance :
En vérité, déclare Monsieur Baly,la véritable révolution reste à faire : elle a déjà commencé dans un pays africain où on déchristianise les noms ; dans un autre pays, un jour, on les déislamisera ; après, il faudra aller plus loin en démolissant les églises,les mosquées et tous les temples et tous les autels (SMB, p. 160).
Propos musclés dont on retrouve un écho dans les « Cahiers » de Kabalango, le héros de Wirriyamu, et en particulier dans l'un de ses poèmes iconoclastes où il écrit :
Dès demain forme un syndicat
Avec les religieux qui se rasent le crâne
Avec les religieux qui portent la soutane
Avec les religieux qui luttent pour le bien
Avec les religieux qui luttent pour rien
Et ensemble, après avoir crié : À bas
Les églises, les temples et les mosquées
Plantez partout dans le ciel des piquets de grève
Pour mettre fin à tous les célestes rêves
De ceux… /[…] qui font pleurer (W, p. 92).
Mais les prêtres et les desservants des religions traditionnelles ne sont toutefois pas mieux traités par Sassine, puisque, souvent, eux aussi, participent à l'entreprise d'exploitation et de domination des plus démunis. C'est ce que nous voyons notamment dans le portrait que le romancier nous trace du vieux marabout Soriba, dans Saint Monsieur Baly, que le héros, sans méfiance, est venu consulter afin de connaître la signification d'un rêve. Entouré de ses instruments divinatoires, Coran, cauris, pots d'encre et peaux de prière, le vieux charlatan ne tarde guère à comprendre à quel genre de personnage il a affaire, et, sous le prétexte de posséder le pouvoir de multiplier — sous huitaine — les billets de banque, il se fait remettre les 125 000 francs d'économies que Baly destinait à la construction de son école… Naturellement, le délai fatidique une fois écoulé, il ne reste au vieil instituteur, trop crédule, que ses yeux pour pleurer l'irréparable perte de son magot et de ses illusions !
La dénonciation de la violence attachée à la religion se fait plus précise, et plus grave, avec l'épisode du sacrifice humain qui nous est rapporté dans Le Jeune Homme de sable. Elhadj Karamo, le chef de la sûreté, et Abdou, le député, père du héros, complotent contre le « Guide » en vue de l'évincer du pouvoir. Afin de rendre les forces occultes complices de leur projet criminel, ils vont, à leur tour, consulter un marabout qui leur fait comprendre que le succès de leur entreprise exige un sacrifice humain.
Tu sais que certains marabouts, explique Hadiza à Oumarou, ne travaillent qu'avec du sang humain, quand on veut une très grosse fortune ou une place importante (JHS, p. 122).
Enlevé nuitamment par un commando aux ordres de Karamo, le vieux Bandia, qui a été choisi comme victime, est donc livré au couteau du sacrificateur, « un homme enturbanné » qui promet à ses clients « dans quatre jours vos voeux seront réalisés » :
Il [Bandia] ne vit pas le signe qu'adressait Elhadj Karamo au groupe d'hommes. L'un d'eux le tira brusquement loin de la voiture. Surpris, il tenta de se débattre, mais deux autres lui saisirent les jambes pour le terrasser. Une longue silhouette enturbannée se pencha au-dessus de lui et il sentit sur sa gorge le contact froid et tranchant d'un couteau. Lorsque l'homme enturbanné pesa de toutes ses forces sur le couteau, avant de se laisser aller, le vieux Bandia pensa « ils [les esprits des ancêtres courroucés] ne m'ont pas pardonné » (JHS, p. 132).
Indépendamment de sa barbarie, et de ce qu'il nous révèle sur certaines pratiques encore en usage en Afrique, cet épisode est intéressant dans la mesure où il met en scène une série d'acteurs qui, tous, se réclament de l'Islam. Si Bandia vit sa conversion à l'Islam, consécutive à son départ sans retour du village natal, comme une trahison à l'égard des ancêtres, — ainsi que le suggère le passage cité ci-dessus — en revanche tous les personnages que nous avons évoqués dans cette section se placent délibérément sous la protection d'Allah. Soriba, le marabout filou, dérobe les 125 000 francs de Monsieur Baly en vue d'effectuer un pèlerinage à la Mecque — ce que recommande le Coran à tout croyant —, tandis que pour Elhadj Karamo, comme son nom l'indique, c'est déjà chose faite.
La violence des détenteurs du pouvoir : le « Guide » et ses avatars
Mais il y a une autre forme de culte rendu aux puissants, c'est celui qui entoure un personnage qui, a priori, en sa qualité de chef de l'État, relève uniquement du pouvoir laïc, mais dans lequel tout un chacun reconnaît le « Guide » de la nation. L'emploi de ce terme à connotation religieuse est particulièrement appuyé dans Le Jeune Homme de sable, un récit qui, par sa thématique comme par son écriture, s'inscrit dans une configuration beaucoup plus vaste au sein de laquelle la représentation du pouvoir, mi-tragique, mi-bouffonne, constitue l'un des points forts de la production romanesque contemporaine.
A ne considérer, en effet, que quelques-uns des romans les plus marquants de ces dix ou quinze dernières années, La Vie et demie et L'État honteux, du Congolais Sony Labou Tansi, la trilogie d'Alioum Fantouré composée par Le Cercle des Tropiques, L'Homme du troupeau du Sahel et Le récit du cirque de la vallée des morts, Le Pleurer-Rire d'Henri Lopès, Les Soleils des indépendances d'Ahmadou Kourouma — liste au demeurant susceptible de s'enrichir de quelques additions significatives — on ne manque pas d'être frappé par l'effet de redondance et de surcharge qui accompagne inéluctablement la mise en scène à laquelle donne généralement lieu la présentation, par les romanciers, du détenteur suprême du pouvoir :
Qui oubliera, observe Henri Lopès dans Le Pleurer-Rire, l'entrée du Maréchal Hannibal Ideloy Bwakamabé Na Sakkadé, Président de la République, Chef de l'État, Président du Conseil des ministres, Président du Conseil national de Résurrection nationale, Père Recréateur du pays, titulaire de plusieurs portefeuilles ministériels à citer dans l'ordre hiérarchique sans en oublier un seul, fils de Ngakoro, fils de Fouléma, fils de Kiréwa, la poitrine toute décorée et étincelante de plusieurs étages de décorations, au son du fameux « Quand Tonton descend du ciel », exécuté à l'harmonium par le curé de la Paroisse Saint-Dominique du Plateau 6.
La jubilation évidente de l'auteur du Pleurer-Rire souligne ici à plaisir la majesté bouffonne du personnage, investi de la quasi-totalité des pouvoirs, mais il insiste également sur la légitimité de ce pouvoir — manifestée par la généalogie prestigieuse du président — et sur son essence divine. Tonton (c'est le surnom du président) est en effet un être différent du commun, comme le rappelle d'ailleurs le cantique « Quand Tonton descend du ciel ».
Sans s'embarrasser de détails, Sony Labou Tansi qualifie, pour sa part, la longue cohorte de tyrans qui accablent la Katamalanasie des maux les plus divers de « guides providentiels », tandis que Baré-Koulé, le président de la République des Marigots du Sud dans Le Cercle des Tropiques, est tour à tour appelé « le Sauveur », « le Vénérable Maître », « le Messie-Koïe ». Cette dernière désignation est d'ailleurs intéressante dans la mesure où elle procède par amalgame syncrétique de deux termes parfaitement redondants : le Messie, d'une part, emprunté à la culture judéo-chrétienne, et le mot koï qui, en songhay, signifie le chef. Mais un chef que la tradition africaine a toujours plus ou moins divinisé. Ainsi, comme le remarque Mody Cissoko,
les Soninké considèrent le Roi comme un personnage sacré. Il a le pouvoir d'entrer en communication avec les êtres invisibles de la nature. […] Le jour de son investiture, aussitôt proclamé roi et devenu un autre être, il prédit comme un devin les grands événements qui doivent se produire sous son règne 7.
[Note — Baré-Koulé est un mot composé de deux noms : Baré (chien) et Koulé (single), en Sosokui, la langue maternelle de Fantouré — Tierno S. Bah]
Quant au tyran sanguinaire, qui apparaît aux premières
pages du Récit du cirque d'Alioum Fantouré, le « Rhinocéros tacheté », sa naissance s'apparente tout simplement à celle des héros épiques les plus prestigieux, tels le Sunjata de l'épopée mandingue, puisqu'il est, nous dit-on, le fruit de l'accouplement d'une panthère et d'un rhinocéros…
Mais le peuple ne peut que trembler devant un tel maître dont le programme suffirait à faire frémir les plus aguerris. Qu'on en juge :
« Moi, assis sur mon peuple, le piétinant comme un vieux tapis, le traînant comme une vieille savate, le torturant comme un ennemi mortel, le détruisant comme une vieille ruine frappée, violée par le temps et les intempéries, en en profitant comme une maîtresse sexuellement asservie par la soif du plaisir, l'exploitant comme un esclave, vendant son patrimoine au plus offrant. » Et le tyran d'ajouter : « Je veux qu'aux yeux du monde, ce territoire retourne à jamais dans la nuit des sans-espoirs.[…] Je veux que mes sujets viennent s'accroupir chaque matin au lever du jour dans les déchets de leur dieu Rhinocéros-Tacheté 8. »
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que s'établisse peu à peu autour du chef suprême, prudemment calfeutré dans son palais bunker, une sorte d'aura qui le rend quasiment inaccessible à ses compatriotes. « C'était aussi difficile de voir le Messie-Koï que d'atteindre le Bon Dieu», observe le héros du Cercle des Tropiques, tandis que Bernard Nanga, dans Les Chauve-souris, compare les dignitaires du régime admis à la Présidence à des pèlerins au retour des lieux saints :
Ils sortaient de la Présidence grisés et satisfaits d'avoir pu serrer la main du Père mystérieux de la Nation, en chair et en os … Bilanga connaissait ce sentiment de néophytes revenant de la table de communion, et regagnant leurs places, saisis de vertige, sûrs de la protection de la Providence 9.
Le « Guide » du Jeune Homme de sable n'échappe pas davantage à cette règle, puisqu'à l'exception du dernier chapitre de la première partie, le personnage n'est jamais directement mis en scène.
Arrêtons-nous, toutefois, dans un premier temps, à ce chapitre unique au cours duquel il nous est donné d'avoir accès au saint des saints, ce palais présidentiel qui suscite à la fois effroi et fascination chez les concitoyens du « Guide ». Dans un long monologue en forme de conversation avec Karamo, le chef de la Sûreté, le personnage dévoile plusieurs aspects inquiétants de sa personnalité complexe, mélange d'orgueil démesuré, de cynisme et de sourde inquiétude.
D'une manière très conforme à la représentation du pouvoir que nous donnent les sociétés africaines traditionnelles évoquées précédemment, le « Guide » s'identifie en effet à l'ancêtre fondateur de la nation à laquelle il estime avoir donné identité et réalité : « Je suis son père » (JHS, p. 69), affirme-t-il.
On se souviendra, à ce propos, que déjà, dans Les Soleils des indépendances, le président venu annoncer aux détenus leur libération prochaine s'adresse à eux comme à des enfants qu'on réprimande et que l'on punit sévèrement en vertu de l'adage « qui aime bien châtie bien » :
Pourquoi lui, le Président avait-il pris cette décision ? Pour des raisons très importantes. Lui, le président, était la mère de la république et tous les citoyens en étaient les enfants. La mère a le devoir d'être parfois dure avec les enfants. La mère fait connaître la dureté de ses duretés lorsque les enfants versent par terre la plat de riz que la maman a préparé pour son amant. Et l'amant à lui, le Président, était le développement économique du pays, et le complot compromettait gravement cet avenir, versait par terre cet avenir 10.
Le « Guide » mis en scène dans Le Jeune Homme de sable ne fait pas exception à la règle et manifeste à l'égard de ses compatriotes un égal paternalisme : « J'ai appris à ne jamais dormir, surtout la nuit. Il faut que mon peuple sente que je veille sur lui » (JHS, p. 68). Cette vigilance trouve cependant sa véritable origine dans des raisons moins avouables, et en particulier dans la peur qui hante le tyran. Peur omniprésente qui tantôt revêt la forme d'un cauchemar :
[M]a première épouse a fait un mauvais cauchemar : des gens armés sont entrés dans le palais, ils m'ont blessé et l'ont tuée. On est certainement en train de préparer quelque chose contre le pays (JHS, p. 69),
tantôt se manifeste par la crainte (au demeurant non imaginaire) d'être chassé du pouvoir par ceux-là mêmes en qui il place toute sa confiance :
Le malheur vient du ciel, tandis que le mal est en nous-mêmes : c'est quand tu cherches, par exemple, à courir mes femmes ou à prendre ma place. (JHS, p. 72),
dit-il, en s'adressant à Koramo, son chef de la « sûreté ».
La sourde inquiétude qui taraude le personnage s'accompagne d'une certaine lucidité sur soi, lucidité qui n'exclut ni le cynisme ni les rêves les plus fous. Dans un pays ravagé par la sécheresse et la famine, le « Guide » est en effet un personnage qui grossit, et chez qui cet embonpoint incongru provoque une prise de conscience, au demeurant non dépourvue d'ambiguïté :
Un jour vient où l'on est obligé de se reposer. C'est à ce moment-là qu'on commence à grossir de quelque part. Alors on prend l'habitude de soigner ses insomnies en cultivant la confortable confusion entre responsabilité et fatalité, entre mal et malheur (JHS, p. 71).
Cette confusion paraît poussée à son comble lorsque le « Guide » diagnostique chez son peuple non pas une famine, bien réelle, mais « un simple manque, comme le disent les médecins en parlant des toxicomanes » (JHS, p. 72). Cynisme — ou aveuglement — qui n'a d'égal que le machiavélisme du « Guide » décidé à souffler alternativement le chaud et le froid : n'a-t-il pas pris la résolution, au lendemain de la libération de Tahirou, d'exploiter les critiques que l'ex-détenu ne manquera pas de formuler à son endroit pour « ramasser tous les éléments douteux » et substituer à l'armée, peu sûre à ses yeux, « une milice spéciale » (JHS, p. 70) ?
Ce réalisme politique se double de vues mystiques et fumeuses sur l'édification d'une société idéale dont le « Guide », enfin débarrassé de ses ennemis, serait le nouveau messie :
Je descendrai moi-même dans les rues pour édifier sur cette terre qu'on maudit, dans le sang de tous les bourreaux, une société juste [ ... ] (JHS, p. 72).
Propos qui font écho à la fois à l'un des slogans officiels du régime dont était déjà traversé le cauchemar d'Oumarou, dans le premier chapitre du roman (« Tous ceux qui ont foi en moi m'aideront à purifier notre beau et grand pays » (JHS, p. 21) et au propre discours du « Guide » invitant ses compatriotes à « purifier » la cité de toutes les prostituées.
Cette dimension messianique du personnage est encore renforcée par la technique même du récit mise en oeuvre par Williams Sassine dans Le Jeune Homme de sable, technique qui, à l'exception du chapitre précité, consiste à saturer le texte de références au « Guide », sans que celui-ci soit réellement présent dans la mise en scène. La présence-absence du tyran est ainsi assurée au moyen d'un certain nombre de procédures qui vont de la réitération obsessionnelle — lourdement soulignée en particulier dans la séquence onirique, mais également disséminée dans le corps de l'oeuvre — à la multiplication des points de vue qui contribuent, à la manière d'une image kaléidoscopique, à la saisie du personnage du « Guide ».
Ainsi le « Guide » nous est-il évoqué de l'extérieur, comme dans la tradition épique, grâce au récit que le professeur Wilfrang nous fait des « enfances » du héros.
Nous apprenons ainsi de la bouche même de son ancien maître, interviewé par les journalistes, que, tout enfant, le futur guide, pénalisé par sa petite taille, faisait l'objet incessant des brimades de ses camarades de classe qui s'employaient à qui mieux mieux à lui taper sur la tête ! L'un d'entre-eux, parmi les plus turbulents, Tahirou, n'avait-il pas même, un jour, « coincé la tête du guide entre les deux battants de la porte » : « si je n'étais pas intervenu à temps il l'aurait probablement tué» (JHS, p. 21), observe le professeur Wilfrang. Brimades qui continuèrent jusqu'au jour où, poursuit le professeur Wilfrang,
je le vis confectionner une espèce de petit bonnet en cotonnade, au sommet duquel il dissimula une aiguille. Quelques minutes plus tard, lorsque je les fis entrer en classe, tous ses camarades se tenaient la main (JHS, p. 34).
Visiblement impressionné par son ancien élève, auquel
le lie désormais une vieille amitié, le professeur Wilfrang ne tarit pas d'éloges sur le charisme de ce personnage « né sous le signe du lion» (JHS, p. 35) et qui, du rang de simple mortel, se trouve progressivement hissé vers celui de demi-dieu. On retrouve ici le processus de mythification propre à l'épopée dans laquelle un handicap initial — c'est par exemple le cas de l'épopée mandingue de Soundiata — après avoir été pour le héros cause de souffrance et d'humiliation, est finalement dépassé, surmonté et sublimé. Dans cette optique, l'appétit de pouvoir du « Guide » peut alors s'interpréter comme une volonté de compensation et de revanche, à mettre en relation avec un fort complexe d'infériorité originel.
Cette vision laudative du « Guide » est en grande partie combattue et corrigée par celle que nous en donne le narrateur, évidemment peu suspect de complaisance à l'égard du personnage. La mise en scène du pouvoir à laquelle procède Sassine s'articule en fait autour de deux axes essentiels, celui du réel, tel qu'il peut être perçu par un observateur quelconque, et celui d'un imaginaire habité par le fantasme et l'hallucination.
Ainsi, dans Le Jeune Homme de sable, la figure du « Guide » nous est-elle rendue présente, au premier degré, d'abord par ses effigies multipliées à travers toute la ville. Passant devant le grand bâtiment du Parti, Oumarou n'a aucune peine à en imaginer « l'intérieur, tapissé de photos du “Guide” » (JHS, p. 31), et lorsqu'il rend visite à son père et pénètre dans le salon de la maison paternelle, la première chose qu'il aperçoit, c'est « un immense portrait du Guide », accroché face à la porte d'entrée. C'est encore le même spectacle qui s'offrira à lui dans le petit bureau où ses tortionnaires viennent de le pousser, juste après son arrestation : « Au mur, en face de la porte, un gigantesque portrait du Guide, souriant et protecteur » (JHS, p. 142).
Image réitérée, le « Guide » est également Parole qui s'inscrit tantôt sous forme de slogans disséminés sur tous les murs de la ville, tantôt parole totalitaire insidieusement répandue par les transistors. La visite que rend Oumarou à son ami Moctar, réparateur de postes de radio, est en effet pour lui l'occasion d'entendre la rediffusion de l'un des anciens discours du « Guide » appelant ses compatriotes à davantage de rigueur et d'austérité, tout comme au cours de l'entretien qu'il a avec son père, le héros perçoit, mêlé au léger sifflement d'un climatiseur, la
rumeur du « dernier discours du Guide ».
Mais la Parole, c'est aussi celle qui s'adresse au « Guide » pour le flatter, l'implorer, l'encenser. Parole éminemment laudative dont l'origine n'est que rarement spécifiée, et à laquelle son anonymat confère les caractéristiques d'une véritable incantation. L'adresse au « Guide » s'énonce en effet en de véritables formules stéréotypées qui en appellent à la vénération et à l'adoration, prouvant ainsi, si besoin était, sa nature « surhumaine ».
Ce culte de la personnalité, qui dispose pour s'exprimer de toutes les ressources de la «langue de bois », opère cependant de manière encore plus corrosive au niveau de l'inconscient collectif. Nous en avons une démonstration éclatante dans la scène d'ouverture du Jeune Homme de sable, au cours de laquelle le romancier procède à une véritable mise en scène délirante du pouvoir. Comme il en va souvent dans les rêves, cette séquence onirique renvoie à la réalité, mais une réalité évidemment éclatée, fractionnée et libérée par la levée des défenses qui définissent or dinairement l'état de veille. Ici, les souvenirs douloureux, les expériences traumatisantes et les angoisses refoulées peuvent se donner libre cours, et déclenchent un extraordinaire déferlement d'images hallucinantes qui, nous l'avons vu, fonctionne dans le roman à la fois comme rétrospection d'événements tragiques passés, et prémonition d'événements, tout aussi tragiques, à venir.
Dans ce kaléidoscope du monde totalitaire se télescopent ainsi des visions d'horreur — nous en avons évoqué quelques-unes dans le chapitre précédent — régulièrement ponctuées et coupées de slogans et de formules incantatoires, qui ne font que reprendre, sur un rythme heurté et halluciné, et en la démultipliant, la litanie ordinaire de la flatterie officielle :
Partout, sur les murs sont affichées des photos représentant toutes le même homme dans des poses différentes : assis, debout, couché, mais toujours souriant, le bras droit dans la crinière d'un énorme lion menaçant (JHS, p. 14).
Des voix traversent aussi cet univers dantesque, voix des suppliciés qu'on torture, mais aussi voix anonymes et impersonnelles du pouvoir (« seule une voix métallique me répond ; le Parti du Lion vaincra » [JHS, p. 14]) auxquelles se joignent et se mélangent, et les actions de grâce des adorateurs du « Guide » (« Béni soit notre sauveur; toi seul détiens le bien, la vérité et toutes les lumières » (JHS, p. 109]), et les cris impuissants du narrateur (« Grand Lion du désert, c'est Oumarou qui a écrit le tract… Je crie plus fort : c'est vrai, laissez-le. C'est moi le responsable » [JHS, p. 19]). Enfin, dernier élément et non le moindre dans cet univers parfaitement surréaliste, un oeil— qui n'est pas sans rappeler l'oeil de la conscience du célèbre poème deVictor Hugo — plane sur cet univers de cauchemar, et paraît obséder le narrateur comme un reproche :
En même temps que la lumière revenue, un oeil grandit à travers la serrure de la porte, globe blanc roulant dans tous les sens son disque noir (JHS, p. 11).
Il ressurgira d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de la séquence :
L'oeil se détache de l'arbre et volète autour de moi avec des battements de ses lourdes paupières. […] l'oeil est blotti au creux d'un arbre mort (JHS, p. 13).
L'omniprésence du « Guide » est encore assurée, et renforcée, par le pouvoir quasi-démiurgique qu'il possède de multiplier autour de lui ses avatars. Les hommes de main, les exécuteurs des basses oeuvres et les fidèles qui l'entourent finissent en effet par s'identifier à tel point au symbolisme officiel — celui du lion — qu'ils en deviennent à leur tour des hommes-lions, rappelant les hommes-panthères qui ont, maintes fois, défrayé la chronique judiciaire africaine :
Sur les épaules de certains hommes assis poussent de petites crinières. Au fur et à mesure ils se lèvent en rugissant et se jettent sur les autres… Un rugissement retentit et les hommes à crinière, au pas militaire, sortent à la rencontre du soleil… Au fond de la salle se dresse un géant à épaisse crinière, sa main brandissant un énorme couteau (JHS, p. 21-22).
Mais l'avatar numéro un, le plus proche à la fois et le plus redoutable pour le « Guide », c'est certainement Elhadj Karamo, l'inquiétant chef de la Sûreté, objet simultané de crainte et de pitié en raison d'une infirmité qui l'obsède :
A cause de son pied et de sa ridicule petite voix enfantine. A cause surtout de ce pied à la plante roulée en boule, qu'il était tout le temps obligé de cacher avec un grand et long boubou. Même en faisant l'amour il ne se préoccupait que de lui, l'écartant le plus loin possible de sa partenaire de peur de la sentir frémir de dégoût à son contact. C'était à cause de ce pied qu'on l'avait surnommé « Point-Virgule » (JHS, p. 56).
L'intuition du « Guide » ne le trompe pas ; cette contrefaçon dérisoire de lui-même ne nourrit à son endroit, sous les dehors de la plus obséquieuse servilité, que haine et envie. Il est en effet l'âme damnée d'un complot destiné à renverser le « Guide », mais son empoisonnement inopiné, en même temps que celui du député Abdou, l'empêchera de mener son projet à terme.
La mise en scène délirante du pouvoir à laquelle procède Sassine a pour effet de le déréaliser et d'en faire une sorte de Léviathan à la fois bouffon et terrifiant. Mais cette sinistre pantalonnade ne saurait occulter la tragédie qui se joue quotidiennement au coeur d'une Afrique arrachée à son Histoire et vendue à l'encan. Cette dépossession, rendue plus sensible encore par l'abandon des divinités tutélaires, n'a-t-elle pas pour conséquences la dépersonnalisation, la perte d'identité et, finalement, la honte de soi ?
Une tragédie africaine
La fausse alternative qui s'offre aux assimilados de Wirriyamu, « devenir Portugais noir ou rester Noir [p]ortugais » (W, p. 27), pourrait bien définir la situation des colonisés, ou ex-colonisés que Williams Sassine met en scène dans ses romans. Tous, à des degrés divers, semblent en effet les victimes d'une tragédie qui trouve son origine dans le cambriolage de leur propre histoire, au bénéfice de l'histoire de l'Autre, avec pour conséquences, à plus ou moins long terme, le déracinement, la dépersonnalisation et l'abandon des dieux tutélaires.
L'histoire confisquée
C'est le chef des guérilleros qui, dans Wirriyamu, formule le plus explicitement ce sentiment d'avoir été spolié de son passé : « Nous luttons […] pour sortir de notre enfance. Cinq siècles d'enfance malheureuse », fait-il observer à Augustinho, et il poursuit : « Le plus douloureux n'est pas de rester inachevé, mais de ne rien achever » (W, p. 137).
Un peu plus tard, le même personnage revient sur l'occupation séculaire de son pays par les Portugais, occupation dans laquelle il voit une véritable « falsification de [son] histoire », ajoutant d'ailleurs : « nous sommes les survivants d'un naufrage historique, métaphysique et culturel » (W, p. 162-163).
Le sentiment d'être les laissés-pour-compte de l'Histoire
semble avoir été particulièrement vif dans les anciens territoires portugais, vis-à-vis desquels le gouvernement de Lisbonne, les considérant fictivement comme des « provinces », on l'a vu, a toujours pratiqué une rigoureuse politique de vide sanitaire. « Ici, remarque le chef, nous avons toujours été coupés du reste du monde » (W, p. 162).
Cette véritable déterritorialisation s'explique également,
selon le même personnage, par le défaut de combativité
des sociétés africaines au moment où s'est produit le choc de la conquête :
Nous avons été vaincus dès le départ parce que n'avons qu'une conception fataliste, magique, religieuse de l'histoire, et que nous n'avons pas su opposer au mensonge, à la duplicité, au machiavélisme qui cachaient l'agressivité des premiers colons, une autre agressivité, plus subtile et efficace (W, p. 163).
Un lourd bilan : déracinement, acculturation, dépersonnalisation
Cette « lente tragédie » de l'Histoire qu'évoquent les romans de Sassine s'exprime souvent en termes de déracinement. Le déracinement peut être affectif et revêtir la forme de l'exil qui fut pendant longtemps, on s'en souvient, la condition même de l'écrivain. Exilés donc, les hommes de Wirriyamu, successivement dépossédés de leurs terres, requis pour les travaux forcés ou déportés dans les mines d'Afrique du Sud. Exilé également, Kabalango, le héros du roman, dont le destin malheureux passe par un long et décevant séjour en Europe, d'où il reviendra désespéré, quasi moribond. Exilé enfin, et définitivement, le vieux Bandia du Jeune Homme de sable, qui a quitté son village pour chercher fortune ailleurs, et qui ne pourra jamais y revenir, puisque une inondation catastrophique a rayé à tout jamais ce village de la carte.
D'une façon générale, les personnages de Sassine apparaissent tous, à des degrés divers, comme des personnes déplacées. Dans la ville où il a pourtant accompli toute sa carrière enseignante, Monsieur Baly demeure jusqu'au bout, aux yeux des autochtones, un « étranger » ; Oumarou, le jeune homme de sable, ami des petits mendiants, apparaît lui aussi comme un étranger, voire un traître à sa classe sociale d'origine. Enfin, lorsque Camara retourne en Guinée, après la mort du « PDG » , il est immédiatement perçu par ses compatriotes restés au pays comme un « Guinéen de l'extérieur », donc, d'une certaine façon, comme un étranger. D'ailleurs, au fil des jours et des aventures qui le conduisent de Conakry à Kankan, ce « Zéhéros » au nom évocateur prend progressivement conscience du décalage qui existe entre son rêve-souvenir du pays natal… et la réalité. « Le voyage dans la misère des miens ne venait que de commencer 11 »,écrit-il, pour constater, amer, au moment où il est prêt à rembarquer :
[O]ù étaient passés tous les copains d'enfance, notre prospérité, notre amour des petits matins, notre penchant pour la critique, notre enthousiasme pour la rencontre […] (Z, p. 211) ?
Mais le déracinement peut également se traduire par le sentiment d'exil intérieur, que provoque parfois l'appartenance simultanée et conflictuelle à deux cultures, surtout lorsque ces cultures se situent l'une par rapport à l'autre dans un rapport dominant-dominé.
A l'image de leur créature, bon nombre des personnages mis en scène par Sassine sont en effet des intellectuels, qu'il s'agisse de Kabalango et du chef des maquisards dans Wirriyamu, de Monsieur Baly, le vieil instituteur, ou encore d'Oumarou et de ses compagnons de lutte dans Le Jeune Homme de sable. Tous, à des degrés divers, vivent le malaise de l'homme des deux mondes, souvent déporté de lui-même du fait de la culture étrangère, qu'il a assimilée ou qu'on lui a inculquée, et dont il est imprégné.
Ainsi, dressant le bilan de « quarante années de loyaux et durs services» (SMB, p. 91) dans l'enseignement, Baly éprouve-t-il un sentiment de doute :
[N]ous devons former les hommes d'une civilisation et nous sommes nous-mêmes au carrefour de deux systèmes de valeurs, je ne suis personnellement pas sûr d'en pouvoir faire la synthèse (SMB, p. 91).
Réfléchissant à sa seconde carrière d'enseignant bénévole, Baly estime désormais indispensable de faire l'économie des « coupables singeries du Blanc » (SMB, p. 102) en matière pédagogique, et il définit ce que devra être sa mission vis-à-vis de l'élève de demain :
Arracher son âme aux ténèbres de l'ignorance, à la longue série de mensonges et d'humiliations dont il a hérité des années de colonisation déclarée (SMB, p. 103).
Pour des raisons identiques, le chef des guérilleros, dans Wirriyamu, refuse d'accepter le terrorisme de la culture occidentale qui a fait pendant longtemps du Noir un mendiant culturel assujetti à l'imitation du modèle européen :
L'une des conséquences de cette colonisation, reprit le Chef, a été la naissance d'un complexe d'infériorité aggravé par mille astuces, comme celui de la falsification de notre histoire, ou en imposant le modèle de beauté gréco-latine avec peau blanche, cheveux lisses, nez droit, lèvres minces. Tout ce qu'un Noir ne possède pas, en somme. On croit plus ou moins qu'il est un boulet attaché aux pieds de l'humanité (W, p. 162).
A cette vision ethnocentrique et réductrice de l'Afrique, le chef oppose donc le vrai visage de l'Afrique, riche de ses multiples civilisations précoloniales :
Mais avant, fait-il observer, nous composions un monde cohérent, organisé, civilisé. Augustinho, prenez par exemple nos tissages, nos poteries, nos masques, nos différentes sculptures, notre musique ; ils prouvaient chacun l'existence d'un art et d'une pensée élevée (W, p. 163).
On croit entendre ici un écho des propos enthousiastes par lesquels Frobénius, dans les années trente, saluait sa propre découverte des civilisations africaines. Celui en qui Senghor et ses amis n'allaient pas tarder à voir le grand révélateur de l'Afrique méconnue 12, l'ethnologue allemand Léo Frobénius, avait en effet entrepris de bousculer les préjugés défavorables généralement nourris à l'endroit du continent africain, ce « géant lourd et grossier ». Il écrivait ainsi dans Die Kunst Afrikas :
Lorsqu'ils mouillèrent dans la baie de Guinée et débarquèrent près de Weida, les capitaines furent stupéfaits par le spectacle qui s'offrait à leurs yeux : des rues soigneusement tracées, plantées d'arbres sur des kilomètres et des kilomètres, à perte de vue ; durant des journées et des journées de voyage, rien que des champs magnifiques, des gens en costume d'apparat dont les étoffes étaient tissées sur place. Plus au sud, dans le royaume de Congo, des foules vêtues de soie et de velours ; de grands États, où le moindre détail témoigne d'un ordre parfait; des souverains puissants, des industries florissantes, une civilisation qui a pénétré jusque dans la moelle. Or, c'est le même spectacle qui s'offrait aux yeux dans les régions de l'est, par exemple sur la côte de Mozambique. Des relations des navigateurs du xve au xvme siècle, il ressort sans le moindre doute qu'à cette époque l'Afrique noire au sud de la ceinture désertique du Sahara, était encore dans tout l'éclat de civilisations florissantes harmonieusement développées, que les conquistadores européens allaient détruire dans la mesure où ils réussiraient à pénétrer vers l'intérieur. Car le nouveau continent, l'Amérique, avait besoin d'esclaves 13.
Le rejet, plus ou moins conscient, des valeurs de la civilisation africaine entraîne, par le biais de l'acculturation, une forme de dépersonnalisation qui aboutit soit au refus ou à la honte de soi, soit à un état de confusion intellectuelle dont participent bien des personnages de Williams Sassine.
« J'ai la conscience aussi lourde qu'une montagne de cailloux » (SMB, p. 125), confesse Monsieur Baly — utilisant au passage une image qui constituera l'un des leitmotive du troisième roman de Sassine, Le Jeune Homme de sable — et cette métaphore du fardeau à porter est sans doute à mettre en relation, précisément, avec l'expression qu'utilise, en manière d'autocritique, le proviseur du lycée, Tahirou, lorsqu'il déplore sa propre « obésité intellectuelle » (SMB, p. 105).
D'une façon très personnelle, et par le biais de ce personnage, le romancier procède ainsi à une remise en question du statut de l'intellectuel africain nourri d'un savoir essentiellement livresque et formulé dans une langue étrangère. A ce savoir d'“intellectuels de foire”, selon sa propre expression, sans véritable prise sur la réalité, il oppose donc la connaissance qui découle d'une longue et attentive pratique de la tradition. Ainsi, semble-t-il, l'expérience carcérale de Tahirou a-t-elle été pour lui l'occasion de faire le vide pour mieux appréhender la réalité brute :
Le jour où l'on m'a arrêté, j'ai compris que j'avais tout perdu ; je ne ressemblais je m'en rends compte, qu'à ces intellectuels de foire qui se promènent avec des dictionnaires dans leurs bottes pour épater le commun des mortels. Mes connaissances, c'était du chiqué. Ce sont mes deux « neveux » [il s'agit des goumiers commis à la surveillance du prisonnier] qui m'ont fait découvrir des choses merveilleuses, collées à la réalité, à la paroi lisse de notre ciel et de notre désert. Ils m'ont appris comment dresser un dromadaire, s'orienter sans boussole, se laver avec du sable fin, deviner l'approche d'une tempête de sable et s'en protéger, se désaltérer avec quelques gouttes d'eau et comment en obtenir avec des cailloux, des peaux, ou une couverture, et des tas d'autres choses (JHS, p. 108-109).
Cette faillite du savoir occidental comme facteur de transformation du monde, Oumarou l'éprouve également, d'autant plus, peut-être, qu'à la différence de son aîné Tahirou, il lui manque l'expérience et la maturité. Dans son désir passionné de changer le monde, il ouvre « désespérément tous les livres » (JHS, p. r64), mais comme le lui fait remarquer le proviseur du lycée, « tu ne découvriras dans aucun livre le remède aux malheurs de nos concitoyens » (JHS, p. 165).
Et, comme en écho, Oumarou se répond à lui-même : « c'est ça, j'ai trop lu » (JHS, p. 173), tandis que « la voix » avec laquelle il dialogue à l'épilogue du roman confirme son diagnostic :
Dès que tu es dans une situation donnée, tu fais appel à une de tes vieilles lectures. Je me demande ce qu'il te resterait si on t'enlevait ce que tu as appris dans les bouquins des Blancs (JHS, p. 175).
La disqualification qui affecte les connaissances empruntées à l'Occident s'étend également à la langue étrangère, en l'occurrence le français, suspectée de contribuer au déracinement de l'intellectuel africain. C'est un problème qui est évoqué à plusieurs reprises par le biais de Monsieur Baly : « Ce parent d'élève, s'interroge le vieil instituteur, se doute-t-il qu'en instruisant son fils dans une langue étrangère, je risque de les éloigner l'un de l'autre ? » (SMB, p. 28).
De même Tahirou avoue-t-il son impuissance à écrire dans sa langue maternelle :
Pendant toutes ces huit années de captivité j'ai très souvent essayé. Je prenais par exemple une idée quelconque, comme cette pensée « La confiance est un manque d'imagination » et je m'efforçais de disserter là-dessus dans notre langue. Je n'y suis jamais arrivé. Pendant huit années ! Parfois je croyais m'être tiré d'affaires, mais toujours aussitôt après, je me rendais compte que j'avais contourné la difficulté en pensant d'abord en français avant de traduire (JHS, p. 104-105).
Souvenons-nous également qu'une partie des ennuis d'Oumarou proviennent de son hostilité à la francophonie :
[L]e 8 décembre 1969, lui rappelle son père, tu as frappé l'inspecteur d'académie et tu lui as lancé « la francophonie, ça sert surtout à former des Français noirs » (JHS, p. 94).
Incident explicité quelques lignes plus loin par l'intéressé, qui le justifie au nom de la défense des langues nationales :
L'inspecteur avait surpris un de nos professeurs en train de nous expliquer la leçon dans notre langue ; il l'a engueulé parce qu'à son avis, cette méthode ne dénotait que du mépris pour le français, langue de notre civilisation, et qu'elle devait être abandonnée aux pays se prétendant révolutionnaires (JHS, p. 94).
Enfin, si Monsieur Baly est prématurément mis à la retraite, c'est précisément parce qu'il préconise « la suppression pure et simple du français en faveur de l'enseignement des langues nationales » (SMB, p. 28), en contradiction avec son collègue européen.
Dans cette perspective, plusieurs fois évoquée à travers les oeuvres romanesques, Sassine paraît également souhaiter, sans néanmoins employer le mot, un retour à ce qui a été désigné au Zaïre sous le nom d'« authenticité ». Ainsi les « incendiaires » qui traversent le cauchemar de Monsieur Baly enjoignent-ils au dormeur :
Fuyez vos cités infernales, et sans plus tarder enfoncez-vous sans peur au plus profond de vous-même ; vous l'y trouverez prêt à vous aider ; partez à la conquête de votre ciel et pour que votre nom y résonne clairement, débaptisez-vous et revêtez-vous des noms de vos ancêtres (SMB, p. 172).
Injonction qui trouve d'ailleurs un écho chez ses disciples, François et Mohamed appliqués à conjuguer le verbe « je suis un bâtard » à toutes les personnes du singulier de l'indicatif et répétant inlassablement, l'un et l'autre, comme une litanie obsessionnelle « “Je voudrais rentrer chez moi…” […] “Donnez-moi un nom…” » (SMB, p. 177).
Les dieux trahis
La crise identitaire qui affecte les personnages des romans de Williams Sassine trouve donc sa cause profonde, semble-t-il, dans un déficit spirituel provoqué par la trahison des dieux tutélaires de l'Afrique ancestrale.
Singitude, bâtardise, tels sont, en effet, parmi beaucoup d'autres, les concepts à travers lesquels cherchent à se définir des personnages le plus souvent culpabilisés et habités par la mauvaise conscience, tels Baly ou le vieux Bandia, figures jumelles et pathétiques du renégat.
Le premier, Baly, même s'il se réclame ouvertement de l'Islam, paraît également influencé par le Christianisme, mais, finalement, aucune de ces religions monothéistes
importées ne lui paraît la bonne. Il renvoie donc, dos à dos, aussi bien Jésus qu'Allah, auxquels il reproche non
seulement leur « surdité » et leur « indifférence » aux souffrances des hommes, mais peut-être davantage leur esprit de ségrégation par rapport à la race noire :
Je me dis maintenant qu'un dieu, disons un Père, s'il se complaît devant la souffrance de certains de ses enfants, c'est peut-être qu'il ne les reconnaît pas comme ses enfants légitimes ; les Blancs, ce sont les légitimes, il s'occupe d'eux, et il leur a donné un prophète pour qu'ils puissent le reconnaître. Nous, les Noirs, nous sommes les bâtards de ces faux dieux, les fils illégitimes de ces Pères indignes: nous sommes des bâtards, tous (SMB, p. 157).
Par conséquent, Baly estime qu'il leur faut, à lui comme à ses compatriotes, réapprendre l'Afrique, et dans ces conditions il ne peut qu'être réceptif aux philippiques de son disciple François dénonçant les « dieux étrangers » :
En vérité le trône de notre ciel est vide […]. […] Toutes nos grandes et nobles luttes sont des causes désespérées parce que Celui que nous acceptons comme Juge et Arbitre suprême est le Père de nos ennemis […]. L'unité des Noirs doit passer par une réconciliation avec nos divinités du passé (SMB, p. 159-160).
Le même son de cloche, si l'on peut dire, se fait entendre dans Le Jeune Homme de sable, où Sassine accorde une
importance toute particulière au personnage de Bandia.
On se souvient que ce vieux serviteur du député Abdou a naguère quitté son village natal pour chercher fortune en ville. Mais en abandonnant volontairement le berceau de ses ancêtres, Bandia les a également reniés puisqu'il s'est converti à l'islam. Cette conversion, purement formelle, a installé en lui un état permanent de sentiment de culpabilité et de mauvaise conscience dont il sera hanté toute sa vie, et dans laquelle se situe, selon lui, la cause de sa mort tragique. Et surtout, l'injure faite aux ancêtres a été, si l'on en croit le personnage, le point de départ des malheurs, innombrables, du pauvre Bandia :
Il opta pour l'Islam comme tant d'autres qui s'efforçaient de s'intégrer à un milieu organisé, parce que cette religion permettait facilement de pénétrer les autres milieux d'émigrants ou les sociétés étrangères, et d'échapper aux périls qui menacent l'homme seul. Il prit le nom de Sidi Boubacar. C'est alors que ses malheurs commencèrent (JHS, p. 48).
Victime de plusieurs accidents du travail, Bandia devait en effet perdre successivement sa femme et son beau-père, et après avoir erré quelques temps, échouer dans la concession du député Abdou, où il fait figure de « maudit » et de « vieillard inutile », méprisé et rejeté de tous.
De tous, sauf d'Oumarou qui a compris la détresse du personnage et qui s'attarde le soir, dans la concession, à
écouter le vieux Bandia dialoguer avec sa cora, le seul lien, ténu, avec son passé saccagé :
Et sans attendre, il serra affectueusement la cora entre ses genoux. Dès qu'il fit monter les premières notes, il lui sembla que son oreille malade entendait à nouveau. L'enfant couché près de lui poussa un dernier vagissement et se tut. Lui aussi, tout petit, il ne se taisait que quand il entendait jouer le vieux Kouyaté. Il lui arrivait encore de l'entendre parfois, toujours dans son rêve, assis au milieu de son père, de sa mère, de ses oncles et des mille visages de son enfance. Ce rêve ne variait jamais : tout le village baigné dans un beau clair de lune, avec au fond, là où se dressait la forge familiale, une douce et rassurante musique d'enclume et de marteau (JHS, p. 63).
Il ne reste donc plus à Bandia que sa cora et la nostalgie d'un passé qui survit en lui comme un remords vivant. Car le vieux Bandia sait très bien, au fond de lui-même, que les dieux ancestraux, courroucés, ne lui ont pas pardonné son abjuration :
Quelque chose de terrible m'arrivera bientôt. Il y a cinq jours mon défunt père m'est apparu dans un rêve pour m'avertir : il exige le sacrifice d'un mouton (JHS, p. 67).
Dans l'impossibilité d'acquitter le coût de ce mouton rituel, on sait que Bandia sera lui-même la victime d'un sacrifice barbare, ourdi par Elhadj Karamo et le député Abdou, afin de rendre les forces occultes favorables à leur projet de renversement du « Guide ». Sacrifice dans lequel il ne verra, lui, que la vengeance des ancêtres acharnés à sa perte :
« Ils ne m'ont pas pardonné… La grosse étoile filante était donc pour moi» (JHS, p. 132).
Mais il est encore une troisième figure de renégat qui hante l'univers romanesque de Sassine, peut-être à la fois la plus pitoyable et la plus caricaturale, c'est celle du père Fidel, le curé de Wirriyamu. Ce personnage de prêtre haut en couleurs, que travaille sourdement la concupiscence, apparaît en effet comme le symbole même de l'assimilado qui a tourné le dos aux croyances ancestrales et contribué, par son action apostolique, à détourner ses propres compatriotes de leurs dieux tutélaires :
Leur Supérieur leur avait dit un jour : « Votre mission consiste à baptiser autant d'infidèles que possible… » Il n'avait fait que cela depuis des années. A présent, ils portaient tous un nom chrétien à Wirriyamu. […] Il avait écrasé toutes les idoles, et pourtant… (W, p. 29).
Pas plus que ses compagnons imaginaires, Baly ou Bandia, le père Fidel n'a été en mesure de se prémunir contre « l'arrogance sanctifiée des colons qui peignaient Dieu en blanc » (W, p. 135), et il apparaît comme l'un des principaux artisans de la désacralisation de Wirriyamu, acharné qu'il était à détruire tous les « fétiches » du village. A détruire, ou à détourner de leur fonction primordiale, puisqu'il semble qu'il ait été l'un des premiers pourvoyeurs de Monsieur Robert, le tenancier de La Calebasse d'or, dont les greniers regorgent de masques et de statuettes sacrés, soustraits à des fins mercantiles à l'adoration des fidèles .
Le dernier fétiche jeté, ou vendu, demeure chez le père Fidel le sentiment obsédant d'une trahison, sentiment que contribue à attiser le souvenir de son propre père, qui resta toujours, contre vents et marées, fermement attaché à la religion de ses ancêtres, et refusa, jusqu'au bout, de céder aux missionnaires la petite déesse de la foudre : « une statuette couverte de cauris rougis de jus de noix de cola » (W, p. 183) en laquelle il plaçait toute sa foi.
A celui qui a construit sa vie sur « les cadavres de ses dieux » (W, p. 182), il appartient donc de faire amende
honorable en rejetant sans aucune hésitation les faux dieux et les fausses fraternités, et en « réinventant le ciel », à la manière de Condélo, l'albinos.
Peut-être le geste suicidaire par lequel le père Fidel met le feu aux masques sacrés, au moment où Wirriyamu se
transforme en une apocalypse de flammes et d'enfer, constitue-t-il, à sa manière, le sacrifice ultime rendu aux
mânes des « dieux vendus » ?
On doit également évoquer ici la figure de Monsieur Baly tel qu'il apparaît dans la scène hallucinante au cours de laquelle, lui-même et ses compagnons, après avoir été brutalement agressés par leurs détracteurs, recherchent dans le vin l'oubli de tous leurs malheurs. Alors que François et Mohamed donnent libre cours à leurs divagations, Baly, lui, sombre dans un cauchemar habité par une « grosse bête remuante » qui l'exhorte au blasphème à l'endroit des divinités d'importation. Et tandis que des bribes de La Mort du loup d'Alfred de Vigny traversent son esprit embrumé, en même temps que le reste d'un vieux poème, sortirent par tous les pores de son corps toutes sortes de saletés répugnantes ; il vomit et commença à tirer de sa bouche un interminable vers de terre blanc (SMB, p. 173).
Il s'agit là d'une scène évidemment très symbolique, et qui n'est pas sans évoquer une autre scène, assez semblable, du roman de Georges Ngal, Giambatista Viko 14. Pétri de culture occidentale, le héros de cette histoire, Giambatista Viko, ambitionne en effet de produire « un roman sur le modèle du conte » et, pour y parvenir, il tente une fusion hasardeuse entre l'oralité et l'écriture. Jugé sacrilège par un tribunal de vieux sages et de gardiens de sanctuaires, ce « viol du discours africain » donne lieu à un procès retentissant à l'issue duquel le coupable, Giambatista Viko, après avoir été soumis à l'épreuve des proverbes, doit avaler une potion particulièrement amère. Dans l'esprit de ses juges, cette potion de vérité est destinée à purger le patient — entendons ici l'intellectuel colonisé — de toutes les séquelles d'une aliénation culturelle qui remonte à ses premières années, puisque tout jeune enfant le héros a refusé le rituel de l'initiation traditionnelle :
Je me conforme aux injonctions. Des coups de bâton rythment les trois prises. L'effet semble se produire lentement. Progressivement. Petit à petit mes yeux deviennent hagards… Trois coups sur mes épaules et à la colonne vertébrale me jettent à genoux. Et je commence à vomir des grenouilles très visqueuses. Des crabes. A la fin plus qu'un liquide visqueux… 15
Condamné à « l'errance » (c'est d'ailleurs le titre du second roman de Ngal), une errance dont la fonction est à la fois cathartique et thérapeutique, Giambatista Viko
pourra alors accomplir un véritable pèlerinage aux sources et entrevoir des jours meilleurs, pour lui-même et pour une Afrique enfin réconciliée et rendue à elle-même.
Cette réconciliation paraît pourtant encore bien improbable dans les romans de Williams Sassine étudiés ici.
Même s'ils semblent plutôt privilégier l'abandon des religions importées au profit, sinon du seul animisme, du moins d'une religion strictement africaine, qui reste au fond à inventer. Manière de messianisme dont nous
aurons à reparler plus tard.
Retenons, pour lors, que Sassine refuse toute forme de syncrétisme religieux, comme il en existe an Amérique latine et dans d'autres pays africains, et qu'il met au contraire l'accent, chez ses personnages, sur les vertus du retour aux sources. A l'image de la cora de Bandia, qui est à elle seule une « mémoire » du passé, le romancier estime, avec le chef des guérilleros, que « rien n'est perdu » (W, p. 163), à condition de se souvenir que « chez nous [entendons : en Afrique] continuent d'exister des communautés dont l'organisation a survécu à cinq cents années de domination » (W, p. 163). Comme le feu qui couve sous la cendre, la révolte s'est allumée au sein des âmes noires de Wirriyamu, et peut-être suffit-il, comme semble le penser Kabalango, d'une bonne pluie pour purifier l'Afrique de ses souillures :
La pluie le consolait toujours. Il lui semblait qu'elle seule permettrait facilement de laver les traces du Blanc pour révéler la véritable face de l'Afrique, mystérieuse, envoûtante, pleine d'âmes d'hommes, de bêtes et de végétaux (W, p. 34).
Symboles de renaissance et de purification rituelles, l'eau et le feu apparaissent donc étroitement liés au projet de réhabilitation des anciennes cultures africaines qui anime Williams Sassine. Dans ce contexte de résistance aux poisons du colonialisme, même la passivité et la résignation, apparentes, peuvent être des atouts, dans la mesure où, semble-t-il penser, l'une et l'autre s'inscrivent dans une stratégie du retardement. Comme l'exprime le chef des guérilleros, dans Wirriyamu :
Le Noir a toujours été dépeint amorphe, minéral, végétal. On ne peut pas croire à la condition esclave d'une pierre, n'est-ce pas ? Mais si le Noir n'avait pas adopté cette passivité pour protéger son originalité, il aurait déjà été anéanti (W, p. 162).
Si donc, comme le prétend Kabalango, « mourir n'est pas un problème, c'est vivre qui est difficile », on comprend mieux que tous les efforts des personnages tendent vers une restauration des puissances tutélaires trop longtemps délaissées au profit des dieux étrangers. Le « Père » qu'appelle de ses voeux François, nouveau prophète de cette religion restaurée, n'est donc ni le Dieu des chrétiens, ni celui des musulmans, mais bien plutôt une figure omniprésente et omnipotente en laquelle se résument les « divinités du soleil, de la pluie, des moissons, de la foudre, des forêts » (SMB, p. 160) qu'invoquent tous les grands prêtres de l'animisme. C'est à ce « Dieu de la sainte Afrique » que sera finalement dédié le cadavre de Monsieur Baly, devenu entre temps, grâce à sa vie exemplaire, « Saint Monsieur Baly », figure emblématique d'une Afrique régénérée. Comme le souligne en effet, en guise d'oraison funèbre, son fidèle compagnon Mohamed l'aveugle :
Si un déluge devait un jour à nouveau noyer le monde, entre un homme comme lui et un imam, c'est lui qu'il faudrait sauver dans la nouvelle arche (SMB, p. 218).
Propos auquel fait d'ailleurs écho la résolution finale de Monsieur Baly, lorsque, après avoir surmonté tous les écueils dressés sur sa route, il décide, une fois encore, de persévérer dans son projet d'école pour les pauvres. En réponse au mystérieux appel des esprits dont le soutien ne lui a pratiquement jamais fait défaut, il envisage donc, lui aussi, de « signer avec eux une nouvelle alliance pour tout ce qui restait encore à faire » (SMB, p. 203).
Les acteurs de la tragédie : bourreaux et victimes
D'une manière très biblique, comme nous venons de le constater, la vision du monde que Sassine nous donne à voir à travers ses oeuvres romanesques paraît d'emblée marquée par une conception assez manichéenne de l'humanité qui s'organise, selon lui, en deux catégories bien distinctes, les bourreaux d'une part, et les victimes de l'autre. Peut-être ne sera-t-il pas inutile, également, de rappeler à ce propos la fascination du romancier pour l'oeuvre de Dostoïevski.
Cette dichotomie du monde, Camara, le héros du Zéhéros n'est pas n'importe qui, l'imagine d'ailleurs plaisamment sous forme d'une chanson que chanteraient, en duo, « les deux macias 16 », le chanteur et l'ancien président :
Le monde va par deux
Il y a l'homme et la femme
Il y a le bourreau et la victime
Il y a le pauvre et le riche
Il y a les morts et les vivants
Il y a le bien et le mal (Z, p. 50).
A bien regarder les romans de Sassine, on se rend compte, en effet, que la chanson dit vrai, et que de Saint Monsieur Baly à Le Zéhéros n'est pas n'importe qui, en passant par Wirriyamu et Le Jeune Homme de sable, tous ces textes sont justiciables d'une grille de lecture faisant apparaître une opposition tranchée entre des personnages détenant un pouvoir et exerçant différentes formes de violence — on l'a vu précédemment — et d'autres qui en subissent les fâcheuses conséquences : bourreaux et victimes.
Une classification sommaire permet en effet de ranger dans la catégorie des bourreaux tous ceux qui, de près ou loin, ont accès à l'exercice de l'autorité, politique, juridique ou religieuse. Dans Saint Monsieur Baly, quoique de manière parfois floue, les rôles d'oppresseurs (le mot paraît préférable à celui de bourreau dans le contexte de ce roman) se répartissent entre personnalités politiques, comme le député Abdoulaye, personnalités civiles, comme le maire, ses adjoints, l'inspecteur d'académie, les coopérants techniques, le commissaire de police, et enfin les personnalités religieuses, comme l'imam de la mosquée et les marabouts-charlatans.
Abdoulaye nourrit une haine tenace à l'endroit de Monsieur Baly à la suite d'une sombre histoire de dénonciation, remontant à l'époque coloniale, et qui n'a jamais vraiment été élucidée. Le député nous est présenté comme un personnage tyrannique, cupide et libidineux ; son goût pour les petites écolières s'accommode d'un penchant déclaré à l'homosexualité dont Baly, en vieil instituteur puritain, s'est fait plusieurs fois le censeur. Ce qui ne contribue pas à améliorer les relations entre les deux hommes.
Dans ces conditions, la demande de subvention pour son école, que présente Baly, n'a non seulement aucune chance d'aboutir, mais engendre aussi un surcroît d'animosité de la part d'Abdoulaye, secondé en cela par quelques-uns des enseignants de Baly, Gaoussou l'inverti, en réalité son « éternel ennemi », et Bana, dit « le Lièvre ». A eux trois, ils susciteront une grève des enseignants et chercheront par tous les moyens à discréditer le vieil instituteur : calomnies injustifiées, attentats contre les bâtiments de l'école, lapidation en règle du directeur de l'école et de ses compagnons, passage à tabac, incendies volontaires… toute la panoplie des exactions sera mise en oeuvre pour nuire à Monsieur Baly et le dissuader de persévérer dans son généreux projet.
Du côté des autorités administratives, Baly ne rencontre guère plus de compréhension, puisque chaque fois qu'il fait appel au maire, en lui demandant de mettre les caterpillars de la commune à sa disposition , afin de déblayer le terrain destiné à recevoir les bâtiments de l'école, ces mêmes caterpillars demeurent obstinément « en panne »… Il n'a pas davantage de succès avec les autorités académiques, responsables de sa retraite anticipée, et qui, à aucun moment, ne le soutiendront dans son entreprise pédagogique.
Pour sa part, le commissaire de police Mamoudou, ancien élève de Baly, n'a pas oublié les punitions corporelles dont il a été naguère victime, et il ne fait pas un geste pour protéger l'instituteur lorsque celui-ci est assailli par ses créanciers à la sortie du commissariat. Pas plus qu'il n'interviendra lors du saccage de l'école.
Enfin, les représentants de Dieu ne se montrent pas particulièrement cléments à l'égard du vieil homme. Exploité et spolié par le « grand » marabout Soriba, il dérange également les musulmans, dont il trouble le conformisme dévot. Mis à l'index par ses coreligionnaires, il sera finalement chassé de la mosquée et, scandale inouï, l'imam lui refusera même la sépulture en terre sainte.
Dans le camp des victimes, Baly et ses compagnons de misère, François le lépreux, Mohamed l'aveugle et tous les petits mendiants qui les entourent, occupent évidemment une place de choix. Les seconds paraissent essentiellement victimes du destin, des calamités naturelles (la lèpre, la cécité) et, dans une large mesure, d'une société injuste dans laquelle, comme dans la chanson des « deux macias », les riches côtoient les plus démunis. Véritables damnés de la terre, ils sont l'objet de la réprobation générale et tenus à l'écart de la cité et des « gens de bien » pour lesquels, toutefois, ils conservent une utilité puisqu'ils leur permettent de soulager les consciences en accomplissant l'aumône rituelle prescrite par le Coran.
Monsieur Baly incarne assez bien la victime presque parfaite. Aux conditions objectives de son malheur (sa mise à la retraite précipitée et ses déboires pour ouvrir la nouvelle école, sans oublier son absence de descendance et son veuvage), le personnage ajoute en effet comme une évidente prédisposition à la souffrance. Il a le sentiment d'appartenir au camp de ceux qui sont « faits pour essuyer les derrières de l'humanité » (SMB, p. 76), et il est parfaitement conscient que, chez lui, la malédiction n'est pas exempte d'un certain « masochisme » (SMB, p. 67). La lèpre qu'il a contractée en assistant François, et qu'il se refuse à soigner, en est peut-être le signe le plus manifeste. Il ne faudrait pas non plus négliger, au rang des victimes, la propre épouse de Monsieur Baly, Fati. Personnage effacé et douloureux dont la vie, selon les propres termes de son mari, n'a été faite que « de soumission totale et de résignation bestiale » (SMB, p. 71), elle ne connaîtra en effet jamais les joies de la maternité et périra stupidement, victime d'un accident de la route.
Dans Wirriyamu, le second roman de Sassine, l'opposition entre bourreaux et victimes se place entièrement, nous l'avons vu, sous le signe de la colonisation portugaise. Le cadre colonial du récit ne laisse ici peser aucune ambiguïté dans la répartition des rôles, les Blancs portugais assumant naturellement — et cette fois, très souvent au sens propre du terme — le rôle de bourreaux, tandis que les colonisés, assimilados ou non, en sont les victimes désignées.
Nous ne reviendrons donc pas ici sur les analyses que nous avons proposées dans notre section consacrée à la
vision de l'époque coloniale, mais en revanche nous nous attacherons plus particulièrement à un certain nombre d'exemples spécifiques qui traduisent la cruauté, voire le sadisme des relations entre Noirs et Européens au sein de la petite communauté de Wirriyamu.
Le roman s'ouvre en effet, à quelques pages de distance, d'abord sur la vision d'un homme enchaîné par une corde nouée à sa cheville — il s'agit, nous l'apprendrons plus tard, de Condélo, l'albinos — et de l'exécution d'un chien par pendaison. Ce double spectacle auquel est confronté Kabalango, le héros de Wirriyamu, définit d'entrée de jeu la tonalité d'un texte qui apparaît marqué à la fois par le sadisme dont font preuve les bourreaux, et par l'étonnante résignation — allons-nous à nouveau parler de masochisme ? — dont témoignent les victimes. Sadisme en effet que l'acharnement mis par Amigo, l'unique Portugais du village, à venger sa famille massacrée à la suite d'une révolte d'ouvriers agricoles :
Tu te rappelles, commente-t-il, leur chef, le petit noiraud ventru et bancal qui excitait ses camarades à ne plus travailler le dimanche ? Voici sa canine. Dès que je suis rentré de la ville… je l'ai pourchassé toute la nuit. Lorsque je l'ai rattrapé, il a sursauté et il m'a dit : « Patron, vous avez appris… » Je lui ai demandé d'avancer. Il n'a plus rien dit, même quand je l'ai frappé à la nuque avec une pierre. C'est l'extraction de sa dent qui m'a le plus embêté. Il faisait si noir (W, p. 15).
A cette scène initiale, répondent, tout au long du roman, une série d'exécutions — il n'y a pas d'autre mot — qui marquent un crescendo dans l'horreur et font de Wirriyamu un véritable martyrologe. Les victimes en sont, indifféremment, des animaux ou des hommes. Ainsi apprenons-nous, incidemment, que non content de tuer le chien du vieux Kélani, Amigo « a ordonné à son domestique de le frapper, de le piétiner, de l'écraser… » (W, p. 72), pratique qui, si l'on en croit le capitaine David, trouve son répondant dans la tradition militaire d'un pays voisin…
Cette forme de gratuité dans le crime se retrouve dans l'évocation du martyre de la mère de Condélo, une vieille négresse éventrée par un soldat ivre parce « qu'elle refusait de lui céder », ou encore de l'exécution du petit cousin de l'un des guérilleros, froidement abattu par un vieux Portugais… pour avoir dérobé une noix de coco :
Un jour, lorsqu'il constata qu'une noix manquait, il sourit simplement. Chef, si vous l'aviez vu entrer en colère, je crois que mes cousins et moi, on se serait méfié… Mais non, il avait l'air si content. Alors nous sommes revenus la nuit. […] Il s'est approché de mon cousin, le petit Antonio, a braqué sa torche sur lui et l'a tué. Antonio est tombé à ses pieds, et avant qu'il ne recharge son fusil, nous nous sommes sauvés. Toute la nuit, nous l'avons entendu rire (W, p. 133).
Mais l'horreur culmine dans la phase finale du roman, lors de l'assaut donné à Wirriyamu par les troupes du commandant d'Arriaga lancées à la recherche d'Augustinho, enlevé par les maquisards. Ici, pas de quartier. A la chicotte et aux coups de règles sur les doigts succèdent sans relâche les tortures les plus révoltantes qui n'épargnent ni les vieillards et les femmes — Kélani, Ondo et Maria en seront les victimes toutes désignées — ni les enfants, ni même les bébés, comme on le voit dans l'épisode du viol de Liza et celui du « bébé torturé » que veille le père Fidel au cours de la « nuit d'enfer » du village martyr. Massacre abominable, si l'on en croit l'un des témoins, le chef des guérilleros :
Aidés de quatre soldats portugais que nous avons capturés, nous avons passé toute la matinée à enterrer. Aucun de nous n'a eu le courage de dénombrer les morts. Il n'y avait aucun survivant. Je n'ai cessé de vomir, ainsi que mes compagnons, au spectacle de ces enfants aux os brisés, de fillettes étranglées et violées, de femmes en grossesse éventrées, d'hommes dépecés ou crucifiés, de bébés torturés (W, p. 192).
La crucifixion, à laquelle il est fait allusion ici, joue en effet un rôle fondamental dans ce village de Wirriyamu qui est à la fois l'Enfer, la Sodome et Gomorrhe, et le Golgotha des Écritures. La figure de l'albinos y occupe une place centrale, celle par excellence de la victime propitiatoire destinée à périr sous le couteau du sacrificateur. Dans cette séquence, légendes païennes et légendes bibliques se rejoignent avec, au demeurant, des significations différentes, puisque l'albinos y apparaît tantôt comme un porte-bonheur, tantôt comme un doublet de la figure christique :
On raconte, confie le vieil Ondo à Kabalango, que le sang d'un albinos mélangé à certaines herbes donne la puissance. Lorsque j'étais tout petit, mon père fit venir un jour, devant notre case, un albinos ligoté. Deux nuits durant, nous avons tous dansé de joie. La troisième nuit, en ma présence et avec application, il égorgea l'albinos au-dessus d'une énorme calebasse… Après il me lava le visage de son sang et fit de même pour tous mes autres frères. Il s'en enduisit lui-même la figure et les bras avant d'en offrir au fétiche de la famille. Je grandis avec la tranquille assurance d'être désormais protégé du mauvais sort, et même quand j'eus l'immense avantage d'être promu assimilado, je n'y vis que le Signe heureux du sang de l'albinos sacrifié (W, p. 81).
On relèvera, au passage, comme nous l'avons précédemment indiqué, que l'origine de cette croyance est à rechercher, si l'on en croit le romancier, non dans des pratiques rituelles africaines, qu'il serait alors commode de qualifier de « barbares », mais bien plutôt dans des superstitions introduites et encouragées par les Portugais :
Après de longs mois de recherche, j'ai acquis la certitude qu'elle avait été introduite ou encouragée par les Portugais car l'un de leurs premiers administrateurs, il y a de cela bien longtemps, assiégé par une de nos tribus en révolte, ne dut sa survie qu'au sang d'un albinos. Il paraît qu'il aurait fait le mort, après l'avoir lui-même tué et s'être couvert de son sang. Peu de temps après, il devait être nommé gouverneur de toute la colonie (W, p. 82).
En ce qui concerne l'autre albinos, Condélo, on sait qu'après avoir échappé à la traque d'Amigo, il sera finalement crucifié par les soldats du commandant d'Arriaga. Sa mort, ou plus exactement la forme que revêt cette mort, ne surprend pas le lecteur. Elle était en quelque sorte préfigurée dès les premières pages du roman, lorsque nous avons pris contact avec le personnage enchaîné à un arbre sur la place de Wirriyamu. Condélo trouve en effet sa place aux côtés d'autres personnages que nous avons déjà rencontrés, Monsieur Baly, François le lépreux, à un moindre degré Mohamed le vieil aveugle, dans les rangs de ce que nous avons appelé des figures christiques. Par cette expression, nous voulons désigner des personnages pour qui, d'une manière délibérée ou inconsciente, la figure du Christ fonctionne comme un modèle de conduite. Un Christ auquel, au reste, il est fait référence de manière récurrente dans plusieurs romans de Sassine, en particulier Saint Monsieur Baly et Wirriyamu. Ainsi, lorsque Kabalango rend visite au père Fidel dans sa propre maison, la première chose qu'il aperçoit au mur c'est un Christ qui, nous dit le narrateur,
n'en finissait pas d'agoniser, [et] que les doigts malhabiles d'un menuisier avaient rendu encore plus torturé en remplissant son corps et sa tête de bosses et de creux (W, p. 56).
Quant à Monsieur Baly, dont l'aspiration à la Passion est évidente, il serait plus juste de dire qu'il n'en finit pas de gravir son Golgotha, afin, comme il le confesse lui-même, de recevoir enfin de Dieu, comme Lui, le pouvoir de faire trembler la terre, d'accomplir des miracles en son nom, afin de faire cesser le scandale (W, p. 156).
Nous reviendrons évidemment sur le personnage exemplaire de Monsieur Baly dans le chapitre consacré aux figures mythologiques.
Resteraient à évoquer ici deux personnages mineurs de Wirriyamu qui, par leur comportement dans le cours
du roman font également preuve d'un bel esprit de sacrifice. Il s'agit d'une part de l'un des maquisards, Henrické qui, afin de préserver la vie de leur otage, que menaçait un serpent venimeux, prend le risque, mortel, d'en écarter Augustinho. Quant à ce dernier, jeune intellectuel converti aux idées libérales, en dépit du sang des d'Arriaga qui coule dans ses veines, il tente désespérément de s'interposer entre les guérilleros et le détachement portugais commandé par son père, et il meurt également, victime d'une tragique méprise :
Peut-être qu'il avait l'intention d'intervenir auprès de son père afin de faire cesser le combat, lorsque soudain il se mit à courir en direction de ses compatriotes. Ils l'ont abattu, croyant avoir affaire à l'un des nôtres… (W, p. 192).
« Chaque pays a ses bourreaux, ses salles de torture, d'humiliation » (W, p. 165), observe le capitaine David, l'un des personnages secondaires de Wirriyamu, qui sait de quoi il parle. Le lecteur n'est donc pas étonné de retrouver dans les deux derniers romans de Sassine la dichotomie déjà esquissée entre le monde des bourreaux et celui des victimes. Plus encore que dans les oeuvres précédentes, cette coupure entre les deux univers se trouve clairement indiquée dans la structure même du Jeune Homme de sable qui juxtapose, symboliquement, à une première partie intitulée “Le lion”, une seconde qui a pour titre “Le mouton”, et une troisième et dernière qui voit le retour de “La lionne”.
Dans cette oeuvre de dénonciation du pouvoir néocolonial, la dimension proprement politique paraît plus importante que dans les oeuvres précédentes, et elle met en scène des personnages pour lesquels, nous l'avons vu, l'exercice du pouvoir se confond avec celui de la violence. Dans une atmosphère de cauchemar quasi permanente, où les fragments du réel ne se distinguent pas toujours des séquences oniriques, le lecteur a le sentiment d'assister à un interminable procès qui n'est pas sans rappeler l'oeuvre éponyme de Kafka, ou, plus près de nous, l'inquiétant climat de délation et d'auto-accusation qui a prévalu lors des procès staliniens. Arrestations, incarcérations, interrogatoires conduits par « l'homme-au-carnet », tortures, exécutions sommaires etc., paraissent en effet alterner tant dans les rêves du héros, Oumarou, que dans les péripéties dramatiques qui ponctuent le roman.
La liste est longue, mais elle néglige toutes les victimes anonymes entrevues, l'espace d'un éclair… Était-ce pour de bon, ou bien tout cela se passait-il dans l'imagination malade du héros ? Le petit vieux avec ses anneaux passés dans des lèvres sanguinolentes, comme un animal captif, le mendiant à la poitrine flagellée, la femme violée, l'homme au grand boubou et aux amulettes … et tous ces cadavres qui roulent au pied de l'estrade où officient les bourreaux !
A l'hôpital, « à l'étage des pauvres », des moribonds sans soins agonisent longuement, avant d'entrer en décomposition, tandis qu'à côté, en un lieu qui n'est jamais nommé autrement que « la prison », Oumarou affronte la réalité de son cauchemar et n'est pas loin, suprême ironie, d'acquiescer aux « raisons » de ses tortionnaires :
Ils m'ont tellement frappé, interrogé, insulté, humilié, que j'ai l'impression qu'habite dans mon crâne un esprit étranger, impitoyable et éloquent, se nourrissant de leurs fausses preuves (JHS, p. 140).
A la différence des trois premiers ouvrages, Le Zéhéros n'est pas n'importe qui s'inspire explicitement de la réalité politique de la Guinée, décrite pendant la période qui a suivi la mort du président Sékou Touré. Dans ce roman, le réelle dispute donc largement à la fiction puisque, comme nous l'avons indiqué précédemment, Sassine évoque ici vingt-cinq années du règne de l'un des plus féroces dictateurs de l'Afrique postcoloniale. Une dictature qui l'avait d'ailleurs conduit lui-même à l'exil, en faisant, à l'instar de son héros Camara, l'un de ces nombreux « Guinéens de l'extérieur » qui sont rentrés au pays au lendemain de la mort du tyran :
Mon frère et moi avions grandi comme ces plantes grimpantes qui se collent à tout ce qu'elles rencontrent. Savait-il, lui, du fond de l'Europe, qu'il était désormais possible de rêver à un retour au pays natal ? (Z, p. 77)
A la mort de son leader historique, la Guinée était exsangue — économie ruinée, infrastructures délabrées — tandis que le peuple se remettait lentement et difficilement de vingt-cinq années d'une terreur sans précédent dans l'histoire africaine contemporaine.
L'après-Sékou, pour Camara, au moment même où il
pose le pied sur le sol guinéen, c'est d'abord la pagaille indescriptible de l'aéroport, une pagaille en grande partie imputable à la persistance des tracasseries policières de l'ancien régime. Au fonctionnaire zélé qui lui demande s'il a du« vrai argent » (c'est-à-dire des devises), Camara répond en effet : « Attention, je ne suis pas n'importe qui. La Guinée a changé, mais pas certains Guinéens. »
Cette première impression va se trouver largement confirmée tout au long du périple qu'accomplit le héros et qui va le conduire de la capitale, Conakry, à sa ville natale, Kankan, en Haute-Guinée. En effet, si le PDG est bien mort — bien que certains restent sceptiques sur ce sujet — son souvenir et le souvenir de ses crimes continuent de hanter les imaginations. A tel point que lorsque Camara, après avoir un peu forcé sur le whisky, se lance dans une parodie des discours du « Guide bien-aimé », son propos est immédiatement suivi par le départ feutré de plusieurs candidats à l'exil :
Peuple de Guinée, mon peuple… Une vie finit, une vie commence. Je vous disais encore que j'étais l'incarnation du peuple. Vous n'avez pas compris. Un peuple ne meurt pas. C'est pourquoi j'ai fait le mort pour connaître les vivants. Vous n'avez pas su faire montre de fidélité. Tant pis pour vous. Les traîtres sont démasqués… Déjà, entre les cases, se faufilaient de fragiles silhouettes surmontées de baluchons. De nouveaux exilés (Z, p.146-147).
La mémoire du tyran survit donc, vivace, à la fois à travers le rappel de la chronique de son règne — évoquée çà et là par les survivants qui se souviennent — mais elle se traduit également par le climat de malaise et de mauvaise conscience dans lequel semble baigner la Guinée toute entière.
Au cours d'une conversation avec ses amis français, Camara évoque ainsi la pratique des pendaisons publiques qui, on le sait, marquèrent à plusieurs reprises — notamment au moment de « l'affaire du 22 novembre 17 » — les temps forts de la terreur établie par le président Sékou Touré :
Est-ce que tu sais que les photos des pendus du PDG faisaient des ombres ? J'ai vu des photos. Sékou ne l'a peut-être jamais remarqué. Sinon… (Z, p. 130).
Un peu plus tard, alors qu'il traverse Conakry dans la limousine de l'ambassade de Chine, provisoirement reconvertie en banal taxi, le héros passe en revue, comme autant de « stations » de la Passion du peuple guinéen, les hauts lieux de souffrance et de torture de la ville,
le lycée de Donka, l'hôpital de Donka, le Camp Boiro […] le pont de la honte où l'on a pendu Barry 3 et les autres, et voici le fameux palais du peuple construit pas les chinois (Z, p. 130).
Quant au tristement célèbre Camp Boiro, il revit dans les conversations des anciens détenus : « ce qu'ils racontaient m'empêchait de dormir », confie le narrateur.
A Kankan, sa ville natale, Camara aura d'ailleurs l'occasion de faire des cauchemars au récit de l'un de ses anciens camarades Taram, qui confie :
J'ai fait quelques jours ici à kankan avant qu'on me transfere à Boiro. Le lendemain ils m'ont ligoté dans le dos au point que mes omoplates se touchaient et m'ont fait agenouiller sur un tas de tessons de bouteilles, face à un mur. Quelqu'un est passé derrière moi et m'a brutalement serré les joues pour faire sortir ma langue sur laquelle on brancha des pincettes reliées à une batterie. A un signal je sentis mon crâne éclater. […] Deux semaines après mon arrestation, une foule de femmes a pu s'approcher de notre mort pour crier « A bas les traîtres, pendez-les par les couilles ! » […] Et ce n'est pas tout, petit frère. On ne savait toujours pas si on était condamnés à mort ou non. On pêchait de temps en temps parmi nous des gens qui disparaissaient, mais çà c'était la pêche. Quand tu jettes ta ligne, tu n'appelles pas ton poisson (Z, p. 183-185).
Pour beaucoup, le seul refuge contre le souvenir de cette horreur réside dans les paradis artificiels, et en particulier l'alcool, qui permet d'écarter des images persistantes et douloureuses :
« Si on ne buvait pas pour oublier, il faudrait un procès de Nuremberg.»
Mais en dépit de cette fuite en avant, le spectre du tyran mort continue de hanter les esprits, et l'on pourrait presque dire qu'il façonne tous les propos et modèle tous les comportements des personnages mis en scène par Sassine dans Le Zéhéros n'est pas n'importe qui. Ainsi, même la phrase-leitmotiv qui traduit l'entrée dans les temps nouveaux — « nous sommes libres maintenant » — est généralement « chuchotée » à l'oreille de l'interlocuteur, comme par crainte d'une délation dont l'habitude semble perdurer.
C'est sans doute cela, l'engrenage de la violence dans un pays où le poison du totalitarisme infecte désormais tout le monde, bourreaux et victimes confondus dans le même amalgame d'une mauvaise conscience qui, à la limite, suprême ironie, se transforme en « bonne conscience » :
Nous avons tous la conscience tranquille, commente l'un des personnages, parce que je ne connais personne qui n'ait au moins une fois volé, menti, trahi ou tué sous le règne du PDG. Aujourd'hui il n'y a que les morts qui pourraient nous juger, et encore pas tous (Z, p. 161).
On assiste alors aux retournements de vestes stratégiques :
« [P]resque tous ceux qui lui [Sékou] jettent la pierre aujourd'hui mangeaient dans sa main avant-hier et le pleuraient hier » (Z, p. 138).
Encore que certains ne paraissent pas encore s'être avisés que les beaux jours de la terreur sont révolus :
Entrèrent l'ex-président du comité et son épouse, plus le secrétaire de l'ex-comité, plus encore deux autres qui n'avaient jamais été ni présidents ni secrétaires. Des ex-miliciens ou électeurs probablement. Ils étaient tous de blanc vêtus, à la mode du PDG. Ou ils ignoraient que le régime avait changé ou ils croyaient que l'uniforme militaire est blanc (Z, p. 209).
L'heure est en effet aux rancoeurs, et même les chiens ont d'anciens comptes à régler, tel cet« Allah est grand » (c'est son nom) qui profitera d'une panne d'électricité pour mordre Mouloukou, un ex-milicien qui s'était illustré naguère en arrêtant des chiens coupables d'avoir perturbé un défilé…
Certes les temps ont changé — « il n'y a presque plus d'enterrements », admet le chauffeur du car des pompes
funèbres — mais c'est aussitôt pour recommander la
prudence à Camara qui parle trop :
« Fais attention, mon frère. Tu parles trop et l'ancien régime n'a pas encore perdu le pouvoir» (Z, p. 152).
Et, comme pour corroborer ses propos et lui donner raison, Camara a tout loisir d'observer, avant son départ de Kankan, que ses moindres faits et gestes sont épiés par deux personnages à l'allure sinistre, « les deux coms » (l'ancien commissaire de police et un comptable, tous deux ex-pédégé) vis-à-vis desquels ses amis lui recommandent la plus grande prudence :
[N]e les prends pas pour des imbéciles, recommença « Gros Bois » à mon oreille. Tous deux ont enterré plus de gens que dix assassins (2, p. 219) 18.
Au moment de quitter la Guinée, Williams Sassine, alias Camara, même si le propos l'irrite, ne peut donc que donner raison au Blanc qui, au bar de l'hôtel Indépendance, formule l'opinion commune :
« [V]ous vous croyez libre, mais vos bourreaux se pavanent partout.»
A travers le monologue du héros, dressant le bilan de son séjour en Guinée, la clausule du roman exprime donc l'amertume du romancier conscient que, peut-être, le rideau n'est pas entièrement retombé sur la tragédie qui n'en finit pas d'opposer le bourreau à sa victime :
Pour chaque raison de l'aimer [le PDG] je trouvais deux Guinéens tués inutilement. J'allumai une cigarette et regardai la pluie laver mon pays. Il en avait besoin.
Notes
1. Bernard Dadié, « Chaînes », dans Hommes de tous les continents, (Paris, Présence africaine, 1967).
2. Pendant son exil, Williams Sassine a effectivement passé plusieurs années à Niamey avant d'être nommé au lycée de Nouakchott.
3. Williams Sassine, Saint Monsieur Baly (Paris, Présence africaine, 1973; ici abrégé SMB), p. 137.
4. Williams Sassine, Le Jeune Homme de sable (Paris, Présence africaine, 1979; ici abrégé JHS), p. 13.
5. On reconnaît ici le thème dont s'est inspirée la romancière sénégalaise Aminata Sow Fall pour son roman La Grève des Battu. En décidant la grève de l'aumône (en wolof le mot battu désigne la calebasse
destinée à recevoir l'obole), les mendiants de « la Ville » placent les croyants devant une situation sans précédent.
6. Henri Lopès, Le Pleurer-Rire (Paris, Présence africaine, 1982).
7. Mody Cissoko, “La royauté chez les Mandingues occidentaux d'après leurs traditions orales”, Bulletin de l'IFAN, vol. XXV, avr. 1969.
8. Alioum Fantouré, Le Récit du cirque de la vallée des morts (Paris, Buchet-Chastel, 1976).
9. Bernard Nanga, Les Chauve-souris (Paris, Présence africaine, 1980), p. 19.
10. Ahmadou Kourouma, Les Soleils des indépendances (Paris, Éd. du Seuil, 1970), p. 181. — On se souvient que ce roman avait remporté le prix de la revue Études françaises et qu'il a d'abord été publié aux Presses de l'Université de Montréal. (N.D.E.)
11. Williams Sassine, Le Zéhéros n'est pas n'importe qui (Paris, Présence africaine, 1985; ici abrégé Z), p. 123.
12. « Mais quel coup de tonnerre, soudain que celui de Frobénius ! s'exclame Léopold Senghor.[…] Toute l'histoire et toute la préhistoire de l'Afrique en furent illuminées — jusque dans leurs profondeurs. Et nous portons encore, dans notre esprit et dans notre âme, les marques du Maître, comme des tatouages exécutés aux cérémonies d'initiation dans le bois sacré. » (“Les leçons de Léo Frobénius” [1973]. dans Liberté 3, Paris, Seuil, 1977.)
13. Cité par Eike Haberland, Léo Frobénius : une anthologie (Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1973).
14. Georges Ngal, Giambatista Viko, ou le Viol du discours africain (Lumumbashi, Ed. Alpha·Oméga, 1975 ; rééd. Hatier, 1984).
15. Georges Ngal, Giambatista Viko… id. , p. 91-92.
16. Allusion au chanteur Enrico Macias et à Francisco Macias Nguema, l'ancien président de la Guinée équatoriale, renversé en 1979 après dix ans de dictature sanglante.
17. Le 22 novembre 1970, une poignée d'émigrés guinéens avaient tenté de renverser le régime de Conakry avec l'aide de militaires portugais basés en Guinée-Bissau, et chargés de liquider Amilcar Cabral, à
qui Sekou Touré avait accordé l'asile. Ce coup d'état manqué donne lieu, à partir de 1971, à une série de procès politiques assortis de ces « confessions » radiophoniques qu'évoque Sassine dans son roman.
18. Cette réflexion de Camara fait écho aux propos de Kabalango célébrant dans Wirriyamu les vertus apaisantes et purificatrices de la pluie (cf p. 34).