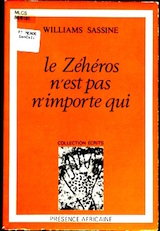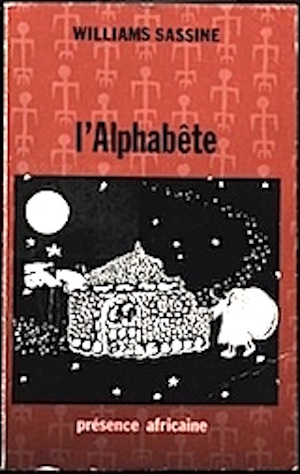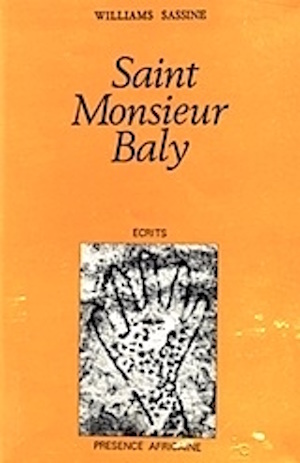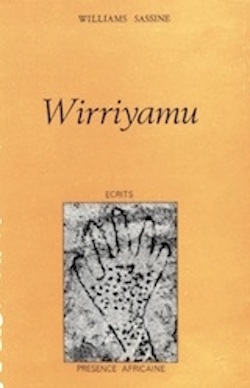Jacques Chevrier
Williams Sassine, écrivain de la marginalité
Editions du Cerf. Toronto. 1995. 335 pages. Collection L'un pour l'autre, n° 2
Chapitre Deux
La vision de l'époque coloniale : Wirriyamu
Écrivain de la seconde génération, Williams Sassine inscrit l'essentiel de son oeuvre romanesque dans la période contemporaine, postérieure aux années soixante, date de l'indépendance pour la plupart des états africains, francophones et anglophones. On sait toutefois que dans le cas des anciennes « provinces d'outre-mer » détenues par le Portugal, cette indépendance, durement acquise par les armes, a été plus tardive.
En choisissant de situer l'action de son second roman, Wirriyamu, dans une colonie lusitanienne imaginaire, mais qui, par bien des traits, s'apparente à la Guinée-Bissau, à l'Angola et au Mozambique, le romancier consacre une part importante de son oeuvre à l'évocation et à la dénonciation du système colonial. Wirriyamu constitue à cet égard un inventaire sans complaisance des procédures d'exploitation, d'oppression et de dépersonnalisation mises en pratique par le gouvernement de Lisbonne.
De tous les textes romanesques de Williams Sassine publiés à ce jour, Wirriyamu, édité en 1976, est le seul dont l'action se situe encore à l'époque coloniale, dans un pays qui n'est jamais nommé, mais dont nous apprenons, dès la page 13, qu'il s'agit d'un territoire sous domination portugaise. Le héros de ce roman, Kabalango — qui n'est d'ailleurs désigné, pour lors, que par le pronom personnel « il » — nous est en effet présenté comme un écrivain déprimé (plusieurs maisons d'édition européennes ont refusé ses manuscrits), malade (une toux sèche déchire sa poitrine et il crache du sang) et qui rentre dans son village natal avec l'intention déclarée d'y mourir :
Dans quatre jours le camion de transport hebdomadaire passerait, traverserait un morceau de cette colonie portugaise pour le déposer à la frontière 1.
Un certain nombre d'indices pourraient laisser supposer
que « cette colonie portugaise » désigne la Guinée-Bissau, frontalière de la République de Guinée, d'où est originaire le romancier. Ainsi y est-il question à plusieurs reprises d'un pont qui a été emporté par la crue de la rivière, grossie par des pluies diluviennes : « la rivière avait débordé et emporté le pont » ( W, p. 30). Il pourrait alors s'agir du Rio Corubal ou du Rio Compony, qui délimitent la partie nord-ouest de la Guinée et de la zone de contact Guinée-Guinée-Bissau.
Une seconde hypothèse consisterait à voir dans « cette colonie portugaise » l'Angola, province située plus au sud et frontalière du Zaïre et du Congo, dont la sépare le fleuve Zaïre. Toutefois, l'impétuosité et la largeur du fleuve, qui aborde ici la dernière phase de son cours avant l'estuaire, interdisent d'imaginer le moindre pont permettant le passage d'une rive à l'autre…
On doit donc estimer que Sassine a procédé ici à une contamination des caractéristiques propres à chacun des deux pays qui, au demeurant, présentent de nombreuses ressemblances en raison même du système colonial auquel ils étaient l'un et l'autre assujettis, et dont nous allons tenter de dégager quelques-unes des caractéristiques.
Le pillage colonial
Au moment où débute le roman, Wirriyamu apparaît marqué du sceau d'un inexorable déclin : le village est « réduit à une dizaine de cases habitées par des vieillards ».
Cette décadence n'est pas sans renvoyer cependant à une période antérieure au cours de laquelle la colonie connut une grande prospérité :
Il n'y avait pas très longtemps encore que ce village était plein de chiens. C'était au temps où tout florissait à merveille : le commerce du caoutchouc et avant, celui des esclaves et des défenses d'ivoire (W, p. 18).
Avec la chute des cours du caoutchouc, « le village fut peu à peu abandonné » (W, p. 19), mais Wirriyamu et ses environs devaient connaître un regain de prospérité, minière et industrielle, cette fois, avec la découverte de pierres précieuses dans son sous-sol et l'irruption brutale des « prospecteurs de la Compagnie des Diamants » : Wirriyamu était alors « une ville comme il faut » (W, p. 49).
Il semble qu'une fois la fièvre du diamant retombée, rien n'ait été en mesure d'enrayer l'irrémédiable déclin de Wirriyamu, pas même les efforts des militaires portugais pour « aider certains colons à s'implanter » et à développer l'agriculture locale. C'est donc un petit village exsangue, « agonisant », que découvre Kabalango dans « cette colonie oubliée, avec des hommes perdus » (W, p. 65).
Le chef des guérilleros, originaire d'une autre région que Wirriyamu, corrobore cette analyse et complète le tableau de l'exploitation coloniale dont il a été le témoin. Il évoque en particulier un phénomène souvent décrit par les romanciers de la première génération — on songe entre autres à Mongo Beti —, celui de la fixation arbitraire des cours des matières premières offerts par l'administration coloniale aux paysans noirs :
Par exemple, explique-t-il, tandis que le kilo de haricots des Blancs était pris à cinq escudos, le nôtre ne valait que trois escudos et demi (W, p. 161).
Découragés et condamnés à la misère par un système aussi inique, beaucoup de paysans ruinés furent contraints d'aller travailler dans les mines d'Afrique du Sud. La plupart y moururent. « Ceux qui en reviennent ne sont plus bons à rien » (W, p. 161). Raison de plus pour l'administration d'accentuer sa pression et de procéder, par la voie de l'expropriation, à une dépossession systématique des Noirs :
Ceux qui possédaient de bonnes maisons de pierre ont été expulsés pour laisser la place aux colonialistes et contraints de vivre à l'écart dans une seule pièce. Toutes les terres fertiles ont été distribuées aux colons, sans aucune compensation pour les expropriés. Les Noirs n'ont le droit de travailler que des sols arides et infertiles (W, p. 161).
Cette dépossession matérielle des biens de production ne constitue pourtant que l'aspect le plus anodin, si l'on peut s'exprimer ainsi, de la présence portugaise en Afrique. Le régime dictatorial installé à Lisbonne devait en effet avoir les conséquences les plus fâcheuses pour ses« provinces d'outre-mer» soumises à la dure loi d'une armée d'occupation.
L'oppression : le fascisme portugais et ses séquelles
Un double spectacle attend le héros au moment même où il pénètre dans Wirriyamu : d'une part la vision d'un homme enchaîné par une corde nouée à sa cheville, d'autre part celle d'un chien pendu et torturé par un personnage qui répond au nom d'Amigo :
L'animal griffa l'air, gigota vigoureusement, se tordit et d'un seul coup urina. Lorsque le corps s'immobilisa, Amigo noua la corde autour de l'arbre (W, p. 16).
Seul citoyen portugais demeuré au village après le massacre de sa famille, massacre consécutif à une révolte des ouvriers agricoles, ce personnage qui se distingue par sa cruauté — à son cou pend un collier composé des canines de trois hommes qu'il a exécutés de sa propre main — incarne et symbolise, à lui seul, l'omniprésence du système colonial portugais. Un système qui se caractérise par sa pérennité, son totalitarisme et sa violence.
Pérennité, car avec les marins de Dieppe, les navigateurs portugais furent les premiers à s'aventurer dans les eaux des côtes occidentales de l'Afrique où, dès le XVe siècle, ils abordèrent aux rivages inhabités des Açores et du Cap Vert, tandis que les premiers forts et les premiers comptoirs s'édifiaient entre Ceuta et l'Angola actuel.
Il n'est donc pas étonnant que Wirriyamu porte dans sa trame de nombreux stigmates de cette colonisation, l'une des plus longues dont la mémoire collective conserve la trace. Le commandant d'Arriaga ne se fait d'ailleurs pas faute de rappeler à ses interlocuteurs que les Portugais sont arrivés « voici cinq cents ans pour répandre la civilisation, la clarté, l'efficacité » (W, p. 31), avant d'ajouter, cyniquement « si nous n'étions pas venus, vous n'auriez pas eu le temps de descendre des arbres » (W, p. 32). Le représentant du gouvernement de Lisbonne s'enorgueillit, au demeurant, d'appartenir à un « peuple de croisés méconnus qui, au mépris du bonheur de ses enfants, apporte encore la Lumière et le Salut dans la chrétienté, partout où règne la sauvagerie » (W, p. 73) ; et il justifie a posteriori la colonisation par l'état d'anarchie et de guerres tribales permanentes dans lequel se complaisaient, selon lui, les premiers occupants des colonies portugaises.
Aux yeux de ce soldat fanatique, la mission « civilisatrice » de sa patrie paraît excuser, voire justifier, toutes les exactions qui pourraient être commises en son nom. Le totalitarisme qu'incarne le commandant d'Arriaga, et qu'il met en pratique dans Wirriyamu, n'y va pas en effet par quatre chemins. L'oppression est partout et toujours présente, et elle se manifeste en particulier par l'exercice d'une terreur dont les villageois de Wirriyamu font le dur apprentissage. A défaut d'exterminer tous les nègres, solution évidemment la plus simple à laquelle rêve incidemment le commandant d'Arriaga, il s'emploie, par la torture comme par la chicotte, à les punir… pour le salut de leur âme. « C'est justement pour ne pas qu'ils sombrent entièrement dans l'animalité que nous sommes ici », fait-il observer à l'un de ses subalternes, Pedro, le secrétaire administratif, dont il juge les prestations punitives parfaitement insuffisantes. Prêchant l'exemple, le commandant décide donc de « faire parler » un vieux « soba »,un vieux chef indigène, soupçonné de couvrir les activités des guérilleros. La méthode ? Le supplice, savamment dosé, de la règle sur les doigts :
Il commença à frapper. Au début, ça faisait un petit bruit sec, mais lorsque les ongles furent bien écrasés, le son devint plus mou, comme un linge mouillé qu'on frappe. Le sang se dispersait en gouttelettes et sautait au complet blanc du secrétaire. […] Le Commandant s'arrêta un moment… Il entraîna le secrétaire dans le bureau: « il parlera, ne t'en fais pas, lui dit-il … Il suffit de laisser la plaie se rafraîchir un peu pour taper à nouveau dessus. Alors la douleur devient intolérable. » […] Dès que le vieux « soba » les revit, il tressaillit. Ses doigts avaient doublé de volume. Il les tendit à nouveau. Le Commandant d' Arriaga leva la règle et frappa de toutes ses forces. D'un coup, elle éplucha les doigts de la chair hachée […] (W, p. 102-103)·
D'Arriaga et ses sbires ne s'en tiendront pourtant pas là, et Wirriyamu nous offre une impressionnante palette des différentes méthodes mises en oeuvre par les militaires et les services de sécurité du gouvernement de Lisbonne. Ainsi, toujours pour « faire parler » de malheureux villageois, au demeurant innocents, n'hésite-t-on pas à les rouer de coups — c'est ce qui arrive à Kélani — à leur entourer les mains, liées au préalable, d'une brassée de feuilles sèches, qu'il suffit ensuite d'approcher d'une allumette enflammée — c'est le sort réservé au petit Chakupa, le fils de Kélani — ou encore, d'une manière plus expéditive, à pratiquer la décollation, ainsi qu'il advient au vieil Ondo :
Personne ne saura faire parler Wirriyamu, hurla le vieil Ondo, pendant que ses bourreaux le forçaient à rester agenouillé. Il essaya de lever la tête pour voir le Commandant d'Arriaga, mais d'un coup sec le gros officier portugais abattit la machette sur sa nuque. Il frappa à nouveau et enfin la tête se détacha du corps et tomba dans la boue. Le tronc gigota, se tordit quelques instants, semblable à un morceau de serpent.
Américano éclata de rire… (W, p. 152-153).
Puisqu'à Wirriyamu « on ne parle pas », il faut franchir un degré de plus dans la répression et l'horreur. Ce sera chose faite, quelques heures plus tard, avec le double meurtre, assaisonné d'un double viol perpétré sur Maria, la bonne de l'hôtel La Calebasse d'or, puis sur sa fillette, Liza :
Une fillette accourut, mais un soldat l'arrêta et après quelques instants d'hésitation l'entraîna derrière un arbre. […] Le soldat réapparut, tenant d'une main son pantalon et traînant de l'autre, par les pieds, la fillette. Il la jeta dans la fosse sur le corps de Maria, sa mère (W, p. 179).
Enfin, comble d'atrocité, on croit comprendre que les derniers survivants de Wirriyamu, qui comptait cinquante-quatre habitants, dont vingt-et-un enfants et quinze femmes, périront brûlés vifs dans la chapelle du village : « Il n'est plus question de laisser derrière nous le plus petit témoin» (W, p. 185), devait en effet déclarer le commandant d'Arriaga…
Ces exactions, qui relèvent apparemment davantage de la réalité que de la fiction, ont pour toile de fond historique le Portugal du président Salazar, auquel Sassine fait ici de nombreuses références. Installés, comme on l'a vu, en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau depuis la fin du XVe siècle, les Portugais commencent à ressentir le contre-coup de la décolonisation, quasi générale dans tout le reste du continent à l'exception de l'Afrique australe, depuis les années soixante. C'est en effet en 1961 qu'éclatèrent les premières insurrections en Angola, bientôt suivies par celles de la Guinée, en 1963, puis du Mozambique en 1964. Si, à la suite de ces soulèvements, le mouvement de protestation aboutit à quelques réformes (abolition du code de l'indigénat et du travail obligatoire, octroi de la nationalité portugaise aux Africains des « provinces d'outre-mer »), la réalité quotidienne, on le verra plus avant, demeura, pour l'essentiel, inchangée. Les atermoiements du Portugal salazariste, qui s'était obstinément et délibérément placé en dehors de la communauté internationale en refusant à l'ONU tout débat sur ses territoires africains, devaient naturellement aboutir à une intensification de la guérilla dont Wirriyamu se fait l'écho.
Qu'il s'agisse du MPLA (Mouvement populaire de libération de l'Angola), du FNLA (Front national de libération de l'Angola), puis de l'UNITA (Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola) en Angola, ou du PAIGC (Parti africain de l'indépendance de la Guinée et des Îles du Cap-Vert) d'Amilcar Cabral en Guinée-Bissau, les mouvements d'insurrection se sont progressivement renforcés à partir de 1960, jusqu'à contrôler une bonne partie des territoires occupés par les Portugais, comme ce fut le cas du parti d'Amilcar Cabral qui, au moment de l'assassinat de son leader, en 1973, avait libéré près de 50 % de la Guinée.
Il est donc naturel de retrouver dans Wirriyamu tous les éléments du puzzle lusitano-africain. D'un côté, le commandant d'Arriaga, qui incarne le conservatisme portugais, de l'autre les guérilleros de la forêt qui s'y opposent par les armes, et s'inscrivent dans une logique de libération des peuples opprimés. Les enjeux sont clairement définis à partir d'un recueil de citations exprimant « les pensées lumineuses de grands hommes du Portugal » (W, p. 146), recueil qui ne quitte jamais la poche arrière du commandant d'Arriaga et dont Sassine nous donne un a perçu significatif. S'y côtoient des théoriciens de la fin du siècle dernier — tel le délégué portugais au VIe Congrès international de géographie de Londres, en 1895 — et des politiciens contemporains de l'époque à laquelle se situe Wirriyamu, Salazar, Marcelo Caetano, etc. Au premier qui proclame« L'unité de la nation portugaise ne comporte ni aliénations, ni cessions, car il ne saurait y avoir de nationalisme qui ne soit portugais », répond en écho le second affirmant « Tout ce qui touche à nos territoires est une affaire purement intérieure » (W, p. 147).
On sait qu'en 1968, Salazar, malade, avait dû céder la place à Marcelo Caetano à la tête du gouvernement qui, dans le souci de se donner une image plus libérale, entreprit, à travers la nouvelle Constitution de 1971, d'accorder aux trois « provinces » (Angola, Mozambique et Guinée-Bissau) une plus grande autonomie économique, dans le temps même où elle augmentait le nombre des représentants africains à l'Assemblée nationale. Réformes qui ne furent pas du goût des conservateurs, au nombre desquels se range le commandant d'Arriaga qui évoque
Lisbonne qui voulait maintenant faire les choses en douce ; parce que là-bas on craignait de plus en plus en plus les imbéciles qui commençaient à remplir le monde de leurs cris « Au scandale », et à qui avaient tenté de donner raison certains officiers insensés — heureusement arrêtés — en se mutinant (W, p. 99).
Cette allusion renvoie-t-elle à la tentative de l'opposition portugaise en exil, conduite par le général Delgado et par son ami Henrique Galvaro, ancien haut-fonctionnaire de l'administration coloniale, député et ami de Salazar, en vue de dénoncer le régime colonial portugais ? Tentative qui, après l'arraisonnement d'un paquebot portugais, le Santa-Maria, devait aboutir à l'assassinat de Delgado, sans doute exécuté par la PIDE, la police secrète du gouvernement de Lisbonne.
Toujours est-il que la police politique portugaise est également évoquée dans le roman par l'intermédiaire d'Augustinho, le fils du commandant d'Arriaga, capturé par les rebelles. Ce personnage évoque en effet avec ses geôliers la figure d'un de ses professeurs, intellectuel humaniste opposé au régime et qui, pour « avoir fait rimer Salazar et bâtard » (W, p. 136), fut arrêté, accusé d'être un agent du communisme… et exécuté par la PIDE.
Il faut noter, à cet égard, l'allusion au sursaut de la répression, consécutive à tous ces troubles, qu'évoque Sassine lorsqu'il décrit le commandant d'Arriaga plus que jamais décidé à renforcer le pouvoir de la métropole sur ses territoires d'outre-mer :
Avant que les rebelles africains ne profitent de la confusion et de l'ébranlement du gouvernement de Lisbonne, désordres nés des contestations de certains officiers portugais, il éprouvait le besoin de l'organiser avec tous les autres colons, pour élever enfin une société puissante et clairvoyante, capable de défendre leurs intérêts et de transformer ce pays en une citadelle de la Civilisation (W, p. 181).
On n'a pas oublié non plus qu'en 1974 éclatait à Lisbonne la « Révolution des oeillets » qui, à la suite d'un coup d'état militaire, devait porter à la tête du Portugal le général Antonio Spinola, lui-même ancien gouverneur militaire de la Guinée-Bissau !
Si l'événement, en lui-même, n'est pas directement évoqué, Wirriyamu se fait en revanche l'écho de la publication, quelques mois avant le coup d'état, d'un ouvrage du général Spinola dans lequel l'ancien gouverneur préconisait la formation d'une Fédération lusitano-africaine, publication à la suite de laquelle il devait être limogé :
Votre Grand Général, commente le chef des guérilleros, alors qu'ils cheminent péniblement en direction de Wirriyamu, a écrit à la première page de son livre, qui a fait beaucoup de bruit à lisbonne, que le Portugal vit sans doute la plus grave crise de son histoire ; parce que Caetano ne veut pas reconnaître qu'il est impossible à votre armée de venir à bout, par la force, de nos combattants. Il a eu bien raison de citer le cas des Etats-Unis au Vietnam (W, p. 123).
La frontière ainsi clairement délimitée entre les forces antagonistes en présence, il faut toutefois rappeler que Sassine a mis en scène dans son roman un personnage qui se situe à la charnière des deux camps, et contribue notoirement à donner des positions portugaises sur ces « provinces » d'outre-mer, une vue plus nuancée. Il s'agit du propre fils du commandant d'Arriaga, enlevé par les guérilleros, et dont le romancier nous brosse un portrait dans lequel la naïveté et l'idéalisme se mêlent à une certaine générosité. Loin d'épouser les vues rétrogrades de son père, le jeune d'Arriaga préfigure, à sa façon, l'aile gauche de la révolution des oeillets, formée par ces « jeunes capitaines » dont beaucoup se réclamaient du marxisme, et qui devaient écarter du pouvoir le général Spinola, peu de temps après le coup d'état d'avril 1974. Bien qu'il s'agisse d'un personnage secondaire, il incarne, semble-t-il, aux yeux du romancier, une certaine forme de libéralisme, au sens que le terme reçoit en Afrique australe.
Augustinho appartient en effet, de par sa naissance, à une famille ultra-conservatrice, très catholique, cela va sans dire, et fortement imbue de sa responsabilité dans la mission civilisatrice du Portugal. Dans la lettre qu'il adresse à son fils pour l'inviter à le rejoindre outre-mer, son père, le commandant d'Arriaga, n'écrit-il pas, sur un ton emphatique et solennel :
(T)u en profiteras pour te rendre compte de la grandeur et de la noblesse de notre mission. Tu verras alors combien notre Sainte Patrie a besoin des bras d'un autre d'Arriaga pour continuer à porter haut l'étendard de la Civilisation (W, p. 74).
Prisonnier et otage des guérilleros, Augustinho se démarque cependant de la tradition familiale, d'abord parce que cette guerre coloniale ne l'intéresse pas, ensuite parce qu'il paraît se rallier au « point de vue du Général Spinola, comme presque tous ceux de sa génération » (W, p. 124). Sa confrontation brutale et inattendue avec la guérilla lui fait cependant franchir, en quelques heures, plusieurs degrés dans la compréhension du phénomène colonial, comme si, au contact de ses ravisseurs, il prenait subitement conscience du sens de leur combat :
[I]l découvrait en eux l'essentiel de l'humanité, qui avait poussé le premier homme à couper le premier arbre pour créer le premier horizon, ligne de volonté de transformation et d'espérance qu'il avait lui-même, en compagnie d'autres camarades étudiants, essayé d'esquisser un jour, en écoutant battre les millions de petits coeurs portugais emprisonnés, à travers des brochures de l'opposition au régime de Caetano (W, p. 125).
Le peu que nous apprenons d'Augustinho nous le rend d'ailleurs a priori sympathique ; n'a-t-il pas, naguère, à l'occasion de l'emprisonnement de l'un de ses professeurs, taxé « d'agent du communisme », accepté de distribuer des tracts réclamant sa libération ? Arrêté par la PIDE, il ne dut son salut qu'aux« relations de son père ».
L'aliénation : un mode d'assimilados
Les Portugais ont toujours refusé l'emploi du terme de colonies pour désigner leurs possessions de Guinée-Bissau, de l'Angola, du Mozambique et des îles du Cap-Vert, leur préférant celui de provinces. Amigo, le seul citoyen portugais vivant à Wirriyamu, le rappelle d'ailleurs à Germain, la compagne du tenancier de La Calebasse d'or: « [C]e pays n'est pas une colonie, mais une province du Portugal » (W, p. 87). Propos corroboré par le commandant d'Arriaga exhortant les villageois de Wirriyamu à dénoncer les guérilleros :
« [I]ls ne sont pas vos frères, car, vous et moi, je le répète, nous sommes tous portugais» (W, p. 132).
Cette théorie se fonde, en grande partie, sur l'argument de la spécificité portugaise, le gouvernement de Lisbonne prétendant qu'à la différence des autres nations européennes, la politique qu'il pratiquait outre-mer avait pour objectif l'assimilation des populations indigènes, une assimilation placée sous le double sceau de l'évangélisation et du métissage biologique.
Les faits, cependant, ont longtemps infirmé les séduisantes constructions de l'esprit développées par Lisbonne, puisque, jusqu'en 1961, date des premières insurrections en Angola, la législation coloniale effectuait une rigoureuse distinction entre colonisateurs et colonisés, les seconds étant astreints, comme nous l'avons déjà relevé, au code restrictif de l'indigénat qui incluait, entre autres, leur assujettissement aux travaux forcés. La Constitution prévoyait toutefois la possibilité d'accès à la citoyenneté portugaise pour les Noirs possédant un certain niveau d'instruction et convertis, naturellement, à la religion catholique. Ils deviennent alors, selon la terminologie officielle, des assimilados.
Dans le roman qui nous occupe, c'est le cas du vieil Ondo, qui raconte à Kabalango dans quelles circonstances il a obtenu cette « promotion » :
Ce sont les Pères Jésuites qui m'ont appris à lire. Il y a longtemps qu'on les a chassés parce qu'ils croyaient un peu trop à l'égalité de tous les hommes. J'y ai cru d'ailleurs, moi aussi, jusqu'à leur expulsion. Mais après, nos maîtres m'ont convaincu assez facilement que l'égalité se mérite par le degré de « civilisation ». Grâce à ma naissance — mon père était un grand « soba » — et à mon instruction, et après m'avoir fait jurer de m'être totalement débarrassé de toutes nos coutumes, je suis devenu un assimilado, c'est-à-dire une espèce de bâtard ayant un peu plus de droits que les autres Noirs, mais beaucoup moins que les Blancs. Je les ai bien exploités, comme les autres Blancs, dans ma plantation qui couvrait plus de quarante hectares (W, p. 80 ; c'est nous qui soulignons).
A ce jeu de l'assimilation, il y a, apparemment, plus à perdre qu'à gagner, car le statut d'assimilado installe l'individu dans une situation de malaise qui n'est pas sans rappeler la problématique dans laquelle est enfermé Samba Diallo, le héros de L'Aventure ambiguë, de Cheikh Hamidou Kane.
On se souvient que la tante de Samba Diallo préconise son retrait de l'école coranique au bénéfice de l'école occidentale, mais que, ce faisant, elle en mesure également les conséquences et les implications :
Je vais vous dire ceci : moi, la Grande Royale, je n'aime pas l'école étrangère. Je la déteste. Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants, cependant. […] [L]'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons avec soin, à juste titre. Peut-être notre souvenir mourra-t-il en eux. Quand ils reviendront, il en est qui ne nous reconnaîtront pas 2.
Ce terme ne sera toutefois pas atteint par le héros qui, lui, envisage cette « métamorphose » avec appréhension et exprime à ses amis parisiens la crainte qu'elle ne s'achève pas, le laissant, indécis, à mi-chemin des deux cultures antagonistes :
Quelquefois la métamorphose ne s'achève même pas, elle nous installe dans l'hybride et nous y laisse. Alors, nous nous cachons, remplis de honte 3.
C'est, toutes proportions gardées, un sentiment identique qu'exprime un autre personnage de Wirrimayu, le vieux Kélani, lorsqu'il retrace pour Kabalango l'itinéraire qui l'a conduit à s'assimiler, ou tout au moins à essayer de s'assimiler :
Il était entré dans un monde de Blancs, comme on entre dans la lumière, émerveillé. Mais un monde avec une infinité de portes fermées. Autant de serrures. Des portes qui ne s'entrebaillaient sur d'immenses richesses qu'avec des mots (W, p. 68).
Tandis que la terre promise demeure un mirage qui se dissout chaque fois que l'on croit l'étreindre, les valeurs du « terroir », elles, s'amenuisent et se recroquevillent à la dimension d'une peau de chagrin :
Pendant qu'il transpirait à ramasser le maximum, l'autre monde qui hantait sa mémoire avec les syllabes chantonnantes et viriles de sa langue maternelle se rétrécissait lentement ( W, p. 68).
C'est donc en prenant conscience de la dépossession progressive de son propre langage que le vieil assimilado mesure le degré d'aliénation où l'a mené la colonisation portugaise, jusqu'à faire de lui cet homme des deux mondes, ce « sol bâtard où poussaient en se gênant les buissons de mots de deux langues» (W, p. 72). Et la question qui se pose inéluctablement au terme d'un tel itinéraire porte évidemment sur son identité propre et sur celle de ses compagnons : « Sommes-nous encore bantous ? », s'interroge Kélani — question à laquelle répond ironiquement, en écho, son beau-frère, Santos : « Nous sommes portugais depuis cinq siècles… » (W, p. 72).
Le malaise qu'expriment aussi bien le vieil Ondo que Kélani est ressenti, de manière plus ou moins diffuse, et plus ou moins consciente, par les quelques personnages qui vivent (ou survivent) à Wirriyamu, après la retombée de la fièvre du diamant. Ainsi Américano, au nom déjà bien symbolique, cherche-t-il désespérément pendant tout le roman un fer à repasser… pour se défriser les cheveux ! Modeste domestique à la ville, où il prétend au statut de « gros fonctionnaire », ce personnage dérisoire n'en exhibe pas moins à chacune de ses apparitions à Wirriyamu les marques les plus spectaculaires de son acculturation : une vieille bicyclette sur laquelle il parade maladroitement, gauchement revêtu d'une veste qui lui « descend jusqu'aux genoux ». Tout petit, nous confie le narrateur, ne rêvait-il pas déjà « d'être un Blanc » ? Mais, ajoute Kélani, « il ne réussira jamais à changer la couleur de sa peau» (W, p. 22).
Le père Fidel, le curé de Wirriyamu, ne réussira pas davantage à chasser de lui ce qu'il considère comme le démon, et qui n'est que l'expression naturelle de son instinct génésique. Ce païen converti au christianisme, hanté par ses fantasmes sexuels et taraudé par la mauvaise conscience, apparaît en effet comme l'une des figures les plus douloureuses du roman, en raison précisément de son appartenance à un double système spirituel, et de son incapacité foncière à opter pour l'une ou l'autre voie. Mais nous aurons l'occasion de reparler de ce personnage-symbole, véritable écorché-vif de l'aliénation culturelle.
Le problème de la dépossession de soi est également largement et finement analysé au cours des conversations qui réunissent Kabalango et le vieil Ondo. Pour ce dernier, chaque colonisé ploie sous le poids d'un double faix, celui de sa servitude, aggravé du fardeau de l'âme de ses ancêtres enchaînée depuis cinq cents ans :
Chaque colonisé, observe-t-il, a plus d'une âme à sauver. Celle d'abord de ses ancêtres, qui est la plus lourde parce que la moins noble et la plus enchaînée par nos maîtres. Et puis la sienne. Oui, chaque Noir désormais doit porter deux âmes… Car la première, née et morte sous la colonisation, est souillée de toutes les peurs de son ancienne enveloppe charnelle, et n'a gardé de son existence terrestre que le vertige de son élévation. Et chaque fois que vous vous entêtez à la soulever, elle vante si fort à votre propre âme les délices de la boue que celle-ci à son tour se débat furieusement sur vos épaules, si bien que presque toujours, à elles deux, elles finissent par vous faire trembler dans la résignation comme Kélani, dans la soumission comme Malick, ou dans la honte de soi comme mon unique fils Américano ou… (W, p. 79).
En passant de la période coloniale à l'Afrique des états souverains, qui sert de toile de fond aux trois autres romans de Sassine (Saint Monsieur Baly, Le Jeune Homme de sable et Le Zéhéros n'est pas n'importe qui), nous allons voir que si les temps et les hommes changent, les méthodes de gouvernement, elles, n'ont pas beaucoup évolué.
Notes
1. Williams Sassine, Wirriyamu (Paris, Présence africaine, 1976; desormais abrege W), p. 13.
2. Cheikh Hamidou Kane, L'Aventure ambiguë (Paris, Julliard, coll. 10/18, 1961), p. 56 -57.
3. Id., p. 125.