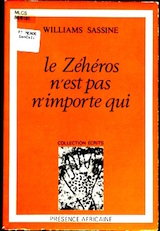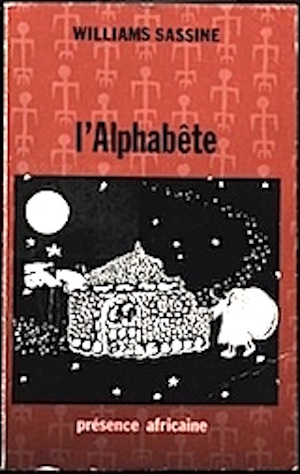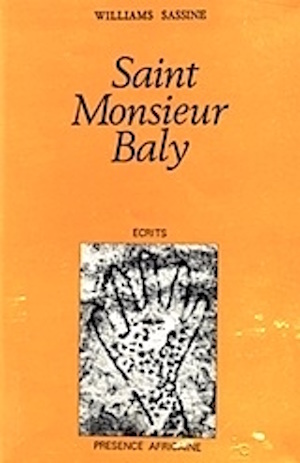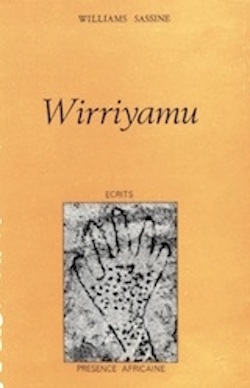Pius Ngandu Nkashama
Ecrire à l'infinitif :
la dérision de l'écriture
dans les romans de Williams Sassine
Paris : L'Harmattan, 2006. 292 p.
Introduction
Les écritures romanesques élaborées par les auteurs africains autorisent désormais des problématiques qui n'avaient été que pressenties aux époques des prescriptions didactiques. Des commentaires et des analyses textuelles qui les accompagnent avaient permis une “théorie littéraire” susceptible de prendre en charge les oeuvres elles-mêmes, aussi bien à l'étape de leur production qu'à celle de leur réceptivité.
Les thématiques concernant les contextes périphériques à l'acte d'écriture ne suffisent plus à elles seules pour définir la méthodologie impliquée. Bien au contraire, car depuis les descriptions avantageuses de la discursivité et de la narrativité, l'évolution des travaux diacritiques devrait avoir aplani les dernières réticences en la matière.
Du reste, la sémiotique scolaire et ses dérivés ont achevé de marquer le parcours annoncé par la théorie des modalités : les modalités énonciatives comme pour les aspects syntaxiques du “point de vue” ou encore les modalités figuratives qui déterminent les relations entre la source et la cible, entre le destinateur et le destinataire. En fait, la réalisation de l'acte (celui d'écriture aussi bien que celui de
lecture) à travers l'énonciation.
Des événements se bousculent et s'enchaînent : horreurs, atrocités. Mais également, espérances à vivre, et autant de vérités philosophiques à évoquer. Les reportages médiatiques demeurent cependant cyniques, arrogants et imperturbables. Et les commentateurs de la “chose africaine” persistent dans l'erreur. Ils répètent des rengaines inlassables. Les querelles intestines et bien stériles ne conviennent plus dans les circonstances actuelles.
La réalité s'impose désormais : la science de l'Afrique ne peut être opératoire que si elle s'inscrit dans le domaine des changements.
Les guerres qui reviennent depuis la fin mouvementée des dictatures imbéciles ne se réduisent pas qu'à des batailles décisives ou absurdes. Elles désignent les espaces des transformations radicales, aussi bien celles des mentalités que celles des mythologies. Des contradictions qui n'avaient été que pressenties éclatent, et elles trouvent leur résolution immédiate dans des conflits proches d'un suicide historique. Il est impensable que les préalables théoriques demeurent inchangés, là où sont passés l'“Apartheid”, les “génocides”
ou les “rébellions” ayant entraîné leurs millions de morts.
Les “moeurs” ainsi que les corollaires ethnologiques des “peuples primitifs”, des “tribus” sempiternelles et leurs exigences claniques : tout le processus a été perturbé, s'il ne s'est pas fait désintégrer.
La “tribu des Luba-Kasayi” qui pouvait aligner une centaine de milliers d'individus mal identifiés dans les années soixante, compte aujourd'hui près de dix millions de Citoyens éparpillés à travers le monde. Ils constituent une “Nation”, et ils ne peuvent plus se faire enfermer dans le monolithisme étriqué d'une tribu.
De telles notions relèvent des substrats archaïques qui devraient être réinterprétés selon les normes d'une épistémologie plus actuelle. Au même moment où des centaines de corps se laissent décomposer dans des fosses
communes, il est exclu de croire que le soleil se lève et se couche de manière identique, tout comme avant les désastres des “enfants-soldats”. Les structures aliénantes même les plus séculaires finissent bien par s'effondrer, engendrant du même coup d'autres mythologies d'espérance.
Il en est ainsi de l'antique “Congo-belge”.
Depuis plus de sept années (1996-2003), des luttes incessantes et des rébellions interminables ont bouleversé totalement le paysage, autant que les relations intercommunautaires. A travers les textes diffusés régulièrement par les journaux locaux et surtout sur les “sites de l'Internet”, les messages adressés à l'antique Europe ont évolué : il ne s'agit plus des raccourcis de haine, ni des fureurs incontrôlées, mais des discours en totale rupture de langages.
Les axes de toutes les réflexions devraient privilégier cette “science des changements”. Ceux -ci s'effectuent dans tous les domaines du savoir : les espaces géographiques, les individualités économiques, jusqu'à la perception que l'on pourrait avoir des faits politiques. Ce qui aurait pu sembler “insaisissable” apparaît au travers du “dire littéraire” comme le discours de l'improbable.
Et pourtant, la symbolique des écritures constitue l'une des forces attractives pour la pensée africaine. Toujours dépasser l'expérience, toujours assumer les aberrations. Toujours transcender les actes de foi. Croire qu'il est encore possible de “croire” et surtout de “douter”, et persévérer, pour ne pas admettre l'inéluctabilité d'une mort collective.
Une telle “puissance de la parole” ne cadre plus avec les postulats énoncés par l'antique critique universitaire, particulièrement lorsqu'elle est conduite à l'intention (et à la faveur) des recherches universitaires extérieures au continent.
La question ne concerne pas une dissociabilité devenue impérative des méthodologies d'approche, mais elle indique que l'épistémologie a toujours été un renouvellement permanent des interrogations. Elle n'a été opérante que par une réactualisation nécessaire des préliminaires théoriques.
Et on sait qu'en philosophie, “le commencement est toujours à recommencer”.
Le cas des romans écrits par Williams Sassine a permis d'exploiter une telle méthodologie avant de construire le questionnement porté par “l'Écrivant” à l'intérieur même du discours fictionnel. Ce qui pouvait paraître comme un paradoxe de la dérision, a conduit l'analyse du texte à des résultats pour le moins avantageux :
- premièrement, par la récurrence de l'actantialité reconnue à ce type de personnage, et l'analyse concerne l'ensemble des romans publiés
- deuxièmement, la répétitivité de plus en plus croissante d'un roman à un autre amène à considérer que la thématique exerce une réelle fascination sur l'acte d'écriture
- troisièmement par l'insistance qui revient à maintes reprises à travers les commentaires et les sarcasmes de l' auteur lui-même
En effet, à chaque fois qu'il avait été interpellé à propos des “littératures” et de ses propres oeuvres, Sassine ne se fatiguait jamais de reprendre une phraséologie répétitive : un
auteur africain est à considérer comme un “écrit-vain”.
L'ironie qui accompagnait l'énonciation n'a jamais semblé gratuite. Bien au contraire, ce qui passait pour une boutade ou bien pour un “trait de caractère” a fini par devenir un
leitmotiv symbolique. L'identité modale se transformait ainsi en une actantialisation progressive. Il suffit d'observer la présence continue et perlocutoire de la “machine à écrire”, pour admettre qu'elle l'atteste à maintes reprises, notamment dans Mémoire d'une peau.
Les romans étudiés dans la présente publication ont été ordonnés chronologiquement selon les chapitres de l'ouvrage. Les années mentionnées sont celles des éditions qui ont été utilisées pour le présent commentaire. Les titres énumérés sont les suivants :
- Saint Monsieur Baly (1973)
- Wirriyamu (1976)
- Le jeune homme de sable (1997)
- Le Zéhéros n'est pas n'importe qui (1985)
- Mémoire d'une peau (1998)
Les autres titres signalés ont servi pour expliciter certains des arguments utilisés au cours de la dissertation. Ils complètent ainsi la bibliographie littéraire de Sassine.
- L'Alphabête (1982)
- L'Afrique en morceaux, nouvelles (1994 )
- Légende d'une vérité, suivi de Tu Laura ( 1995) (théâtre)
Les réflexions présentées dans ce livre ont été inspirées et soutenues par des échanges suscités par Williams Sassine lors de sa “résidence d'écriture” à Limoges (octobre-novembre 1991 ).
Malgré les conditions de séjour
incroyablement précaires pour lui-même, il m'avait témoigné une amitié attachante, et il m'avait apporté un réconfort inégalé pendant la dure période (sept années) de chômage et de désespérance. Au milieu des incompréhensions malheureuses au sein du cénacle trop huppé (et bien trop sulfureux) des “Écrits-vains africains” en France, leur antique métropole coloniale.
Il est vrai que depuis les premiers débuts des “littératures africaines”, il ne s'agissait pas de comprendre le principe d'un “mouvement littéraire” assuré de sa dynamique propre, ni de dégager la cryptanalyse des textes, mais d'étudier des “Nègres spécifiques” en tant qu'objets d'analyse. Ensuite, de poser l'hypothèse d'un “Noir particulier” initié aux écritures par la culture coloniale. Et enfin, de démontrer de quelle manière originale ce “Scribe initiatique et initialisé” avait réussi à utiliser ces écritures à des fins qui auraient pu être considérées comme “littéraires”. Tout ceci semblait logique dans la perspective du discours colonial, mais comment le faire admettre par l'“Écrivant” africain, en maintenant les postulats d'une “littérature nègre” ?
L'exercice des préalables didactiques accompli ici procède des recherches studieuses menées par Kalonji Tshimvundu Zezeze et par Joseph Mwantuali Epoka de Hamilton College. L'auteur tenait à leur exprimer ses sentiments cordiaux.
Williams Sassine : l'Homme à travers ses oeuvres
Il est né à Kankan en 1944, et il est décédé à Conakry le 9
Février 1997, d'une crise cardiaque. Il avait obtenu un diplôme d'Ingénieur en Écologie tropicale et un Doctorat en Mathématiques à l'Université de Paris. Il a longtemps enseigné les mathématiques dans les lycées et Collèges de la Mauritanie, avant de connaître les supplices des prisons mauritaniennes, pour avoir adhéré à la cause politique des “Noirs” contre les Maures. Il les accusait de se comporter comme d'irrémédiables esclavagistes et ségrégationnistes.
Dès son retour au pays, il a été chroniqueur et Conseiller au Lynx, un journal satirique hebdomadaire. Durant la même période, il assumait les responsabilités d'un Rédacteur en chef du bimensuel d'information, La Guinée-Djama. Il a
collaboré également à l'Education, une revue pédagogique
trimestrielle.
A chaque fois qu'il lui avait été demandé de parler devant un public, Williams Sassine commençait tout son speech
par une formule devenue désormais une “expression-mascotte”, et qui caractérisait bien l'ensemble de son oeuvre littéraire: “un écrivain africain, est un « écrit-vain »”.
Longtemps, cette périphrase avait été décodée par le passif du complément. Il aurait été commode d'entendre par-là, qu'un auteur venu d'Afrique produit des “écrits qui sont
vains”. Des futilités en somme.
Cependant, par son itérativité même, elle a fini par identifier le “passif du sujet”.
Cela voudrait dire que l'écrivant, de par le fait de son acte d'écrire, s'est métamorphosé en un “être écrit en vain”.
Il serait peut-être utile de noter en préalable qu'à l'époque où Sassine écrit Mémoire d'une peau, il se trouve entièrement intégré dans les milieux du journalisme. Il venait de fonder un journal satirique qui lui vaudra bien d'inconvénients autant que de déboires de la part des autorités politiques, Le Grognon. Cela pourrait expliquer en partie le fait que tous les personnages évoluent au sein d'un domaine similaire. Le sens de toute la dérision retournée contre soi n'apparaissait que par les interventions insolites ou inaltérables. Sassine les proférait en affichant une délectation totale et avec un détachement superbe, souvent pour le plus grand malheur de ses auditeurs.
Lors d'une rencontre d'auteurs africains à Bruxelles, il avait été invité à la séance inaugurale pour parler de “l'humour dans la littérature africaine”. Le décor planté lui paraissait déjà dispendieux : le siège de la Communauté Economique Européenne, devant le parterre des Honorables Sénateurs et Bourgmestres, au coeur de Bruxelles, à quelques mètres à peine du Palais Royal. Des invités engoncés dans des costumes sur-mesure, trop damassés pour être véridiques.
Une salle encombrée de leurs “Excellences” accourues de la Belgique-Métropole, mais également de plusieurs pays d'Europe. Et le “Grand-Petit Sassine” tel qu'il s'était présenté lui-même, en chemise quelconque, des jambes croisées nonchalamment, effondré dans un fauteuil qui semblait trop large pour sa taille. Sourires moqueurs, grimaces espiègles, indifférence. Expression détendue, à la limite de l'indifférence, sinon de l'insolence.
Il débute son discours par un trait d'humour qu'il qualifie d'“histoire belge”, sans aucune référence au thème proposé.
« Le Président Sékou Touré se méfie d'un ministre trop entreprenant, qu'il soupçonne de comploter contre lui dans l'ombre. Il demande conseil à la C.I.A. Et les ordinateurs super-intelligents de la puissante Amérique lui conseillent d'ordonner une opération chirurgicale sur le cerveau du Ministre récalcitrant, en lui faisant réduire le contenu de la matière grise de moitié. L'ordre est exécuté à la grande satisfaction du commanditaire principal : le despote suspicieux. Ensuite, ce dernier rend visite à l'opéré dans la salle des soins intensifs où il a été amené, et il lui demande ce qu'il souhaiterait pour sa convalescence. Le Ministre exprime un désir irrésistible : une villa impeccable pour un repos thérapeutique mérité.
Le Grand Sékou rapporte la réponse étrange aux Américains qui s'étonnent d'une telle lucidité post-opératoire plus que suspecte. Ils estiment qu'une nouvelle opération s'impose, afin de prévenir toute menace ultérieure : réduire d'une autre moitié encore le cerveau déjà diminué. Nouvelle demande pendant les soins intensifs, nouveau désir : une grosse limousine.
De moitié en moitié, le cerveau du Ministre incriminé est ramené à une motte ridicule de gélatine. Et à la question du Président Sékou Touré, le désir du Ministre est à la mesure de son intelligence : des frites belges.
Alors seulement, les Savants Américains rassurent le dictateur : tu n'as plus à t'inquiéter, il est désormais inoffensif.
Depuis ce moment, Sékou Touré a pu continuer son petit bonhomme de chemin d'un tyran tranquille, heureux de pouvoir trucider ses concitoyens en toute impunité.
Sans contestation aucune ».
Imaginer la scène, la réaction du public. La colère des Sénateurs, les vitupérations des Bourgmestres, le courroux des Echevins, les rouspétances d'honnêtes contribuables flamands. Et Sassine de s'écrier triomphalement :
« Vous nous faites, venir ici, pour vous parler des “Ecrivains Africains, Ecrivains méconnus” (le thème de la rencontre), vous me suppliez pour vous parler de l'humour des Ecrivains Africains, et vous ne savez même pas apprécier l'humour belge ! ».
Cependant, rassuré par l'hilarité générale de ses “Compères”, et devant l'air médusé des officiels, il s'est exclamé :
« Quand je vous disais qu'un Ecrivain Africain est un « Ecrit-vain », il ne sait même pas faire rire les Belges ! ».
Un commentaire qui lui avait été consacré affichait en pleine page : “son chameau qui le connaît bien, « rigole tellement qu'il en fait sauter les bosses »”. Il n'arrêtait cependant pas de revenir avec insistance sur un principe qui lui paraissait inéluctable : “la littérature libère l'homme, et moi j'ai été libéré par la littérature”. Il ajoutait sans vouloir se retrancher derrière des euphémismes superflus : “on écrit parce qu'on a des morts qu'on n'arrive pas en enterrer”.
Lors d'un entretien avec Françoise Cévaër publié dans Présence africaine (n° 155), il avait répondu aux questions posées par ce type de périphrases dont il détenait le secret, et il affichait pour la circonstance une franchise étonnante. Quelques passages sont repris ici afin d'éclairer la démarche adoptée tout au long du présent ouvrage.
« — Que représente pour vous la francophonie ? — La francophonie ? On essaie d'en faire une famille sans complexes, avec toutes les diversités possibles. Je suis de triple culture : arabe, malinké et puis “francophone” comme on dit. Je n'en fais aucun complexe. Pour moi, le français sert de terrain de rencontre. Ma mère était de langue peule, mon père de langue arabe. Et tous deux communiquaient en français. Cinquante mots élémentaires, de quoi écrire toute une vie. Pour moi, c'est cela le français ; c'est cela la francophonie » (p. 11).
— Comment vous définissez-vous professionnellement ?
— Ça dépend des jours. Certains jours je me dis : “Je suis un matheux raté”, d'autres : “Je suis un écrivain raté.” Les maths me font vivre, c'est vrai ; tandis que l'écriture ça ne rapporte rien… que s'investir, prendre des risques. Mais c'est un mal nécessaire. J'ai cru qu'avec les maths, on pouvait tout comprendre, tout résoudre. Mais on ne résout que les problèmes des autres avec ça, pas les siens. Puis j'ai été tenté par la médecine ; je croyais que ça aussi c'était de la “grosse couillonnade”. J'avais beaucoup d'illusions. C'est ça qui est con ; on n'aurait pas dû aller à l'école.
— Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confronté en tant qu'écrivain ?
— Je n'ai pas de problèmes avec les éditeurs ; je commence à être connu maintenant. Le problème, c'est que l'on n'a pas de public. On est lu par quelques spécialistes qui vous regardent comme on regarderait un insecte : ils vous dissèquent votre bouquin, se demandant pourquoi la virgule est placée là ; ce n'est pas l'histoire qui les intéresse. Et pourtant c'est pour ces gens que l'on écrit. Parce que moi, je n'ai rien à dire à quelqu'un qui crève de faim ; je n'ai pas à lui apprendre qu'il meurt de faim. De toute façon, il n'a pas les moyens d'acheter mon livre » (pp. 11-12).
— Pouvez-vous me parler de la réception de vos romans ?
— J'ai eu de la chance. Saint Monsieur Baly est passé presque inaperçu, Wirriyamu aussi ; pour Le jeune homme de sable, j'ai été invité à Apostrophes. Ça a été catastrophique pour moi, on m'a attribué tous les qualificatifs possibles, on me disait que j'étais… ; malgré cela, on a vendu, le lendemain de l'émission, seulement cinquante exemplaires du bouquin. Il y a toujours cela qui entre en jeu, le fait d'être rejeté, d'être étranger. Ce matin, je viens d'apprendre que le livre est épuisé : neuf ans pour vendre trois ou quatre mille exemplaires ! On est bien perçu par la presse, mais il n'y a pas de retombées. Je ne connais pas un seul écrivain africain qui puisse se vanter de vivre de sa plume ! » (pp. 14-15).
— Et selon vous, quel est le lecteur idéal ?
— L'écrivain idéal, le lecteur idéal… Le mot “idéal” ne convient dans aucun domaine ; la femme idéale, l'homme idéal, la maîtresse idéale, le livre idéal… Non.
— Est-ce que vous avez, faute d'éditeur, des manuscrits au fond de vos tiroirs ?
— Oui ; certains achevés, d'autres non. Écrire, c'est finalement un travail de longue haleine. Et quand tu termines un livre, tu te rends compte que tu n'as rien fait ; c'est ça qui fait le plus mal. Si la première page est très difficile, la dernière l'est plus encore. Parce qu'on ne peut pas faire un bouquin parfait. Idéal, voilà, idéal (rires).
— Comment ça “on s'aperçoit qu 'on n 'a rien fait” ? qu'on n'a pas encore tout dit, c'est ça ?
— Non ! A la limite, on peut avoir tout dit ; mais la forme ! Nous qui ne sommes pas de vrais Français, on pense souvent dans nos langues ; et il y a parfois des expressions qui ne conviennent pas. Il faut travailler, travailler toujours ! Tu te dis toujours que tu peux mieux faire ; alors, tu reprends une autre histoire, qui est en fait la même histoire. Tu veux faire croire au lecteur que c'est une histoire différente, tu changes le nom des personnages, mais ton dixième bouquin sera le même que le premier ; on cherche à se perfectionner, c'est tout » (pp. 16-17).
Procédures narratives et déplacement de la présence
La linguistique générale avait édicté une méthode jugée
infaillible. Il n'apparaissait pas encore qu'elle ne s'accordait qu'aux préliminaires théoriques des langues envisagées, en
l'occurrence, celles de l'Europe. La situation linguistique des Ecrivains africains ne transparaît pas uniquement au travers des paradoxes que les manuels anthropologiques ont longtemps assimilés aux “conflits de cultures”, encore que la
périphrase n'a jamais explicité ses postulats idéologiques.
Les spécialistes en la matière avaient donc estimé que la prédication constituait un élément fondamental à l'égard de l'expérience du temps. Dans le même ordre d'idées, la “présence de la personne” ne pouvait se faire apprécier qu'à
travers les formes sémiotiques identifiables à celles du temps linguistique. La conséquence attendue admet que les notions
de “personne”, de “subjectivité” et de “formes verbales” ne pouvaient pas être réductibles les unes aux autres, puisqu'elles décrivent chacune un champ de pertinence
opératoire distinct.
En procédant à une analyse critique des oeuvres romanesques de Sassine, il apparaît que les actes énonciatifs suivent une typologie différente, par rapport à ces “figures de présence”. Ce qui avait été considéré comme une présence subjective contenue par les formes personnelles telles que “je” et “tu”, ne correspond plus à l'instance immanente exprimée par l'expérience énonciative.
Tout ceci a été discuté avec compétence dans la thèse de Georice Berthin Madebe présentée auprès de l'Université de Limoges en Sciences du langage : La mutation de la figure du narrateur dans le roman africain : construction de la personne, du référent et des axiologies fictionnelles (approche énonciative et sémiotique) (2001).
L'étude du conte de l'oralité avait déjà permis de soulever des questions pertinentes relatives aux “voix narratives” ainsi qu'aux problématiques narratologiques. On sait par ailleurs que dans plusieurs textes, ces “voix narratives” se transforment en “voix énonciatives” et qu'elles sont
actantialisées presque toujours dans les derniers chapitres, lorsque le “héros” a achevé la quête par une mort qui désintègre totalement l'instance discursive. Ainsi dans
L'aventure ambiguë, pendant que Samba Diallo frappé par le couteau du “fou” agonise au-dessus des tombes du cimetière, ou pour Une vie de boy quand Toundi délire dans son agonie.
L'ouvrage d'analyse critique Ruptures et écritures de violence : études sur le roman et les littératures africaines contemporaines, dans le chapitre intitulé, “Autour du conte et du récit romanesque : narrateur, narratologie et tiers actant”, avait déjà constaté ce qui suit:
« A la fois à l'intérieur de la scène et en dehors du temps de l'énonciation, il (le narrateur) en fixe les séquences majeures tout en préservant la logique du récit. Il se situe à l'intersection des spatialités et des temporalités oppositionnelles, celles du visible et celles de l'imaginaire, celles du possible et celles du fictionnel. Il fait articuler les fragments de la narration, et il est positionné à la médiane des distances perceptibles. Il peut être appelé également le personnage médian, car par lui et à travers lui, les deux pôles de la narration s'entrecroisent et se rejoignent l'un par rapport à l'autre (p. 39).
Il faudrait rappeler la fonction du “tiers-actant” commentée dans la même étude. Elle permet de positionner le narrateur et les narrataires à l'intérieur du cercle scénique en relation avec ce “tiers-actant” ainsi défini : “du côté diamétralement opposé à celui du narrateur principal dont il constitue une métaphore antithétique”.
Il (le tiers-actant) apparaît comme un espace indexé structurellement, car son rôle principal consiste à relever les indices. Il arrive ainsi à définir les déictiques autant que les modalisations des séquences. Il indique les référentiels proleptiques ou analeptiques à travers les procès de l'énonciation (p. 39).
L'hypothèse de départ explique mieux encore la “rupture temporelle” transposée aux romans de Sassine. Alors que la subjectivité se résolvait par les déictiques, elle se trouve ici traduite par des segments figuratifs susceptibles de déployer “l'intelligibilité sensible des événements rapportés”.
La sémantique avait décrété que le procès perceptif détermine la position personnelle ou du moins, “il permet de mettre en valeur l'implicite de l'énonciation”. L'étude des
romans africains démontre de quelle manière le “temps de la subjectivité” ainsi que la “morphosyntaxe des noms” qui
l'exprime sont sollicités simultanément pour construire une structure : “la présence énonçante d'un corps qui prend
position à l'intérieur d'un champ axiologique”, en l'occurrence dans Wirriyamu ou dans Mémoire d'une peau.
En valorisant le corps physique de Rama dans ce dernier récit, le narrateur qui se démultiplie indéfiniment prescrit au déictique “il” un statut ordonné différemment. Et cette troisième personne du singulier (en forme grammaticale) n'est plus ici ni a-personnelle ni non-personnelle ni même
impersonnelle. Elle désigne le corps sensible comme une garantie d'authenticité pour une expérience sémiotique.
L'énoncé contient d'abord les traces du corps sentant, et il en précède la prédication. L'identité modale est ainsi affirmée par le contrôle de la praxis énonciative, et l'étendue figurative qui la déploie en mesure également la présence mythique.
Dans ces romans particulièrement, le temps de l'événement n'est pas seulement “objectivé”. Il est saisi dans le procès même de son objectivation. En effet, l'instance narrative se trouve impliquée à trois reprises dans cette expérience du temps. A chaque fois, le temps chronique tel qu'il est décrit,
se superpose au temps de l'expérience, celui que la
phénoménologie appelle, le “temps vécu”, et qui est également le “temps subjectivé”.
A quoi il convient d'ajouter le “temps de l'énonciation” tel qu'il se manifeste à ces trois niveaux parce que le narrateur
comme “instance originaire” expérimente lui-même l'événement à l'intérieur du récit. Là où “expérience” et
“événement” se distinguaient rigoureusement par le temps
subjectivé, on peut dire que celui-ci perdure jusqu'au moment de l'énonciation.
L'argument principal pour prouver un tel “déplacement de la présence” se retrouve évidemment dans la logique des passions et des sensations qui structurent l'énonciation.
L'“instance perceptive originaire”, surtout lorsqu'elle se réfère à la “proprioceptivité”, se fait saisir en position de sujet et de non-sujet, tout en conservant la cohérence énonciative et narrative, “sans autres altérations du discours”, c'est -à-dire l'assomption de la prédication.
Dans les récits analysés ici, la figure narrative se présente souvent sous la forme des morphologies personnelles multiples. Elle peut être considérée comme un “narrateur
multiple”, tel qu'il apparaissait déjà dans Mémoire et écriture de l'histoire. Ce dernier est caractérisé par ses nombreux passages de la position de non-sujet à celle de sujet.
Des changements qui sont redevables de la passion “phorique”, chaque fois qu'il parvient à agir, ensuite à contrôler ses propres comportements. L'actant passionnel rejoint ainsi la phase de “sujet de la passion”, pour enfin manifester un statut personnel, et se projeter en un “nous” intersubjectif. La question du dédoublement de la voix narrative sera discutée longuement dans cette analyse. Elle
permet surtout d'indiquer les “temps forts” par lesquels se déterminent les axes majeurs d'une distanciation à la fois temporelle et topologique.
Ce que la sémiotique définit comme une “aspectualisation de l'énonciation”, là où des références relatives sans référents fixes renvoient à des références absolues incompétentes pour mettre en cause des
actants narratifs déterminés.
Madebe avait déjà expliqué que “ces segments démontrent l'existence d'une présence sensible qui subsume une expérience perceptive sémiotiquement prise en charge par l'étendue figurative : la vision sécante de ce segment est ainsi assurée par cette présence sensible et cognitive produisant
du sens à travers une capacité d'associations sémantiques des grandeurs figuratives” (p. 371 ).