Editions du Seuil. Paris. 1997. 217 p.
J'étais trop petit pour me souvenir dans le détail de ce bal du 14 Juillet au cours duquel Cellou-le-Poète avait traité M. Lemoine de fantôme et de vieille morve. Pour dire vrai, je n'en fus pas le témoin direct. A cette heure, j'avais déjà rejoint ma chambre ; j'espérais secrètement me faire pardonner l'affront fait à Mère-Griefs en m'enfuyant ce matin-là par la fenêtre alors qu'elle n'était pas encore sortie du lit. Je m'étais levé tôt pour avoir de nouveau fait un cauchemar sur ce bandit de Bambaaɗo.
Moodi Djinna était en voyage. Il s'était laissé convaincre par Oussou d'aller jusqu'en Sierra Leone, charger du drill kaki qualité Manchester ! — dont la robustesse était si prisée par tous ces petits zazous d'antan qui dansaient le mambo en rêvant d'Indépendance.
A huit heures, je m'étais levé pour allumer le poste de TSF dans la chambre de Moodi Djinna et j'en avais profité pour ouvrir la fenêtre et retomber tout habillé sur les graviers de la cour sans me faire remarquer.
En ville, beaucoup de messieurs portaient des chéchias rouge vif et les dames des gubaa de percale passés au bleu de tournesol et savamment empesés. Des petits groupes s'orientaient vers le monument aux morts, le drapeau français soigneusement plié sous le bras. On entendait jouer du tam-tam et du balafon. Des choeurs de femmes s'élevaient d'une colline à l'autre, chantant la gloire maintenant plus que probable des Éléphants. Des voix mâles sorties de porte-voix plus ou moins bricolés faisaient applaudir les noms de Boubou-Blanc et de ses compagnons. Des balcons de la rue du Commerce, Radio-Dakar, entre une réclame pour les piles Leclanché et une chanson de Tino Rossi, donnait un bref flash sur l'Algérie avant de souhaiter un joyeux 14 Juillet à l'Afrique Occidentale Française (AOF).
Je déjeunai devant le cinéma d'une calebasse de gosi et tombai nez à nez avec Arɗo dans le hall de la gare. A cette époque, je me sentais bien plus proche de lui que de Bentè. Nous nous assîmes un bout de temps sur les rails pour discuter un peu. Nous ne nous étions pas vus depuis trois jours et ne prévoyions certainement pas de nous rencontrer là. Il m'expliqua qu'il y était venu pour s'occuper un peu, les jours de fête étant les jours les plus tristes de sa vie, les seuls où le plus imprévoyant des hommes achète de quoi lustrer ses chaussures à domicile.
— Alors, tu comprends pourquoi je suis obligé de fourrer mon cirage sous le lit et de prendre un peu de vacances. Mais toi non plus, grand camarade, tu n'es pas si fréquent que ça, dans les environs de la gare…
Je lui répondis que je ne voulais pas crever d'ennui sur le territoire de Moodi Djinna un 14 Juillet et que je m'étais enfui par la fenêtre, quitte à le payer le soir par les reproches de Mère-Griefs ou par une monumentale raclée, au cas où mon père serait, entre-temps, revenu.
— Cela veut donc dire que nous avons toute la journée ! s'enthousiasma-t-il en me soulevant sur sa tête. D'ici, nous irons cueillir Bentè devant le terrain de basket. A dix heures, nous irons voir le défilé au son de la garde républicaine. A midi, chez le Libanais, où ton grand camarade Arɗo t'offrira le plus gros et le plus délicieux sandwich au cervelas que tu aies jamais mangé. L'après-midi, nous regarderons les filles et les nombreux joueurs de flûtes et de violons.
— Et le soir ?
— Tu me demandes ça ? Le soir, on danse au Buffet de la Gare ! C'est la première fois que tu mets le nez dehors un 14 Juillet ! Eh bien, profites-en, bientôt il n'y en aura plus.
— Vous les Éléphants, allez-vous manifester de nouveau ?
— Pour que les parachutistes de Dalaba viennent nous défenestrer ! Mille fois non ! Nous sommes plus futés que ça. Seulement de 14 Juillet à Mamou, tu n'en verras plus jamais après celui-là.
Ma mémoire a gardé intacte l'image du commandant de Cercle (son uniforme blanc, son sabre de parade et son casque) quand il s'était avancé pour déposer une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts. Perchés sur le manguier surplombant le grillage du terrain de basket, nous avions tout sous les yeux : les édifices repeints et pavoisés de la cocarde tricolore, les calots du régiment, les guêtres et les gants de la fanfare, le rang des écoliers (seuls les plus grands étaient conviés au défilé) et la marche des anciens tirailleurs.
L'Almamy se trouvait à l'aile gauche de la tribune avec sa fidèle cour de taalibe, de mbatula et de farba. Même de si loin, nous pouvions le reconnaître avec son sceptre en bois d'acajou ornementé de dorures et son long turban de moire. Les gens avaient rappliqué de tous les villages environnants par bennes, par wagons à bestiaux, parfois à dos de cheval. Je pensais que la ville avait quintuplé tant la foule était nombreuse entre la gendarmerie et l'école de la Poudrière. Nous trouvâmes une place pour commander du fatoush et des sandwichs au snack libanais, mais il nous fallut une demi-heure de bousculade pour parvenir sur la route de Conakry où il devait se produire la course automobile, la course à vélo et cette affreuse compétition dans laquelle nous, les gamins, devions courir les deux jambes dans un sac de jute. Je fus classé troisième. Comme récompense, je reçus un harmonica, une casquette de marin et un paquet de crayons de couleur.
Après quoi, nous allâmes à la crémerie nous régaler de bonbons-glace. Vers cinq heures, le mât de cocagne sur ce même vieux poteau de fonte abondamment recouvert de matière gluante pour agrémenter le jeu. Néanmoins, je décrochai cet appareil photo Agfa offert à Bentè et une multitude de sachets de biscuits et de bonbons que nous distribuâmes aux filles en faisant les gigolos d'une rue à l'autre. Nous
terminâmes l'après-midi au Café de la Poste, où Arɗo et Bentè vidèrent une ou deux bouteilles de Kronenbourg en fumant pour plaire aux filles avec de longs fume-cigarette bagués.
En arrivant au Buffet de la Gare, il n'y avait pas encore trop de monde. Nous trouvâmes facilement un morceau de grillage où nous accrocher pour pouvoir apercevoir l'intérieur. Les tables étaient déjà impeccablement rangées dans le jardin, avec des napperons de dentelle et de joufflus bouquets de roses minutieusement disposés dans d'étincelants vases de cristal. Les musiciens accordaient leurs instruments dans l'angle gauche de la salle, celui opposé au comptoir du bar.
Pour l'instant, il n'y avait aucun invité. Les élégants couples de Métropolitains et d'Émancipés prenaient l'air dans leurs Traction Citroën décapotables ou dans les allées fleuries jouxtant le monument aux morts.
On n'entendait aucun bruit d'explosion, comme ce fut souvent le cas à cette période-là. Au contraire, il flottait dans l'air quelque chose de badin, de follement enjoué. Le tourne-disque, dont les haut-parleurs avaient été disposés dans le jardin en attendant que le petit orchestre se préparât, jouait une valse à la mode et tout le monde répétait avec lui :
Que sera, sera
Demain n'est jamais bien loin
Laissons l'avenir venir
Que sera, sera
Qui vivra verra…
Rien ne pouvait annoncer le drame qui allait s'y produire, peu après minuit selon Bentè ; peu avant les zébrures de l'aube, selon Arɗo. A vingt heures, tous les couples étaient installés. A vingt heures trente, M. Boisselet, le commandant de Cercle, pouvait faire son discours et ouvrir le bal. L'orchestre attaqua une musique douce pendant que l'on servait les plats. Les boys évoluaient entre les allées avec une extraordinaire adresse. Ils portaient des smokings blancs et des noeuds papillons comme en voit au cinéma. Ils découpaient la volaille et débouchaient les bouteilles sans jamais perdre leur sourire.
Si personne ne peut dire avec exactitude à quelle heure Cellou-le-Poète s'en prit à M. Lemoine, personne non plus ne peut dire à quelle heure il arriva au Buffet de la Gare. Avant le discours du commandant de Cercle, comme le dit Bentè, ou après le digestif, comme le suggère Arɗo ? Les méchantes langues murmurent qu'il avait déjà pris sa dose au bar de Sow Béla avant de se pointer au Buffet de la Gare. D'aucuns se souviennent qu'il avait longtemps dû parlementer avec le gardien pour pouvoir acheter son billet.
— Il puait l'alcool comme le bouc pue le bouc, dit encore aujourd'hui celui-ci, devenu régisseur de la salle des fêtes.
Et pourtant, ça ne se voyait pas. Je crois me souvenir qu'avant de rentrer chez moi j'avais attiré l'attention de Bentè et Arɗo sur le calme extraordinaire avec lequel il était assis sur un tabouret du bar, un verre de whisky devant lui. Tous ceux qui l'avaient vu, ce soir-là, avaient noté l'absence presque physique de Mlle Saval, partie une semaine plus tôt en vacances à Paris. C'est que, pour beaucoup, ils étaient devenus un couple, un vrai. Sans doute à cause de leur sveltesse à tous les deux et de leurs caractères différents dans le fond mais que les mauvaises langues avaient toujours voulu confondre à cause de leur commune prédisposition à étonner les autres.
— D'abord, disait Arɗo, quelle étrange coïncidence les a fait se rencontrer ici, dans cette ville impensable que l'on appelle Mamou ? Ne voyez-vous pas qu'ils ne peuvent que se consumer si on les laisse tous les deux ? Quelle coïncidence, en effet ? On avait longtemps pensé qu'ils s'étaient rencontrés en France, jusqu'à ce que Doulla, le commis de la Société Commerciale de l'Ouest Africain (SCOA), se remémore qu'il était ce jour-là à la gare quand Cellou-le-Poète était monté dans la Micheline pour aller prendre le bateau pendant que Mlle Saval en descendait pour la première fois. Et comme l'année suivante il était revenu alors qu'elle n'avait pas quitté la ville, même pour les petites vacances, ils n'avaient logiquement pu se connaître qu'au marché à légumes.
Lama-Diallo se souvient parfaitement de ce qu'il avait vu ce jour-là. La jeune femme s'apprêtait à repartir avec sa corbeille de concombres et de laitues quand Cellou avait surgi de la boucherie de Saadio. Ils avaient devisé un bon quart d'heure sans se douter que tout le marché les observait. Personne ne sait ce qu'ils s'étaient dit ; en tout cas, Mlle Saval avait beaucoup ri. De sorte qu'on ne s'étonna plus de les revoir ensemble jusqu'à cette nuit fatidique du 14 Juillet où un coup de feu fut tiré. Ils finiraient sans doute par se marier, bien que personne ne pût jurer qu'ils ne l'étaient pas déjà dans les faits. Sauf Arɗo, qui ne cessa jusqu'à sa mort de me répéter son sinistre leitmotiv :
— Que crois-tu, grand camarade ? Ils coïtent, ces deux tourtereaux ! Que peuvent-ils bien faire d'autre, eux qui ne parlent à personne ?
Je crevais de rage quand je l'entendais dire cela. Mais je ne pouvais nier le comportement pour le moins étrange des « tourtereaux » en question. Une paire comme celle-là, ça devait sans doute exister puisque — s'il faut en croire son propre adage — « Y a pas ce que le bon Dieu n'a pas mis sur terre à part un canari de boeuf tout prêt à mijoter ». Mais alors à Conakry, à Kindia, à Labé ou ailleurs. A Mamou, je pouvais jurer qu'on en voyait pour la première fois d'aussi surprenants. Et je ne dis pas cela uniquement parce que l'un était noir et l'autre blanche. Chacun des deux avait son caractère à lui, et de façon si outrancière qu'il en dérangeait d'abord sa propre communauté. Il était aisé de trouver sur leur dos matière à s'entendre ou à se réconcilier en ces temps troubles où le moindre mot mal placé pouvait déclencher l'irréparable. Il s'était très tôt créé entre eux et la ville une sorte de ligne invisible.
Et cela n'avait fait que renforcer leur particularité. Et au lieu de les chagriner, cela les arrangeait. Au fond, ils ne cherchaient que ça, que Mamou les surveille, les montre du doigt mais leur foute la paix. Leur solitude, ils la vivaient avec le sentiment de jouir d'un privilège, non de subir un opprobre. Rien, à ce moment-là, ne les obligeait à rendre compte. Libres du regard comme de l'arrière-pensée des autres, ils pouvaient vivre sans s'encombrer de confidences ou de précautions. On les voyait au marché aux condiments discuter le prix d'un sachet de sumbara, ou à la Pergola, où ils prenaient
un verre de Pernod devant la colère mal rentrée des Blancs et sous les yeux médusés des serveurs. Souvent, ils allaient manger un riz-maafe dans une gargote sur la route de Labé, au milieu des apprentis chauffeurs et des camelots descendus de Tougué ou de Bamako, avant de finir la soirée au Buffet de la Gare. Il se disait qu'ils faisaient exprès d'aller dans des endroits aussi différents : pour conspirer, pour crâner, pour offenser les uns et les autres, leur but, avant tout, étant de se moquer du monde, estimaient la plupart des Mamounais.
Arɗo leur accordait parfois de fort belles excuses quand il les voyait se promener dans les bas quartiers :
— Je la trouve quand même drôlement sympathique, cette fille de pécheur chrétien, de faire comme nous autres nous faisons : manger le riz à la main et boire dans le même gobelet que tous après avoir craché en l'air. Je sens que je ne vais pas tarder à lui dire bonjour et, qui sait, à la culbuter.
Mais, là aussi, comme dans bien d'autres cas, Bentè n'était pas d'accord :
— Quand on va manger du riz mal pilé et de pauvres tripes de poulet dans une gargote infestée de relents de sorgho brûlé et d'urine de traîne-savates, ne cherche pas où est La Mecque, mon gars : c'est qu'on n'a rien dans la poche.
— Tu deviens fou, Bentè ! Une maîtresse d'école qui n'aurait rien en poche ! Trouve-moi autre chose, ce mensonge-là est trop gros. Ce n'est pas parce qu'elle n'a jamais couché avec toi que tu as le droit de la ternir. D'ailleurs, n'oublie pas que c'est souvent elle qui paie quand ils s'en vont à la Pergola ou au Buffet. C'est ce que m'a dit Rahmane, le garçon du Buffet.
— Alors, dans ce cas, elle veut nous prendre en pitié !
— Moi, je crois qu'elle veut emmerder ses frères de race : ceux-là, d'accord, tu peux les vilipender. Ce sont eux qui nous éclaboussent en passant dans leur Citroën Traction-Avant et nous regardent toujours de haut comme s'il ne leur arrivait jamais, à eux, de saigner ou de péter.
— Eh bien, éclaboussons-les aussi ! Une roue de charrette et de brouette, ça connaît encore mieux les flaques d'eau.
— Que veux-tu insinuer par là ?… Bientôt, nous aurons nos propres voitures et nous jetterons à la mer leurs tortues de 2CV !
— Apprenons d'abord à fabriquer une aiguille !
Le plus souvent, leur discussion dégénérait là. Arɗo ruait dans les jambes de Bentè. Ils roulaient entre le perron et le trottoir en échangeant des injures et en feignant de se donner des coups de couteau ou de pied. Après quoi, ils me demandaient de leur dire lequel des deux était le bravo, ce que, en usant de moult paraphrases et rires, je m'étais toujours refusé à faire.
Je ne savais pas si de telles empoignades — ne seraient-elles que simulées — avaient aussi lieu dans les belles demeures du quartier Dumez. Cependant, selon de nombreux jardiniers et boys, les commentaires n'y manquaient pas non plus de piquant et d'imagination. Voici par exemple ce qui fut entendu à l'heure du café, le jour de l'anniversaire de Mme Jouanneau :
— La garce ! Elle aurait fait le tapin et volé ses diplômes que cela ne m'étonnerait pas !
— Mais oui ! Pourquoi sinon serait-elle venue en brousse ? Pour fuir son passé, cela saute aux yeux !
— A vrai dire, ce n'est pas cela qui me gênerait. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi elle se croit obligée de frayer avec un Nègre !
— Au vu et au su de tout le monde ! Je ne sais plus où me mettre quand je rentre au bureau. Mes subordonnés indigènes ne parlent plus que de ça et en me regardant avec envie comme s'il s'agissait de moi. Je t'assure, Colette, que je n'ose plus m'y présenter sans une robe longue.
— Je me garderai bien de critiquer qui que ce soit mais elle aurait pu en choisir un parmi les siens. Tenez, ce brave Massaloux aurait pu très bien lui convenir.
— Pensez-vous ! Elle l'a congédié plus d'une fois, et devant la boyesse de celui-ci… Non, non, il n'y a pas d'erreur, elle tient à son gorille.
— Pourquoi donc fait-elle cela ?
— Pour nous humilier, mon cher ! Pour nous faire regretter d'être nés Français. Je ne crois pas, moi, à la thèse de la pauvre petite pute. C'est plus grave que ça, si vous voulez m'entendre ! Moi, elle m'a tout l'air d'une espionne, celle-là ! Je suis sûr que si l'on cherche un peu, on verra la main du KGB. Mata Hari, vous savez, elle se donnait volontiers des airs de gourgandine…
— On aurait alors affaire à un réseau communiste ! Mais c'est vrai qu'il a été en France, il n'y a pas longtemps, son Négrillon ! Qu'a-t-il bien pu y faire ? Vous avez vu l'allure qu'il se donne depuis qu'il en est revenu ?
— Oh, ils se donnent tous de grands airs depuis quelque temps. C'est qu'ils se croient déjà indépendants !
— Les farfelus ! Je la leur foutrai bien où je pense, leur saloperie d'Indépendance! On ne va quand même pas leur faire croire à une telle fadaise !
— On pourrait se renseigner sur la fille…
— Faites donc vérifier tout ça, Lemoine : son passé, ses diplômes, etc. Nous sommes encore en république que je sache !
— Je l'ai déjà suggéré à Mouton. Et selon lui, côté diplômes, tout est régulier. Seulement, entre nous, faut-il faire confiance à un gaulliste ? Quant à ses moeurs, maintenant que M. le Commissaire de police est un Nègre…
Seulement, aurait-on établi, documents à l'appui, la vie et les moeurs de Mlle Saval qu'il resterait à jamais une question sans issue : Qu'est-ce que Cellou avait bien été faire en France et, plus troublant encore, pourquoi était-il revenu si vite ? D'autant que Mamou ne savait pas grand-chose des autres épisodes de sa vie, non plus. Il était apparu un ou deux ans seulement avant sa célèbre expédition. Le peu de fois qu'il s'était confié, il avait laissé entendre au Café de la Poste qu'il venait des environs de Dalaba, mais personne ne pouvait préciser s'il s'agissait de Ditinn ou de Tinka. Il s'était tout de suite distingué en s'abonnant à l'Ecole universelle, un centre d'enseignement par correspondance, et ce, dès qu'on l'embaucha comme commis comptable chez Peyrissac. Il avait les yeux tout le temps plongés dans les manuels et les revues, alors il ne s'était pas fait beaucoup d'amis. Mais il disait à Rahmane qu'il ne voulait pas finir comme n'importe qui. Il voulait devenir ingénieur ou savant ou poète ou imam, n'importe quoi mais pas ces petites vies de chenilles qu'il voyait grouiller par ici.
— J'irai faire des études ! Je sortirai d'une grande université !, lui aurait-il murmuré un soir.
Mais Rahmane pensait qu'il avait encore bu, de sorte qu'il faillit tomber de vertige le jour où il reçut de Paris une carte des Invalides griffée de son inimitable signature de comptable. Comment s'était-il débrouillé pour le billet du bateau et pour le gîte, le manteau et le couvert dans ce froid pays d'en France ? Ici aussi, seules les supputations pouvaient venir à bout de la curiosité. Il fut d'abord dit qu'il avait tapé dans la caisse. Et comme son retour n'engendra aucune plainte effective, on se dépêcha d'inventer autre chose. Il aurait revendu le troupeau de son père. Certains continuèrent cependant à nier qu'il avait été en France en dépit de la carte postale encadrée et affichée dans la chambre de Rahmane. Il serait resté tout ce temps à faire le magasinier dans le port de Conakry ou le contremaître dans une plantation de bananes des environs de Souguéta.
Il fallut que Rahmane exposât la fameuse carte sous les yeux des sceptiques pour que, au marché et dans les bas quartiers, on commençât à y croire. En admettant que tout cela fût vrai, toutes les zones d'ombre n'étaient pas pour autant éclaircies. Avait-il fait des études, et lesquelles en si peu de temps ? Oui, si on prenait en compte son élégante garde-robe, la Vespa qu'il en avait ramenée et les nombreux poèmes et articles qu'il publiait dans Coups de Bambou. Non, au vu de la relative déchéance que constituait le fait de quitter Peyrissac pour les Transports Khoury et Frères. Il avait repris la même chambre qu'il louait au quartier Boulbinet.
Mais le soir, après avoir échangé sa saharienne d'employé contre un costume de tergal ou de drap peigné, il filait rejoindre sa Blanche à la Poudrière. Les voisins les entendaient rigoler et répéter l'inusable chanson que jouait le tourne-disque :
Par les monts et les plaines
Traînent mes souliers…
Parfois, ils faisaient venir du snack libanais un gigot-frites ou un sambousik de mouton et une bouteille de vin rouge. On se demandait pourquoi il ne quittait pas sa chambre pour venir vivre avec elle, pourquoi ils n'avaient pas encore d'enfant. La nuit, des oreilles se collaient aux persiennes. On les avait bien entendus remuer dans le lit mais, à vrai dire, personne n'était sûr d'avoir perçu un râle. Des bandes de gamins les suivaient quand ils prenaient la Vespa pour la forêt de Tambassa ou les jardins du Buffet de la Gare…
Encore qu'ils ne s'étaient jamais permis de s'embrasser dans la rue, comme le faisaient souvent les jeunes Métropolitains sans avoir peur des foudres divines ni de la risée des hommes ! Ils se contentaient de se tenir la main et de se parler tout bas : un geste tout de même déjà osé pour le commun des mortels ! Les pères de famille se détournaient sur leur passage avec un geste de pitié et de dégoût. Les marchandes de légumes les appelaient Madame-Monsieur mais se payaient un gloussement plus que suggestif sitôt qu'ils avaient tourné le dos.
— Ici, ils peuvent se le permettre, saloperie de ville ! éructait Arɗo, quand leurs « manières » venaient à bout de son excès d'indulgence. Le monde entier se fout de la gueule de Mamou. Ici, on est trop gentil, trop con ! Chacun vient essuyer ses pieds sur notre tapis de prières. Ils n'oseraient jamais le faire à Kindia ou à Dalaba. On aurait déjà tondu la femme et mis ce vaniteux aux fers !
— Donne-moi une bonne prime et je te règle l'affaire dans la journée même, répondait Bentè. Je te les fous hors de la ville avant que le soleil se couche !
— C'est pas ce que je te demande, cow-boy de mes deux ! Moi, je n'ai rien contre eux, je les trouve même beaux. Ce que je n'aime pas, c'est leurs manières ! S'ils veulent vivre ensemble, eh bien qu'ils se marient ! Et pour cela, que la bougresse commence par s'habiller et prier comme le bon Dieu le recommande !
— Tu peux parler du bon Dieu, toi ! Avec toute la bière que les anges te voient boire, tu es sûr de passer l'éternité en enfer !
— Moi, je ne fais que toucher au péché, elle, elle est née dedans ! Et puisqu'il s'agit d'alcool, devine quel petit pervers m'a fait goûter à ce truc-là ? Un singe nommé Bentè !
— Pour être honnête, ne serait-ce pas toi que la jalousie rongerait ?
— Qu'a-t-il de mieux que moi ? Sa Vespa ?…
N'empêche qu'ils arrêtaient de se « chamailler » quand « ils » passaient devant le studio de Nabil. Et tous, nous les regardions remonter la rue sans dire un mot. Leur présence nous rendait timides, quoi que nous en disions. Un peu hautain mais pas mal du tout, le gars Cellou, avec sa taille élancée, ses cravates à barrette et ses pantalons dernier cri. C'est lui qui avait apporté ici la mode des tabatières, des chemises de linon et des fume-cigares. Il fut le premier Indigène à hanter les bals du Buffet de la Gare. Parfois, on y tolérait bien les métis et les fonctionnaires, mais un simple Indigène, un vrai, Cellou fut le premier. Et pour cela, il n'avait même pas eu besoin d'aller d'abord en France. Un soir, comme si de rien n'était, il s'était simplement pointé devant le portail vêtu d'un smoking de flanelle et d'un remarquable panama. Le gardien fut tellement interloqué qu'il fut incapable de lui barrer le passage. Seulement, M. Lemoine, qui était assis au bar, avait suivi toute la scène. Il reçut Cellou sur le perron au moment où celui-ci avait fini de traverser l'allée :
— Oui, monsieur, c'est pour quoi ? lui avait-il demandé.
— Pour danser, naturellement !
— Voyez-vous, monsieur, c'est complet pour ce soir.
— Oh, vous savez, je ne suis pas bien nombreux. Cette table que je vois là (il en désigna une qui était à côté du bouquet de roses) me suffira largement.
M. Lemoine le saisit par le revers de la veste et le ramena vers la lumière du perron où s'étaient rassemblés avec une excessive curiosité les couples qui s' enlaçaient sur la piste :
— Vous n'êtes pas bien coopératif, vous ! En fait, pour être clair, je veux vous dire que les gens de votre espèce ne sont pas les bienvenus ici.
— Au nom de quelle loi ?
— L'ennui avec vous autres, c'est que vous ne comprenez rien sans qu'on ne manie la chicotte.
Il le jeta à la rue d'un vigoureux coup de pied. Cellou se releva et dit cette phrase très vite immortalisée par les conteurs et les nyamakala :
— Malheur à ton petit-fils qui le dira à mon petit-fils !
Quelqu'un lui ramassa son panama et les badauds accrochés au grillage et aux branches des acacias cessèrent de rire.
— A bientôt ! cria-t-il avant de remonter la rue.
L'incident fut relaté aux quatre coins de la ville. Le bal suivant, une foule de curieux envahit les abords du Buffet. Les Métropolitains, pour calmer les choses, ne purent rien faire d'autre que de laisser passer Cellou, sous les hourrah impétueux des élégantes et des gueux. Plus tard, beaucoup y verrons le prélude, voire la répétition, de ce qui allait se passer le soir fatidique du 14 Juillet. Mêmes griefs, mêmes témoins, mêmes curieux personnages…
L'heure exacte à laquelle il se dirigea vers la table de M. Lemoine restera une éternelle pomme de discorde. Arɗo et Bentè ne furent pas les seuls à s'être chamaillés là-dessus. Aujourd'hui encore, elle suscite de vives polémiques lorsque, dans les faubourgs, on en vient à évoquer cette nuit maléfique où, pour reprendre le fameux mot de mon défunt cireur, « le diable s'employa à nous prouver ce dont il était capable». En revanche, il est possible de reconstituer fidèlement la trame des faits et gestes qui l'avaient conduit à sortir de la salle de danse en dénouant sa cravate.
Ce soir-là, en sus de M. Massaloux, de M. Lemoine et de la sempiternelle compagnie des « Métro » amoureux de la fête, il y avait du nouveau monde : un trio d'exploitants forestiers venus de Côte-d'Ivoire et une pimpante Dakaroise qui s'était mis dans la tête d'apprendre aux hommes à danser le charleston. Elle ressemblait à ces femmes qu'on voit dans les films de gangsters, avec un menton pointu et mutin, un fourreau à paillettes et un boa de couleur vive. Quand elle dansait, on avait la drôle d'impression que ses pieds évoluaient dans du coton et non dans le redoutable piège de ses chaussures Louis XV.
Parmi les hommes qui, dès le début, n'avaient cessé de l'entourer, se trouvait curieusement M. Lemoine. Je dis « curieusement » parce que M. Lemoine passait pour tout sauf pour un fêtard. C'était un homme discret et absolument dépourvu d'humour. Qu'est-ce qui avait bien pu le pousser à s'encanailler ce soir-là au point que Mme Lemoine avait vidé deux Martini de suite en tirant une lèvre de trois doigts ? Il dansait en dessinant avec ses bras des cercles et des croix au-dessus de sa tête et se frottait sciemment contre les cheveux châtains et les bras nus, correctement hâlés, de l'inconnue. C'est vrai qu'à ses pas maladroits et aux secousses de son gros ventre répondaient des vivats perçants et désordonnés. Surtout de la part du trio de « broussards » qui buvaient du cassis et criaient par-dessus le toit qu'ils étaient Savoyards et diablement fiers de l'être.
Cellou, lui, était resté accoudé au comptoir devant un verre de Vermouth, l'air plutôt maussade, sans doute à cause de l'absence de Mlle Saval. L'enquête révélera qu'il s'entretenait avec M. Goude sur la précision incroyable des horaires des trains en France et échangeait de temps à autre une petite plaisanterie avec Rahmane, à peine intéressé par ce qui se passait derrière lui. Seulement, à un moment donné, la Dakaroise était venue au bar demander un verre de sauvignon. Et, pour paraphraser Arɗo, au lieu de prendre sa consommation et de s'en retourner à ses abominables déhanchements, elle s'était penchée vers Cellou, aussi langoureuse que la pépée de Satan :
— Oh, monsieur, dansez-vous le charleston ?
— Oui, mademoiselle, avait-il répondu (sans orgueil ni luxure, avait cru bon de préciser M. Goude). Je l'ai appris à Paris, au Tabou.
— Ainsi donc, vous connaissez Paris ? Le Tabou !… Eh bien, figurez-vous, monsieur, que j'ai longtemps résidé rue Dauphine, vous me croyez, n'est-ce pas ?
Déjà, elle s'était assise à côté de lui, avait sorti son paquet de Lucky Strike, et s'était mise à parler sans lui laisser le temps de répondre (ah, Paris, Casablanca, Dakar, Conakry et Port-Gentil!… ), ponctuant chacune de ses phrases d'un savoureux « vous me croyez, n'est-ce pas ? ». Ensuite, ils s'étaient levés pour faire une exhibition remarquée sur la piste. Vers minuit, après force subterfuges, M. Lemoine et sa bande parvinrent à « récupérer leur cavalière ». Etait-ce pour fêter cette espèce de semi-victoire qu'il s'était ensuite approché des tabourets de M. Goude et de Cellou et avait dit, suffisamment fort pour qu'il soit entendu du dehors :
— Enfin, il était temps ! Au moins, en voilà une de récupérée !… (Puis, se tournant vers les autres :) N'avez-vous pas remarqué combien il est devenu impossible de vivre sa vie au Buffet de la Gare depuis qu'on laisse entrer n'importe qui ?
— Dis-nous tout, Lemoine, sois pas hypocrite ! avait baragouiné M. Massaloux depuis le fond de la salle de danse où il cuvait son vin… Ils sont tous puants, tous obsédés ! Ils nous font tous chier, en particulier l'apprenti dandy que tu as en face de toi. Dis-le ! Il ne peut pas voir une des nôtres, celui-là, sans éclater sa braguette ! La faute à qui ? A nos crétins de politiciens ! A ce rythme-là, bientôt nous serons tous grillés. Exactement comme en Indochine ! C'est maintenant que nous devons réagir si nous ne voulons pas porter le hamac à leur place…
Tout aurait dû en rester là. On avait mis sur le tourne-disque un trente-trois tours. Et le public avait oublié l'incident pour chanter à tue-tête :
Tous les deux, corps à corps, chérie,
Perdus dans la danse où l'on va s'unir
…………………………
Les tangos langoureux et mystérieux
Éveillent nos désirs,
Sachant que viendra l'heure du plaisir…
Mais voilà, Cellou s'était mis à confier sa solitude et ses tourments à M. Goude en s'aidant d'un nombre impressionnant de Vermouth. Et, pour citer une nouvelle fois M. Goude, « soudain, il s'est mis à se redresser et à chanceler sous mes yeux et tout s'est passé comme dans un rêve, seulement, quelques secondes plus tard, il était affalé sur les graviers du jardin avec une énorme tache de sang sur la pochette de son smoking ».
Il finissait juste d'insulter M. Lemoine quand le coup de feu partit, puis on avait vu ce rouquin — le plus gras et le plus petit du trio — descendre du perron et s'avancer vers le milieu du jardin, un pistolet à la main :
— Chez nous autres, à Abengourou, on ne permet pas aux macaques d'emmerder les compatriotes !
M. Massaloux, qui était sorti de la salle pour voir, hurlait comme un fou en se frottant les yeux :
— Nom de Dieu de nom de Dieu, pas ça, nom de Dieu ! Tout de même pas ça, non, non pas ça !…
Il traîna pendant des semaines une gueule qui faisait penser que l'on venait de tuer son cousin ou son puîné et non son rival. Arɗo, que cette colossale anomalie ne lassa pas d'intriguer, finit tout de même par trouver une explication avant de mourir à son tour :
— Le poète, il le voulait pour lui, ce chacal de colonialiste, et qu'il le griffe et qu'il l'émascule et qu'il lui découpe les viscères pour y insuffler ses injures de dogue et de grand frustré... Vous ne voyez pas ça, vous, non ?
Il avait peut-être raison, comme souvent ce fut le cas, en particulier quand il disait que l'air de Mamou attirait les malfrats et les gueux, les fous, les monstres inimaginables.
Quoi de plus naturel que d'abriter une telle populace, s'agissant d'une bourgade conçue sous les funestes auspices du chemin de fer ! Car, la vieille pute, pour reprendre le terme des anciens, n'apporta pas au pays que la disette et les travaux forcés, les pastilles Valda et le choléra. Elle ensemença aussi dans son ventre cette chose ni belle ni opportune mais qui à force de candeur et de bluff en est devenue, en un siècle à peine, l'âme et le coeur, tout à la fois. Et par la faute de qui, ô divinités imprévisibles ? D'un aventurier auvergnat, douteusement anobli au Portugal et qui rêvait de se tailler une Colonie personnelle entre la côte et Tombouctou, et qui y croyait si fort qu'il avait minutieusement noté sur un papier la carte de ses chimères. Oui, c'est à lui, Olivier de Sanderval, que, plus tard, le gouvernement français piqua l'idée d'un chemin de fer entre Conakry et Kankan.
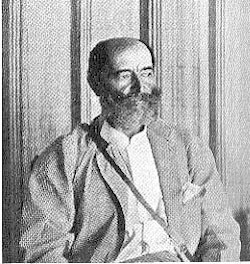
Seulement, des raisons budgétaires l'amenèrent à contourner les contreforts du Fouta-Djallon par l'extrême sud. D'où la nécessité d'une ville-relais à même de faire écouler par le transport ferroviaire le latex et la cire produits sur les montagnes. Mamou — cité sans nom et sans mémoire (juste ce qu'il faut de passion et d'amour-propre) — était condamnée dès l'origine à tenir lieu de bordel, d'asile et de bivouac !
Comment expliquer sinon que M. Massaloux échouât ici et pas ailleurs, après les tribulations que l'on devine rien qu'à voir ses sourcils ? Comme pour King-Kong, comme pour Cellou, comme pour bien d'autres énergumènes illustres ou inconnus, par ce phénomène mystérieux qui fait que la singulière odeur de la ville finit toujours par rattraper les faiseurs et les âmes en peine. Un de plus, un de moins, c'est ainsi que M. Massaloux plongea à son tour dans ce flux envoûtant et déchaîné qui irrigue l'âme de la ville. Il semblait tout droit échappé de la guerre d'Indochine. Il avait encore les cheveux ras, le visage ingrat d'un repris de justice, avec des yeux si profonds qu'il fallait chercher son regard. D'après Bentè, la première fois qu'on le vit, il ne portait qu'un tricot de corps passablement effiloché, une culotte de toile d'Irlande, des Pataugas et un vieux chapeau de paille. Il transpirait avec jouissance et scrutait les coteaux et les manguiers comme s'il en connaissait déjà toutes les fourmis et tous les margouillats. Bref, on ne s'étonna ni de le voir en ces lieux ni de l'entendre blasphémer au moindre petit prétexte. Et quand il ouvrit son garage à la sortie de la ville, sur la route de Labé, tout le monde savait qu'il ne pouvait faire que ça pour avoir déjà considéré ses poignets et biceps.
— Son sexe aussi doit être celui d'un mécanicien, avait prévu Arɗo.
Il inaugura ses premières bagarres avant d'avoir apposé un nom sur le fronton de son garage. A la Pergola, il lui fut vite signifié que, dorénavant, il ne pouvait être admis qu'en arrivant à jeun. Mais il avait fêté le troisième anniversaire de son affaire quand Mlle Saval descendit pour la première fois de la Micheline de Conakry.
A l'arrivée de la jeune femme, les esprits fins crurent observer une légère amélioration de son foutu caractère. Il s'acheta une veste d'alpaga et des souliers en peau de crocodile. Il se rasa la barbe et s'employa à amenuiser la rudesse de son vocabulaire. ll l'amena valser dans les bals du Buffet de la Gare mais finit par s'asseoir et la regarder danser avec un autre pour faire cesser les moqueries. On se prit à l'inviter dans les dîners de Dumez et à l'appeler autrement que « notre brave grand soudard ».
Les week-ends, il lui apportait des fleurs et s'asseyait longuement devant elle dans le salon de la maisonnette de la Poudrière et puis il repartait avec l'air enjoué d'un homme dispos et comblé. Binta, sa petite boyesse, traversait la ville plusieurs fois par semaine pour apporter à la Poudrière un livre ou une bouteille, accompagnés le plus souvent d'une longue lettre d'amour écrite à l'encre violette. On les avait déjà mariés, comme plus tard il en serait de même pour Cellou. Et puis leurs liens se distendirent.
— Il ne doit plus beaucoup bander, ce couillon de Massaloux !, expliqua alors Arɗo.
Ils ne se voyaient pour ainsi dire plus quand Cellou apparut dans son sillage. Cependant, revenant du bar, on pouvait l'entendre, certains soirs, cogner sur les persiennes :
— Irène, tu dors ? C'est-il vrai, ma petite chérie ?… C'est Jacques, oui, oui, Jacques ! Allez, ouvre-moi, ma cocotte ! Nous sommes bien condamnés à nous entendre, tu sais, au point où nous en sommes tous les deux… Peux-tu me dire pourquoi tu n'as jamais voulu de moi ? C'est bien simple : alors, fallait pas venir ici…
Il commençait par gratter la fenêtre en l'appelant par des mots doux et, comme jamais elle ne répondait, il s'énervait assez vite :
— Non mais, nom de Dieu, tu vas ouvrir cette putain de fenêtre, oui ! Ah, parce que tu t'es encore foutu des boules Quiès ! Tu ne sais pas ce que je vais faire, je vais tout simplement te les arracher, tes foutues boules Quiès !
Généralement sortait de la nuit noire un groupe de vieilles femmes qui le regardaient sans rien dire jusqu'à ce qu'il pleure. Alors, il tournait les talons en grelottant comme une chèvre malade et répétait, jusqu'à ce qu'il dépasse la clôture du cabanon :
— C'est pas moi qui ai fait ça ! Ça, ça se peut pas… Bon Dieu de bon Dieu !…
Quand il sut qu'elle frayait avec Cellou, il brisa la porte, aidé de son pied-de-biche, et les retrouva dans la chambre. Il invita le poète à venir dans la cour, là où il n'y avait ni verres ni bimbeloterie ni rien d'autre de cassable pour voir un peu s'il était un homme. Mais Mlle Saval remit ses boules Quiès et Cellou s'enveloppa d'une couverture et se tourna vers la veilleuse pour lire L'Après-midi d'un faune. Il resta planté à deux mètres du lit, les mains dans les poches, et les regarda en silence, ployé de rage et d'impuissance. Il ressemblait à une mer en furie incapable d'atteindre la côte. L'attitude du couple couché dans le lit, au lieu de le pousser vers l'accomplissement du crime, déviait sa haine sans en altérer la force, la retournait contre lui-même. Il brisa le grand bonze en porcelaine posé sur la table de chevet, shoota nerveusement dans les débris. Il s'assit sur la chaise sur le dos de laquelle Mlle Saval avait négligemment posé sa robe de chambre. Il soliloqua longtemps, laissant sa main ensanglantée s'égoutter comme un vieux linge sur le carrelage de faïence. Et c'était une voix sombre, venue du fond de sa détresse, qu'il essayait en vain de maîtriser mais qui s'engluait de catarrhes et tremblait toute seule.
Tout y passa : ses sentiments d'amant éconduit, son amertume de colon menacé dans ses droits et son profond mépris de soldat pour son gringalet de rival qui, en plus de sa mollesse, se targuait d'être poète. Cela dura une nuit. Il transpirait abondamment (les idées et les mots devaient lui sortir des pores), s'essuyait le front sur la manche de sa chemise, tapait machinalement du pied, alternant sans transition des cris de grand sauvage et des propos retenus.
Chaque fois qu'on le croyait calmé, sa mauvaise bile resurgissait, plus drue et plus noire encore. Il ne pouvait plus s'arrêter malgré la fatigue, malgré le sang qu'il avait perdu. Ses paroles venaient toutes seules, poussées par une envie soudaine et folle de barrir et de mordre. Mais il était seul, trop seul, une pâle et lointaine étoile devant la mer indifférente du couple couché dans le lit. Une seule fois, Mlle Saval avait daigné ôter ses boules Quiès pour interroger Cellou :
— Tu ne voudrais pas un verre de lait frais ? Je trouve qu'il fait chaud.
— Non, avait répondu celui-ci.
Et elle s'était levée, drapée d'un drap de lit, pour aller vers le frigo.
M. Massaloux s'était tu un moment pour la regarder se désaltérer avec des chuintements voluptueux. Aux alentours de l'aube, il se décida enfin à s'en aller, non sans avoir dit son dernier mot debout dans l'embrasure de la porte :
« Eh bien, je m'en vais ! Regardez bien, je m'en vais ! C'est bien ça que vous voulez ? Seulement, je vous le promets, cela ne va pas se terminer aussi paisiblement que vous le souhaitez. Toi, le dandy, je trouverai un moyen de t'embêter puisque tu persistes à te cacher derrière tes faux airs de bourgeois pour refuser de te battre. Monsieur ne se bat qu'avec les rimes… Un Nègre devenu poète, entendez-moi ça ! Oh, tu as bien raison ! Avec toutes ces stupidités qu'on vous a foutues dans la tête ! Tu t'y crois déjà, hein, dans ta foutue Indépendance ! Eh bien non, mon vieux, le pognon plein la brousse et les harems de femmes blanches, ça n'existe nulle part, même pas dans les contes.
L'Indépendance, vous ne savez même pas ce que c'est pour pouvoir y penser… Et viendrait-elle par erreur divine que je me ferais un plaisir de la pulvériser rien que pour redonner à ta petite gueule sa vraie nature de sauvage. Parce que, oui, nom de Dieu, je pourrais guérir de tout, des foutaises de ta débauchée par exemple, mais pas de ton mépris à toi. Me faire snober par un macaque à lunettes, c'est bien ça qu'on appelle le monde à l'envers. Allez, à bientôt, mon petit civilisé !…
Quant à toi, Irène (oh, es-tu seulement lucide pour pouvoir m' écouter ?), tu serais deux fois naïve de croire que ces gens-là sont capables d'amour : primo, ils ne connaissent rien aux fleurs, secundo, il faudrait être un saint pour oser les embrasser, tellement ils puent des aisselles et du bec !
Et puis, ils sont tous tubards quand ils n'ont pas la lèpre. Libre à toi, poupette, si tu préfères la vie des bêtes ! Seulement, personne ne pourra rien pour toi une fois que tu auras mis les deux pieds dans leur barbarie. Il n'y a pas que la peau qui est méchante et noire par ici, tout est cannibale et laid : le climat, les rites, le relief et la bouffe. On a vite fait de s'y perdre quand on est une pauvre petite Blanche sans cervelle ni expérience. Sur ce, je m'en vais, oui oui, cette fois, je m'en vais. C'est bien ce que vous voulez, non, que je vous débarrasse de ma laideur ? Eh bien, c'est fait. Un conseil, cependant, profitez du temps qui vous reste, fricotez tout votre soûl, car, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas tarder à me revoir… »
Les mois suivants, il noya son dépit dans le vin rouge, le plus souvent assis sur la terrasse du Café de la Poste. Mais, après la mort de Cellou, il réapparut pour harceler la jeune femme d'une ardeur renouvelée. Il devait se trouver non loin d'elle le jour où elle grava sur la tombe ces mots restés saugrenus pour la plupart des Mamounais :
« Ô de notre bonheur, Toi, le fatal emblème !… »
Une négresse.
[ Home | Etat | Pays | Société | Bibliothèque | IGRD | Search | BlogGuinée ]
Contact : info@webguine.site
webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2015 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.
Fulbright Scholar. Rockefeller Foundation Fellow. Internet Society Pioneer. Smithsonian Research Associate.