Gouverneur du Territoire
Editions guinéennes. Conakry. 1951. 280 p. cartes, illust.
Le Gouvernement français se préoccupe actuellement de trouver un pays producteur pour remplacer l'Indochine défaillante dans la fourniture du riz à la Métropole et aux autres territoires de la France d'Outre-Mer. De tous les territoires d'Afrique il semble que la Guinée, en raison de la nature de son sol, des conditions climatiques et des aptitudes de ses habitants soit la seule capable de jouer ce rôle. Cette solution peut même très rapidement être mise en oeuvre, car la culture du riz est dès maintenant une culture de base de notre territoire et elle connaît actuellement un essor qui permet d'envisager facilement les conditions d'un développement correspondant à ce nouveau débouché.
La production actuelle de la Guinée en riz peut être évaluée à un tonnage variant entre 180 et 200.000 tonnes. Sur ce total, 25.000 tonnes environ passent par le circuit normal du commerce, le restant étant consommé sur place ou négocié en dehors du marché officiel.
Cette production, déjà en soi très importante, est actuellement en voie d'accroissement constant. Les raisons en sont multiples : tout d'abord, la demande des consommateurs locaux se fait de plus en plus forte, le riz étant une céréale nouvelle importée dans le territoire depuis quelques dizaines d'années et qui tend à se substituer de plus en plus dans l'alimentation indigène à des céréales traditionnelles telles que le fonio ou le mil; d'autre part les méthodes de culture tendent à se transformer de fond en comble. Au début de son introduction, seul le riz de montagne était connu des indigènes, la culture se pratiquant, selon la méthode primitive des brûlis à flanc de montagne dans des conditions où le rendement était tout à fait médiocre parce que cette variété est, en elle-même, peu productive, que le travail de pareilles terres est extrêmement pénible et lent et qu'enfin il en résulte un tel gaspillage du sol que les surfaces qui peuvent y être consacrées tous les ans sont extrêmement restreintes.
Cet état de chose est heureusement en train de changer sous l'action des services techniques: forêts et agriculture, des commandants de cercles et avec l'aide fréquente des « élus » , les cultivateurs semblent comprendre de mieux en mieux qu'ils ont intérêt à abandonner des méthodes dont le seul résultat est d'aboutir à une déforestation catastrophique des régions où elles sont pratiquées alors qu'elles sont d'un rendement extrêmement faible et ne permettent pas une extension des cultures.
Depuis la fin de l'effort de guerre, la Guinée s'est donc engagée dans la voie nouvelle de la culture du riz de plaine ou riz de marais et l'on peut dire aujourd'hui que le tournant de notre agriculture est pris définitivement dans cette direction.
Ces nouveaux procédés permettent à la fois de substituer au riz de montagne, des variétés plus productrices, à bien meilleur rendement, une plus grande facilité dans le travail des sols et surtout l'utilisation des terres alluvionnaires des vallées et des plaines qui sont autrement plus riches que les flancs de montagne et permettent de mettre un terme à la déforestation des pentes. Cette affaire a été menée à la fois sur le terrain scientifique et technique et sur le terrain de l'économie appliquée.
Tout d'abord, les centres expérimentaux du service de ]'Agriculture dans les deux grandes fermes expérimentales de Tolo au Fouta et de Bordo en Haute Guinée et au Centre de cultures mécaniques de Siguiri, ont sélectionné les variétés de riz de marais à gros rendement les mieux adaptés aux conditions spéciales de la Guinée, et mis au point les conditions optima d'irrigation dans lesquelles il doit pousser ainsi que le processus de rotation des cultures le plus propre à assurer la régénération des sols.
Ces -essais ont abouti à des résultats concluants qui peuvent être considérés comme définitifs. En même temps, ces études permettaient d'expérimenter les procédés d'établissement des barrages, canaux d'irrigation ou d'assèchement, l'utilisation des engins mécaniques sur grandes surfaces pour la préparation et le façonnage des terres et même les transformations à apporter dans l'organisation coutumière des cultures par suite de la substitution du tracteur de 60 chevaux travaillant sur de grandes surfaces à l'homme travaillant à la daba (l ) ses petits lougans (2) familiaux, Reste encore à mettre au point les installations mécaniques pour le décorticage et le traitement du riz. Deux usines actuellement en cours de réalisation seront mises d'ailleurs cette année en fonctionnement dans deux de ces centres d'essais.
Parallèlement à ces études techniques, l'aménagement des rizières des plaines et des vallées a été entrepris dans les deux grandes zones favorables de la plaine littorale d'une part, les bas-fonds et les vallées des montagnes de l'intérieur, d'autre part.
Pour la zone littorale, la situation de la Guinée est exactement semblable à celle de la Colonie voisine : la Sierra Léone qui a su faire un immense grenier à riz de toutes ses plaines alluvionnaires et deltatiques qui s'étendent entre le Massif Eburnéo-Guinéen et la mer. L'aménagement consiste en général à empêcher par les digues l'envahissement des rizières par les 'eaux de mer, à assurer le dessalement grâce au ruissellement des eaux de pluie, enfin à équiper ces terres d'un réseau de canaux de drainage et de chemins de circulation. C'est par millions d'??? déjà été réalisé au, cours de la guerre par l'Administration du Territoire dans le cercle de Boffa.
C'est le casier rizicole du Monchon qui couvre 2.000 hectares de rizières. Des plantations privées ont fait de même. La plus typique est celle 1 de Koba qui, à d'autres fins d'ailleurs que la culture du riz, a mis aussi en valeur 750 hectares. Enfin, certaines tribus indigènes de la zone littorale appliquant de vieilles techniques dont l'origine se perd dans la nuit des temps, ont réussi néanmoins des aménagements remarquables.
Le dernier en date qui mérite d'être cité en exemple en raison de la technique avertie et de l'esprit de solidarité avec lequel il a été exécuté, est celui de l'île de Kaback, grenier à riz de notre ville de Conakry. 1.500 hectares y ont été mis en rizière grâce à un travail savant qui rappelle l'aménagement des polders par les Hollandais : ceinturage des trois quarts de l'île par un système de digues qui protègent les rizières contre la mer. Cet ouvrage a été exécuté et est entretenu par des équipes de jeunes travailleurs groupés en association coutumière de génération appelées Socis. Poursuivant ces exemples et les multipliant, un certain nombre de travaux plus ou moins importants du même ordre sont actuellement en cours tout le long des plaines littorales. Nous citerons pour mémoire l'aménagement actuel dans la plaine de Bentimodia qui permettra de cultiver 2.000 hectares ou, tout proche de Conakry, l'aménagement plus modeste de la rizière de Dubréka.
Pour la zone des montagnes de l'intérieur, le mouvement est également déclenché, la descente des cultures des flancs des vallées vers leurs bas-fonds après s'être fait sporadiquement partout où cela était possible, sans ouvrages, se fait maintenant sur une plus grande échelle, avec construction de barrages et de canaux d'irrigation. Le mouvement a particulièrement démarré au cours de l'année 1948 : une vingtaine de barrages sont actuellement en cours de construction permettant d'aménager vingt vallées. La population apporte de plus en plus son concours bénévole à des travaux dont elle comprend toute l'utilité. L'objectif qui a été fixé est d'avoir, dans le plus bref délai, dans chacun de nos cantons, au moins une vallée d'aménagée avec des ouvrages simples qui puissent être réalisés par la main-d'oeuvre coutumière sous la surveillance du Commandant du cercle ou d'un conducteur agricole. Le financement est assuré par les Sociétés de Prévoyance qui, à cette fin, ont cette année notablement augmenté leur taux de cotisation. Dans certaines régions, c'est une véritable émulation qui se manifeste entre cantons pour la construction de ces ouvrages. Certains aménagements en cours sont d'ailleurs extrêmement intéressants tels que celui de la plaine du Niekolé dans le cercle de N'Zérékoré ou la plaine du Koloun dans la Subdivision de Tougué.
L'effort le plus massif a été fait dans la région de Siguiri. Depuis trois ans, sous la surveillance du service de l'Agriculture, les vallées affluentes du Niger ont été équipées de 40 ouvrages principaux et 200 ouvrages secondaires permettant de mettre 13.000 hectares en culture sur lesquels 1.200 seront, cette année, façonnés mécaniquement grâce à une brigade de 10 tracteurs spécialement constituée à cet effet.
Comme on le voit, le départ est pris très sérieusement, tant dans le domaine des études expérimentales que dans celui des aménagements pratiques. Le mouvement a rencontré l'adhésion spontanée des populations; il suffit donc de l'accélérer en l'encourageant financièrement et techniquement pour apporter à l'Union Française le surcroît de production de riz qui nous est aujourd'hui réclamé. Les résultats à en attendre sont particulièrement intéressants, car les rendements déjà atteints sont relativement élevés. Dans la zone littorale, nous pouvons compter dans une année moyenne sur 2 tonnes à l'hectare dans les zones cultivées à l'européenne. 1,5 tonne à 1,8 tonne dans celles cultivées par les indigènes. Dans les zones de l'intérieur, le rendement varie de 1,5 tonne à 1,8 tonne à l'hectare dans les rizières à direction européenne, de 1/8 à 1/2 tonne dans les rizières indigènes. En reprenant le chiffre moyen d'une tonne à l'hectare, on arrive donc à cette constatation qu'il suffirait d'aménager une surface de 66.000 hectares pour donner, dans un délai très rapide, puisque les travaux d'aménagement sont très simples, une récolte annuelle de 180.000 tonnes de riz. Or, ce n'est pas par dizaines de milliers d'hectares qu'il faut compter les possibilités d'aménagement du territoire guinéen, mais par centaines.
Enfin, dernier avantage, le coût de l'opération est relativement très peu élevé. Ces aménagements n'exigent que des travaux extrêmement simples : barrages en terre ou levées, petits déversoirs légers, vannages primitifs. Avec les méthodes qui sont actuellement employées, le prix moyen de l'aménagement serait d'environ deux millions et demi pour cent hectares dans l'intérieur et de l'ordre de trois millions environ dans les plaines littorales. C'est-à-dire que si l'on veut s'en donner la peine, compte tenu des conditions extraordinairement favorables que présente la Guinée pour la culture du riz, ce territoire peut demain devenir le grenier à riz de l'Afrique Française.
Le Cercle de Forécariah, au sud de la presqu'île de Conakry, a été appelé le cercle des rivières du sud. La côte de l'Estuaire de la Soumbouya à celui de la Mellacorée est une succession d'estuaires et d'îles sans relief entre lesquels remonte la marée. C'est le domaine du poto-poto, des palétuviers... et des moustiques. Parmi ces îles, longtemps mal connues parce que d'accès difficile, le Kaback est l'une des plus riches.
Située à un demi-kilomètre du rivage, entre les estuaires de la Morebaya et de la Forécariah, cette île a vaguement la forme d'un rectangle de 14 km. de long sur 6 ou 7 de large. La barre dangereuse à franchir au sud de l'île et les rochers qui barrent l'estuaire de la Forécariah à l'est, l'ont faite appeler, par ses premiers occupants, Mandenyi : « Kobinni » (en soussou : Kabani), l'endroit qu'on ne peut dépasser.
Le Kaback est le grenier de Conakry et des environs de la capitale guinéenne. Il doit surtout sa richesse à la culture de riz. Les 4.000 hectares de terres cultivées lui donnent une production moyenne de 3.500 tonnes de riz par an.
La fertilité du sol permet, en saison sèche, de cultiver sur les terres à riz, le manioc, la patate, le maïs et le fonio.
Autour des villages, les habitants ont souvent de petites plantations de bananes et d'ananas. Chaque « carré » possède des arbres fruitiers : cocotiers, kolatiers, manguiers, orangers, papayers, avocatiers. L'ouest et le sud de l'île ont conservé de belles palmeraies, exploitées en commun, pour production des palmistes et de l'huile de palme.
Près du littoral, de nombreux pêcheurs fument leur poisson qu'ils vont vendre à Conakry; les femmes et les enfants fabriquent du sel par ébullition de l'eau de filtrage des vases,
Enfin, le bois de palétuvier, très recherché comme bois de chauffage, est une richesse inépuisable pour ceux qui l'exploitent et pour les patrons des côtres qui les transportent à Conakry.
Grâce à des travaux variés, les populations jouissent ici d'une aisance certaine; aussi, tout au long de l'île, c'est une même image d'opulence ordonnée qui frappe l'esprit.
Les recensements officiels donnent, pour le Kaback, une population de 3.363 habitants.
Mais à ces chiffres, déjà importants pour la superficie de l'île, il faut ajouter environ 1.500 personnes recensées dans les cantons de Moréah et de la Mellacorée (cercle de Forécariah) et le canton de Soumbouya (cercle de Dubréka).
Ces agriculteurs sont venus au Kaback pour constituer par les excellentes terres à riz des « Dakhas » , villages de cultures ; au moment des pluies, entre la période du repiquage et la période de la récolte du riz, ils se retirent dans leur village d'origine. Cette migration à cause économique et récente, remontant environ à une trentaine d'années.
Pour évacuer leurs produits vers Conakry et Coyah, les Villages du Kaback ont dû défricher la mangrove et créer, sur la Côte, des points d'embarquement. Chaque village a les siens. Les plus importants sont : N'Sambo, Keninde et Kônimodouya pour Gémétaye, N'Koumen, Kamen et Bolemenda pour Gbéma. En hivernage, les pistes qui conduisent dans le poto-poto jusqu'à mi-jambe quand ce n'est jusqu'à mi-cuisse.
Il existe, au Kaback, deux sortes de cultures du riz : celle qui se fait en terrain légèrement exondé et celle qui se fait en terrain inondé. La première est la culture traditionnelle et de toujours; la deuxième, plus récente, se fait sur des terrains sur les palétuviers et protégés par des digues. Il n'y, "a guère plus d'une cinquantaine d'années que les habitants de l'île ont emprunté aux Bagas et dernier mode de culture qui a décuplé la richesse du Kaback. Au début, on fut obligé de faire venir des ouvriers bagas de Boké et de Boffa pour construire les diguettes, mais les cultivateurs ont vite appris à faire eux-mêmes ce travail qui ne nécessite aucune connaissance spéciale.
Les rizières inondées ont l'aspect d'un vaste quadrillage. Les casiers, de dimensions variables, sont séparés par des digues de 1 m. de haut et de 75 cm. de large, doublées de chaque côté par des drains destinés à enlever l'hypersalinité de la terre. Un système rudimentaire de vannes permet à l'eau de circuler à travers les champs pour éviter que les plants ne pourrissent.
Les « Anciens » du Kaback ont conservé le souvenir d'une époque où on se contentait de semer le riz et d'attendre la récolte, mais peu à peu, les habitants ont appris la technique du repiquage; enfin, depuis une trentaine d'années, ils savent sélectionner les semences et utilisent de façon judicieuse riz hâtifs et tardifs, ces derniers étant cultivés dans les terrains que les remontées de marées n'atteignent pas.
Chaque année, les mois de mars et avril sont consacrés à la réparation des digues et, pour certains, au défrichement d'une nouvelle terre à riz qui fera reculer la limite des palétuviers. Pour la construction et la réparation des digues, les habitants du Kaback ont adopté le « Kôfi » des Bagas, sorte de pelle plate en bois très dur, cerclé de fer tranchant, outil parfait pour ce genre de travail. En mai, les associations des travailleurs, dont nous reparlerons plus loin, labourent et ensemencent les pépinières pour le riz hâtif. La terre est labourée sur une profondeur de 10 à 15 cm. à l'aide d'une « Daba » , outil peu pratique, formé d'un fer étroit et recourbé, s'adaptant sur un manche très long. Un tiers environ de la production de Kaback est en riz précoce. Les principales variétés cultivées sont le Kaolack ou Ledd et le Twenty four, importés de Sierra-Léone.
Fin juin voit le labour des pépinières pour riz tardifs, dont les variétés principales sont : le jardin, importé d'Indochine vers 1911, le Yaya, le Toma, le Fossa et le Yaka. Juillet s'affaire au labour des champs pour riz précoces et août l'imite pour les riz tardifs. La fertilité des terres permet, chaque année, de cultiver les mêmes champs, sans assolement.
Du début août jusqu'en fin septembre pour les riz précoces, et jusqu'en novembre pour les riz tardifs, hommes, femmes, enfants, sociétés de travailleurs, toute la population à demi-nue, les jambes enfoncées dans la vase jusqu'aux genoux, pratiquent le repiquage. Le riz enlevé des pépinières est repiqué par paquet de dix à quinze chaumes, à quinze centimètres de distance environ.
La récolte commence en novembre pour les riz hâtifs et en janvier pour les riz tardifs, Tous les membres de la famille coupent les épis avec une sorte de serpette, les lient en bottes et les transportent au village où on les fait sécher en les disposant sur des bâtons horizontaux placés à 1 m. 50 où 2 m. au-dessus du sol. Un mois après la récolte, les femmes procèdent au battage du riz, en foulant les épis avec leurs pieds.
Chaque année, au début de la récolte, la fête du riz donne lieu à de grandes réjouissances. Dans tous les villages, chaque chef de carré sacrifie un mouton à la mémoire de ses ancêtres.
On prépare de plantureux repas composés de riz et de viande qu'on apporte au pied de l'Arbre des Ancêtres, le plus souvent du fromager séculaire. Le Bari Ki (Bari en soussou) revenant, sorte de sorcier du village, s'approche de l'arbre en faisant tinter une clochette pour appeler les Ancêtres par des formules magiques; il implore la bienveillance de ceux-ci et, leur présentant les plats de riz, la viande et les colas apportés par la population, il demande aux Ancêtres s'ils sont satisfaits. Pour écouter leur réponse, il colle son oreille au tronc, de l'arbre puis revient vers tel ou tel Chef de carré, lui disant que ses ancêtres estiment qu'il est assez riche pour donner davantage. Lorsque, enfin, tous les ancêtres sont satisfaits et qu'ils ont promis une bonne récolte, toute la population prend son repas près de l'Arbre ; chacun est censé manger la part que lui a donnée les ancêtres. Le repas terminé, on danse près de l'arbre et, le soir, chacun rentre chez soi, laissant sur place de nombreux plats de riz, la viande et les colas que les « ancêtres » n'ont pas distribués.
Les rizières du Kaback produisent, en moyenne, 3.500 tonnes de riz par an. Sans augmenter la superficie ou le rendement à l'hectare, problème que nous envisagerons dans notre conclusion, ce chiffre pourrait être supérieur si les grandes marées ne détruisaient très souvent une partie des récoltes (5 à 10 %, et s'il n'arrivait que certaines années peu pluvieuses (1941-1947) voient remonter, dans certains terrains, l'eau salée qui, n'étant plus équilibrée par les eaux de pluies, pénètre par capillarité.
La plus grosse partie de la production est consommée sur place, le reste, un millier de tonnes environ, s'en va vers deux centres principaux d'attraction : Conakry et Coyah. Un coup d'oeil sur la carte montre la proximité de ces deux centres ; par vent favorable, il faut trois ou quatre heures à un cotre à voile, pour aller de N'Sambo à Conakry ; il faut deux à trois marées pour aller à Coyah ; Forécariah est trop loin puisqu'il faut cinq à six marées pour y aller. Une autre raison de l'attraction que Conakry exerce sur le riz du Kaback, c'est que ce centre est mieux achalandé en tissus, articles de ménage, outils et matériel nécessaire à la batterie. Enfin, c'est à Conakry et à Coyah que les habitants du Kaback vont vendre leur bois de palétuvier et leur sel ; il est normal que le riz emprunte les mêmes cotres et parte dans les mêmes centres.
Une dizaine de petits commerçants indigènes sont installés dans l'île, mais ils achètent peu de riz car leurs moyens financiers sont limités et leurs boutiques ne contiennent que peu de marchandises vendues à des prix exorbitants. Aucune maison de commerce française, aucun commerçant libanais n'est installé dans l'île. Après plusieurs essais, la colonie libano-syrienne de Forecariah a renoncé à s'établir au Kaback parce que cette région, infestée de moustiques, est réputée très malsaine.
Chaque année, au moment des récoltes, une multitude de gens viennent au Kaback pour acheter du riz ; ce sont des indigènes envoyés par les commerçants libano-syriens de Conakry, puis un certain nombre de petits détaillants « tabliers » 3 de Conakry venant acheter du riz en quantités peu importantes et proportionnées à leurs fonds disponibles, ensuite les Chefs de famille de Conakry (notables et fonctionnaires) qui envoient un des leurs pour acheter le riz nécessaire à la consommation familiale, enfin les producteurs vont souvent vendre eux-mêmes leur riz à Conakry et à Coyah.
La récolte du riz hâtif est à peine terminée que les habitants du Kaback labourent à nouveau les champs sur lesquels on avait cultivé le riz pour y planter du manioc. Cette culture était, il y a peu d'années encore, strictement familiale, mais le développement des associations de travailleurs a permis l'extension des surfaces cultivées. La terre labourée est ramenée en buttes de 50 cm de haut sur lesquelles on plante les boutures de manioc ; la nature fait le reste. La récolte a lieu en mars; une partie est expédiée sur les marchés de Conakry et de Coyah.
La patate est cultivée de la même façon ; semée en janvier, elle est récoltée fin avril.
De nombreux habitants ont leur petite plantation de 500 à 1.500 pieds de bananiers à Manéah et quelques planches d'ananas. Des dioulas venus de Conakry achètent les bananes à raison de 100 francs le régime. Dans le premier semestre de 1949, le Kaback a expédié en moyenne 3 à 4.000 régimes par mois. Quoi qu'en pensent certains paysans novateurs, la banane n'est pas à répandre dans le Kaback, les cultivateurs n'ont ni les terrains, ni le métier nécessaire et ne pourront lutter contre les planteurs de profession en période d'économie normale. Les hameaux du Kaback sont de véritables vergers. Manguiers, orangers, avocatiers, citronniers, kolatiers, papayers et cocotiers entourent les cases et ombragent les concessions. Tous ces arbres fournissent des fruits pour la consommation locale, seule une partie des noix de kolas et cocos est vendue à Conakry.
L'île possède actuellement 15.000 cocotiers de belle venue, et fructifiant à merveille. L'indigène n'a pas encore appris à utiliser les fibres de cocos et à fabriquer le coprah ; il vend ses noix 3 ou 4 francs pièce à des dioulas de Conakry qui expédient sur la Métropole.
Le kolatier est aussi à encourager dans cette région ; cet arbre paie tardivement, mais il paie bien. Dans l'île, il donne deux récoltes par an :
L'attention de l'Administration a été attirée, dès 1936, sur la plaine de Monchon, par suite d'une baisse marquée dans le tonnage de riz commercialisé dans la région. Une enquête montra que les cultivateurs étaient obligés d'abandonner, chaque année, une partie de leurs rizières, en raison de trop fortes inondations.
Les coordonnées géographiques de la plaine de Monchon sont, en gros, les suivantes: 10°24' L.N., 16°29' L.W. Administrativement, le canton de Monchon fait partie du Cercle de Boffa, le village de Monchon se trouvant à 70 km. au nord-ouest du chef-lieu de Cercle, auquel il est relié par une route desservant en outre un groupe important de villages (Tanéné, Dentéma, Mintani, Bongolon...).
L'ensemble de la population est de race Baga, bons riziculteurs, connaissant l'emploi des canaux pour le drainage des eaux et des digues pour empêcher la remontée des eaux salées.
La plaine de Monchon est le type des plaines littorales, sillonnées de marigots et où l'action de la marée se fait sentir dans les parties basses. La végétation naturelle comprend presque exclusivement des palétuviers « mangrove » en vue de la riziculture.
A première vue, l'aménagement de la plaine de Monchon, de même que celui des plaines de Dentéma et de Dykia, semble aisé à mettre en oeuvre; ces plaines sont encadrées de dunes dont la jonction peut facilement être réalisée par de petits ouvrages, formant ainsi une digue continue.
Les travaux d'études commencèrent en 1937. Des pourparlers furent entrepris, dès cette époque, avec la mission Daudé, pour le lever topographique de la plaine. Un court rapport communiquait, le 1er juin 1938, le résultat de ses travaux. Sur les plans dressés par la mission, un avant-projet fut établi en liaison avec les services de l'Agriculture et des Travaux Publics.
Le problème était le suivant :
Un complément d'études fut demandé, mais l'abondance des précipitations atmosphériques, pendant le mois de juillet, ne permit pas de faire les levers nécessaires. L'ensemble de la plaine varie de la cote 2,8 à la cote 4,5, alors que les marées oscillent entre les cotes 1 et 4. Les îlots inondés en hivernage (dunes où se trouvent les villages) sont à des cotes supérieures à 5.
L'avant-projet élaboré en 1938 fut remanié en 1940 suivant les instructions du Gouvernement général. Les modifications portaient surtout sur des réductions de section des exutoires, par suite de l'insuffisance des crédits disponibles pour cette opération. Le projet initial tablait sur un débit correspondant 'à l'évacuation d'une chute d'eau de 113 m. par jour, pendant une durée de 10 heures (laps de temps entre les hautes eaux) et devait étendre l'action du drainage sur 2.500 ha. Le chiffre fut ramené à 30 mm., ce qui correspond à la moyenne journalière des chutes d'eau réparties sur un mois (à signaler que 900 mm. d'eau pour le mois d'août constitue plutôt un minimum dans la région).
Les travaux furent commencés en novembre 1941 et comportèrent, en premier lieu, l'établissement des digues et de l'exutoire de Bongolon, en béton armé, donnant sur le Yamponi, muni de vannes automatiques.
Le système de drainage axé sur l'exutoire de Bongolon ne fut commencé qu'en 1943, en même temps que la parcellation. Cette même année, 200 ha. furent récupérés.
Au cours de la campagne 1943, il s'avéra que le calcul des canaux avait été fait trop à l'économie. Il fallut augmenter leur section et axer leur action sur un nouvel exutoire.
En effet, le Yamponi étant envasé, ne permettait plus qu'une évacuation insuffisante pour les eaux de l'exutoire de Bongolon. En 1944, tout le système de drainage fut donc relié aux nouvelles sorties de Kamponi et de Tabacourou qui furent créées, la première vers le Yamponi, bief aval de Bongolon, à peu de distance du confluent de ce marigot avec le Colo, le second directement vers le Colo. Ce travail fut terminé en 1945 et subsiste actuellement. Le système de drainage comporte, 118 km. de canaux de toutes dimensions, répartis sur une aire de 975 ha. dont 650 cultivés effectivement. L'effet du drainage se fait sentir sur une surface qui peut être évaluée à environ 2.500 ha. L'évacuation des eaux est assurée, en outre, par un vannage accessoire axé sur le réseau naturel des marigots, avec voie de sortie vers le Koumbia, entre les dunes de Montani et de Dentéma.
Cependant, l'envasement du Yamponi et du Colo se poursuit, très fort pour le Yamponi, moins accentué pour le Colo. Nous avons affaire à un phénomène général intéressant l'ensemble des « Rivières du Sud » , particulièrement au nord du cap Verga. La côte semble rongée par la mer, alors que les plaines côtières ont tendance à devenir des régions continentales par colmatage des nombreux marigots et bras de mer qui les sillonnent. Ces observations ont ramené la mission Francis Boeuf à émettre, en 1946, l'hypothèse que la côte de la Guinée Française est le siège d'un mouvement de bascule, le littoral s'immergeant lentement. L'axe de cette flexure serait très près de la côte. Une autre hypothèse est que les eaux provenant des contreforts côtiers déposent leurs limons au contact de l'eau salée, provoquant l'envasement des cours inférieurs des marigots. Quoi qu'il en soit, il est à craindre que, dans le cas particulier du casier de Monchon, l'exutoire de Kamponi devienne très insuffisant à brève échéance. Il est important de compléter les études topographiques dans le cadre des levers de la mission Daudé, de quelles nouvelles sorties pourraient être trouvées. Il semble que l'évacuation par Kamponi est encore possible en partie, à condition de percer le canal jusqu'à sa rencontre avec le Colo. Cette sortie ne constituerait plus qu'un ouvrage secondaire. L'exutoire de Tabacourou devrait pouvoir fonctionner également encore pendant quelque temps. Par ailleurs, au cours de récentes tournées, un courant a été signalé, par, tant du casier vers Monchon, Moubasso, pour sortir entre les dunes de Dentéma et Mintani, où existe le vannage accessoire. Le lit du marigot mesure de 60 cm. à 1 m. de profondeur. Le cheminement de l'eau est entravé par la pousse d'herbes dans le chenal. Des études sont en cours pour rechercher les possibilités d'évacuation de l'eau dans cette direction, d'autant plus que le lit de la Koumbia est relativement peu envasé, et chercher, ainsi, à créer un exutoire important remplaçant celui de Kamponi défaillant.
En tout cas, la pente étant très faible, un travail de planage rigoureux reste à faire pour éviter la stagnation de l'eau, jusqu'à présent, le travail représentant quelques millions, a été fait avec des « moyens techniques ridiculement insuffisants » (Rapport de la mission Francis Boeuf 1946).
Beaucoup des plaines littorales vouées traditionnellement à la culture du riz sont en voie d'envasement. Pour que la production du riz soit maintenue, voire accrue, pour permettre de ravitailler les centres urbains en plein développement, un effort sera tenté pour la mise en cultures des anciennes rizières et leur extension. La Basse-Guinée est et doit devenir encore plus le grenier à riz le plus important de l'A.O.F. Les travaux de mise en valeur sont prévus au plan de développement du territoire, au moyen de matériels mécaniques puissants et à grand rendement.
Le Professeur Portères estime que 200.000 ha. peuvent être mis en valeur par la riziculture dont 130.000 à relativement peu de frais; les 70.000 autres demandent une étude très poussée, sans que l'opération cesse cependant d'être rentable.
Le casier du Monchon intéresse une population de 8.900 habitants, très intéressante, aimant profondément sa terre, et qui se voyait placée devant l'alternative d'être sous-alimentée ou d'émigrer pour trouver de nouvelles terres de cultures. La production de riz, si elle n'a pas été augmentée, a au moins été maintenue (environ 2.000 tonnes de paddy). Ce résultat était d'ailleurs prévu, la quantité de travail fournie par l'homme ne pouvant être augmentée indéfiniment. La production du riz sera accrue par l'allègement de travail manuel du cultivateur, C'est-à-dire l'emploi de matériel mécanique (il ne peut être question de culture attelée à cause de la trypanosomiase) et la vulgarisation de variétés sélectionnées a meilleur rendement.
Le casier de Monchon possède une collection importante de riz tant locaux qu'importés, notamment de la Station de Rokupr.
En résumé, on peut dire que la création du casier de Monchon est une belle réalisation, faisant honneur à l'effort déployé par l'Administration pour sauvegarder et améliorer le patrimoine foncier du territoire, travail entrepris et mené à bonne fin, soulignons-le encore, avec des moyens très insuffisants.
Un important effort vient d'être réalisé pour l'installation et le fonctionnement de la section Pilote de Siguiri.
Cet organisme a pour but la culture mécanique du riz dans les plaines fluviales de la Haute-Guinée en vue d'accroître la production rizicole.
Il ne s'agit pas pour cela de renoncer, comme certains, ont pu le croire, à la culture attelée qui a déjà suffisamment accru dans ce territoire la productivité du travailleur rural en perfectionnant son outillage et en lui fournissant l'apport de l'énergie animale. Ce mode de culture doit rester en Guinée la base fondamentale de l'agriculture familiale. Tout au contraire, nous cherchons à la compléter par l'apport d'énergie mécanique afin, de développer plus encore la production, en s'évadant cette fois du domaine familial pour passer à celui de l'organisation collective.
C'est, dans ce but que se poursuit l'effort du centre de culture mécanique de Siguiri. La campagne 1949 débuta virtuellement dès août 1948 par la formation de chauffeurs dont l'accroissement du nombre était devenu nécessaire pour la constitution d'équipes doubles et le pilotage de nouveaux tracteurs. En décembre, dix-huit chauffeurs étaient ainsi formés.
Un programme prévoyant le façonnage (labeur et pulvérisage) de 2.000 hectares de terre à riz était établi. La région intéressée par ce projet était choisie et délimitée après accord avec l'Administrateur, Président de la Société Indigène de Prévoyance (S.I.P.), compte tenu des facilités de travail et des besoins des populations de plus en plus démunies de boeufs de labeur par l'épizootie de 1948.
Les travaux préliminaires : constitution de stocks de carburants et lubrifiants, reconnaissance des terrains, tracé des voies d'accès, aménagement des rampes de chargement et de déchargement du gros matériel furent d'abord réalisés avant l'ouverture de la campagne proprement dite de façonnage.
Au 1er juillet, un premier stock de démarrage de 1.000 litres de gas oil et 2.000 litres d'huile était en magasin,
Les pistes d'accès aux plaines à labourer tracées, débroussaillée et nivelées ne dépassèrent pas 8 km. sur la rive gauche, ai vu là proximité du fleuve et de la route, tandis que sur la rive droite, 8 km. de piste devaient être tracés.
Toute cause de retard, de perte de temps ou de réduction de rendement devant être écartées, il ne pouvait être question de travailler au tracteur Sur de petites parcelles isolées à l'inférieur de vastes plaines, mais d'entreprendre le façonnage des plaines elles-mêmes ; pour les mêmes faisons, l'éparpillage des unités mécaniques selon les voeux des bénéficiaires, ne pouvaient non plus être envisagé.
Il fallut tout d'abord convaincre de ces nécessités les populations intéressées. L'accord ayant été obtenu par l'intermédiaire du Conseil d'Administration de la SIP pour le prix du façonnage, labeur et pulvérisage, soit 1.500 fr. l'hectare, plus 150 fr. pour la S.I.P., la campagne de motoculture commençait pratiquement le 6 janvier après la mise en place de tous les moyens d'action : trois tracteurs Clétrac H.D., quatre Caterpillar D4, six charrues à disques J. Deere ou Mac Cormik, trois pulvérisateurs à disques.
Les surfaces à labourer préalablement délimitées sous forme d'immenses quadrilatères réguliers et arpentés laissaient de côté des lambeaux de terre (sablonneux, boisés, latéritiques) impropres au passage des tracteurs ou à la culture.
Commencés au lever du jour, les labours se poursuivaient jusqu'à la tombée de la nuit avec une halte à midi pour la relève des équipages, le plein des réservoirs, le graissage, la visite des moteurs. Les tracteurs travaillèrent ainsi jusqu'à quatorze heures par jour.
Le rendement journalier, faible au début, s'améliora rapidement par l'expérience acquise des chauffeurs, la mise en service de deux nouveaux tracteurs, l'allongement des jours (six tracteurs labourent en un jour 26 ha. 5).
Le programme s'accomplit normalement et le 16 juin, date à laquelle le matériel rentra à l'atelier de Siguiri, 2.554 ha. avaient été labourés et pulvérisés.
Les observations précises faites au cours de la campagne permirent d'obtenir des renseignements intéressants sur le rendement des tracteurs et leur consommation.
La durée moyenne pour le façonnage d'un hectare s'établit à deux heures trente-quatre. Une heure quarante-deux minutes pour le labour, cinquante-deux minutes pour le pulvérisage.
De la consommation qui fut de
pour le démarrage des moteurs il ressort que la consommation moyenne par hectare façonné représentait 15,7 litres, pour une consommation horaire de 7,6 litres de gas oil, sensiblement la même pour les Carterpillar et les Clétrac H.D. de puissance équivalente.
Le nombre moyen d'heures de marche pour chacun de ces tracteurs s'établissait à 970 pour les premiers et 750 pour les seconds.
La population intéressée par les travaux représente environ 10.000 habitants (9.388), possédant, d'après les recensements, 150 paires de boeufs de labour avec lesquels ils auraient pu labourer, tout au plus 1 millier d'hectares de terres à riz en abandonnant tout labour pour cultures secondaires, arachides, fonio, riz de montagne.
L'action de la section Pilote a donc permis un accroissement de 1.500 hectares de surface préparés au bénéfice des villages des cantons de Djouma et Nouga, sans compter que les boeufs libérés des travaux dans les plaines ont été employés dans les bas-fonds environnants et loués aux villages voisins favorisés.
En prenant le rendement minimum des mauvaises années, soit 800. kg./ha. paddy, l'excédent de récolte pour la seule extension des surfaces mises en état de culture sera d'environ 200 tonnes qui, au prix de 10 fr. le kilo, représente tout de même la somme de 12 millions de francs.
Si la formule adoptée cette année a permis d'obtenir des résultats techniques très satisfaisants, elle semble ne pas convenir exactement à la mentalité et aux habitudes des populations rurales de la vallée du Niger.
Cette tentative de réunir en commun, pour les travaux, les terres de tout le village sans tenir compte des résistances individuelles et des désirs de chacun a abouti à de sérieuses difficultés.
Il semble qu'une action plus lente et soutenue, tenant compte des coutumes, de la structure agraire, et s'adressant exclusivement aux bonnes volontés, amènerait progressivement les cultivateurs, actuellement très individualistes, à accepter le principe d'une coopération à tous les stades, depuis la préparation des terres à la récolte, à l'usinage, à la vente.
Dans ce but, deux secteurs seraient à envisager
Le premier serait constitué par les cultivateurs désireux de poursuivre la culture coutumière sur les terrains dont ils dis, posent, comme propriétaires, usufruitiers ou locataires, et se limiterait à l'octroi de facilités pour lesquels notre action pour l'achat de boeufs, de matériel aratoire, la distribution de semences améliorées, etc...
Le deuxième grouperait tous les cultivateurs, chefs de famille, notables, etc., désireux de grouper les terres qu'ils ne peuvent cultiver entièrement, faute de moyens suffisants, pour les mettre en culture à l'aide de tracteurs.
Des contrats de culture collectifs ou individuels, suivant le cas, seraient passés avec le service de l'Agriculture pour le simple façonnage des terres au début, pour s'étendre peu à peu à la récolte, au traitement du paddy, et cela d'autant plus rapidement que les avantages pécuniaires obtenus seraient plus visibles.
Ainsi pourraient prendre naissance un ensemble de coopératives de production, de transformation et de vente, qui se substituerait peu à peu à la section Pilote.
D'un côté, culture familiale, base indispensable de toute société rurale; de l'autre, culture collective complémentaire, source de richesses supplémentaires.
Dans le but de faire bénéficier de ces avantages un plus grand nombre de cultivateurs et faire ressortir tout l'intérêt de nos méthodes culturales modernes l'action de la section Pilote doit s'étendre pour la prochaine campagne sur les cercles de Kankan, Kouroussa et des groupes de tracteurs façonneront après contrat de culture les terres des cultivateurs désireux de s'associer à notre oeuvre.
La Banane 5
La reprise de la production bananière, déjà amorcée courant 1947, s'est affirmée depuis 1948. Des arrivages d'engrais de plus en plus importants ont permis aux planteurs de redonner, à peu de choses près, à leurs plantations leur potentiel de production d'avant guerre. Les exportations passent de 26.000 tonnes en 1947 à 32.515 tonnes en 1948 et 39.000 en 1949.
Parallèlement à cette augmentation de la production, la reprise du trafic bananier , déjà noté en 1947 s'est encore accéléré en 1948. Deux bananiers entièrement neufs, le Djoliba et le Dubréka, sont entrés en ligne, pouvant transporter à eux deux 2.500 tonnes par mois de bananes.
Cependant, tout n'a pas été parfait et l'administration a dû intervenir, tant dans le domaine de la production que dans le domaine de l'exportation.
Dans le domaine de la production, il s'agissait de discipliner la culture fruitière dans son ensemble. Deux mesures prises à cet égard au courant de l'année 1948 revêtent une importance capitale. Une règlementation de la production fruitière très étudiée a été mise sur pied. Cet effort de règlementation a été conjugué avec l'organisation de coopérative des planteurs africains pour les aider à améliorer les qualités de leurs fruits.
Création des Coopératives africaines.
Le développement des plantations africaines ne cesse de s'accentuer. La production de ces plantations représente maintenant 15 % environ de la production totale de la Guinée, alors qu'avant guerre ils assuraient 3,7 % seulement des exportations.
Ces plantations ne sont pas menées d'une manière rationnelle. Les engrais, le paillage, un emballage soigné sont trop souvent inconnus du planteur indigène. L'irrigation fait le plus souvent défaut.
Ces méthodes d'exploitation irrationnelle présentent un très grave défaut. La production, au lieu d'être « étalée » sur toute l'année, marque une « pointe » très avancée vers décembre, janvier, février, date à laquelle les cours en France s'effondrent sous l'affluence des bananes, conjuguée au froid qui empêche leur conservation.
Les planteurs européens se plaignent à juste titre de ces plantations africaines qui les obligent à laisser des fruits à quai pendant les périodes de pointe et ne peuvent les aider à combler les creux pendant les baisses de production.
Le fait cependant qu'il existe quelques excellents planteurs africains, cultivant leurs plantations d'une manière intensive à l'européenne, permettait de penser qu'une amélioration de la production africaine était réalisable.
Les coopératives furent justement créées pour donner aux planteurs africains les moyens dont ils manquent, leur apprendre les procédés rationnels de culture, et les discipliner dans leur travail. Grâce aux coopératives, il était permis d'espérer que les meilleurs éduqueraient les plus mauvais, en même temps que la coordination des efforts pallierait en partie le manque de capitaux dont la plupart souffrent.
Par suite elles se groupèrent en une union ayant son siège social à Conakry.
Un prêt de 10.000.000 de francs fut accordé par la Caisse Centrale de Crédit Agricole, la colonie ayant donné son aval en garantie. Grâce à ce prêt, les planteurs africains pourront par l'intermédiaire de leurs coopératives, des engrais qui devront amener une amélioration sensible de leur production et l'« étaler » dans le temps, au cours de l'année 1950.
Par ailleurs, l'Union des Coopératives s'intéressant également au conditionnement des produits de ses adhérents a édifié dans la zone industrielle un hangar d'emballage où tous les fruits provenant des coopératives adhérentes doivent subir un préconditionnement. Les emballages défectueux y seront refaits.
Enfin, les planteurs africains se sont attachés à diminuer leur prix de revient par l'élimination des intermédiaires. L'Union des Coopératives exporte directement les fruits de ses adhérents à la Société Générale des Coopératives de Consommation Française.
Le Service du Conditionnement reconnaît l'effort accompli par les coopératives africaines. L'amélioration dans la qualité des fruits est appréciable, et la pointe de production saisonnière, encore sensible, semble néanmoins devoir s'atténuer.
Réglementation de la production bananière
La production fruitière en Guinée Française a été réglement
Une telle réglementation favorise le véritable planteur au détriment du « dioula 6 de culture » . Elle lui donne, dès ses débuts, le moyen de s'intégrer dans la communauté, sans porter atteinte à la qualité moyenne de la production générale et sans aboutir à une « poussière de marques » compliquant le régime des exportations.
Grâce à la coopérative, le petit exploitant pourra en effet disposer de moyens techniques qui se révèlent indispensables pour la réussite en matière de culture fruitière intensive : engrais, emballages, moyens de transport, etc...
Dans le domaine de l'exportation, une refonte complète de la réglementation a été également réalisée.
La précédente réglementation était fondée sur des quotas rigides d'exportation attribués à chaque planteur et difficilement réalisables. Il fallait y substituer une procédure plus souple, d'un caractère permanent et qui tiendrait compte des possibilités de production des planteurs, au lieu de se référer aux anciens chiffres de production d'avant guerre qui ne correspondaient plus à la réalité.
Chaque planteur communique désormais chaque mois à la Chambre d'Agriculture ses prévisions de production à longue échéance en se basant sur les inflorescences recensées au fur et à mesure de leur apparition.
Le tonnage est ainsi évalué trois mois à l'avance.
Le calendrier des rotations maritimes peut dès lors être établi avec sécurité et les responsables de l'affrètement peuvent ainsi essayer d'obtenir à l'avance le fret nécessaire à l'évacuation totale des fruits exportables.
Si le fret disponible est insuffisant, chaque prévision individuelle subit une réduction proportionnelle.
Cette nouvelle réglementation de l'exportation présente de plus un avantage appréciable ; elle permettra d'éliminer de la production les « dioulas de bananes » .
On peut en effet distinguer deux sortes de production de bananes :
Or, la nouvelle réglementation impose que toutes les inflorescences soient marquées au monogramme du propriétaire ou de la coopérative. Ces marques devront être indélébiles. Elles devront être nettes et parfaitement cicatrisées au moment de l'exportat
Dès lors il n'est pas possible au planteur peu scrupuleux de faire passer sous sa marque et pour l'exportation des bananes achetées à bas prix à des planteurs non titulaires d'une marque d'exportation, faute pour eux de pratiquer une culture rationnelle.
En ce qui concerne le marché des bananes, l'année 1948 a été marquée par la chute des cours en fin d'année. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, les planteurs ont connu des cours tellement bas que certains préférèrent même ne pas exporter. D'où des creux dans les navires bananiers de fin d'année, la Fédération bananière n'ayant pas prévu cette incidence de la crise sur les exportations fruitières et ayant affrété un tonnage trop important.
Les cours descendirent jusqu'à 60 francs métro quai-wagon départ Marseille. Seuls les planteurs fortement organisés et peu éloignés des points d'embarquement purent supporter une telle baisse de prix. Pour la moyenne des planteurs, ce chiffre représente une perte à la vente de 10 francs C.F.A. par kilo environ.
Le prix de revient moyen de la banane C.A.F. Marseille est en effet de 80 francs métro au kilo.
Quel est l'avenir de la production bananière en Guinée ? Il dépendra essentiellement du marché mondial et des possibilités de la consommation française.
Il n'est pas sûr que la Métropole puisse continuer longtemps à protéger par lin système douanier adéquat les bananes de ses colonies. Il est possible demain que des contingences internationales nous obligent à ouvrir la porte aux importateurs étrangers : bananes des Canaries notamment.
La banane de Guinée pourra-t-elle soutenir la concurrence de la banane étrangère ? Si l'on prend les cours quai-wagon départ Marseille et quai-wagon départ Londres, il est certain que les premiers sont beaucoup plus élevés en moyenne. Les cours se sont stabilisés à Londres durant l'année autour de 30 francs C.F.A., ce qui représente le prix limite pour les planteurs de Guinée.
Néanmoins, il n'est pas interdit de penser que les producteurs guinéens, en s'organisant, pourraient parvenir à abaisser considérablement leur prix de revient. La nouvelle organisation de la production les obligeant en quelque sorte à se grouper en coopératives pourrait avoir une incidence heureuse à ce point de vue. L'idéal serait évidemment que la Fédération bananière devienne son propre commissionnaire, éliminant les intermédiaires.
Il semble, en outre, que les taux de fret pourraient être abaissés.
Enfin, il peut être intéressant de noter que le « prix mondial » fixé par l'organisme à Francfort pour les importations de bananes en Allemagne laisse encore une marge intéressante de bénéfice au planteur de Guinée.
Les planteurs de Guinée, dans ces conditions, sembleraient capables d'apporter la concurrence sur les marchés mondiaux.
Le marché français, en revanche, semble aujourd'hui saturé par la production bananière de l'Union Française. Cette production est en forte progression dans toutes nos colonies.
| Année | Tonnes |
| 1946 | 89.650 |
| 1947 | 83.373 |
| 1948 | 158.681 |
Pour 1949, on prévoit une production totale de 225.000 tonnes dont 60.000 tonnes pour la Guinée.
Or, le Syndicat National des Importateurs Français de bananes évalue la consommation métropolitaine à 210.000 tonnes également.
Malheureusement, les courbes de production mensuelle de tous les terr
Il en résulte que, bien que les chiffres de production et de consommation s'équilibrent dans l'année, ils ne le font pas mois par mois, et la production d'août à février excède de 26.000 tonnes la consommation.
La solution serait d'exporter sur l'étranger. Sur l'Angleterre on se heurtera aux bananes des Canaries. Mais l'Allemagne, l'Italie et la Scandinavie peuvent présenter un débouché intéressant qu'il convient d'étudier dès maintenant.
Dans ces conditions, l'augmentation de la production prévue par le plan de développement économique ne peut se concevoir que s'il y a un abaissement corrélatif du prix de revient, Cette situation déterminera le choix des méthodes à appliquer pour parvenir à ce but :
Extension des surfaces. — La zone bananière en Guinée affecte la forme d'un triangle Boffa-Benty-Mamou. L'ensemble suit de près le rail et les routes qui suivent ce dernier ou y aboutissent.
Le problème bananier, en effet, en dehors des conditions climatiques, est dominé par le problème de l'évacuation des fruits. Améliorer les conditions et les possibilités du transport, c'est peut-être ouvrir des régions dont nous ignorons encore les possibilités.
Moyenne-Guinée, Basse-Guinée ? La discussion n'est pas prête d'être close. Le plus solide argument, à l'encontre de la Moyenne-Guinée, est l'éloignement. Le froid et la sécheresse, en effet, peuvent être combattus, ou atténués. Le péril acridien ne se fait sentir qu'avec une périodicité assez large (pas d'invasion depuis 1938).
En revanche, le fruit est de meilleure qualité qu'en Basse-Côte ; il est plus résistant au transfert. Le charançon noir n'y a pas encore fait son apparition. Enfin, le climat est plus sain pour le colon comme pour la plante.
En Basse-Guinée, la solution du problème de l'eau est plus facile, surtout l'évacuation des fruits se fait beaucoup mieux. Par contre, en bas-fonds, des travaux de drainage plus importants sont nécessaires, par crainte des inondations pendant la saison des pluies. Les terres sont lessivées et les apports en engrais plus importants sont nécessaires. Enfin depuis 1938, les plantations sont envahies par le charançon noir.
Où choisir la zone d'extension future ? Il semble que la zone Boké-Boffa, indemne du charançon noir, présente un moyen terme heureux. Elle offre, surtout dans le cercle de Boké, les caractères de salubrité de la Moyenne-Guinée. L'évacuation pourrait aisément se faire par l'escale de Victoria.
De toute manière, l'extension de surfaces ne peut être envisagée qu'après avoir amélioré d'abord le rendement à l'hectare.
Amélioration des rendements. — Il semble bien que par ce seul moyen les plantations de Guinée pourront répondre à l'augmentation de production demandée par le plan dans sa première phase.
La Guinée dispose de 3.300 ha. de bananiers de Chine (recensement de fin 1947). En arrondissant ce nombre à 3.000 (plantations mal venues, plantations africaines difficiles à contrôler), cette surface représente un potentiel de production insuffisamment exploité.
La production, en effet, peut être estimée à 60.000 tonnes dont 40 à 50.000 exportables, soit un rendement moyen exportable à l'hectare de l'ordre de 13 à 16 tonnes. Le rendement en 1938 était de 20 tonnes (2.500 ha. = 50.000 tonnes) et même supérieur, 22 à 25 tonnes, car sur les 2.500 ha. de cette époque, 2.000 seulement étaient correctement exploités.
L'accroissement du rendement hectare présenterait de nombreux avantages :
L'effort du planteur pour améliorer le rendement devra être complet. il s'accompagnera de la réalisation d'un plan d'équipement public spécial au trafic bananier; les premières réalisations sont commencées.
Il s'agit tout d'abord d'améliorer les moyens d'évacuation routiers et fluviaux. La construction d'une route définitive asphaltée de Conakry à Mamou est en projet. Les premiers travaux sont prévus pour le début de l'année 1949. De son côté, le C.F.C.N. envisage l'achat de wagons frigorifiques qui assureraient le transfert des bananes dans des conditions de conservation inconnues à l'heure actuelle.
Parallèlement, l'équipement du port est prévu par des rampes de chargement et un hangar de stockage. Un second quai bananier pourvu d'un outillage de manutention mécanique sera construit d'ici deux ans.
Les moyens d'information des planteurs doivent être améliorés. Le problème est fort important. La banane, en effet, est un produit essentiellement périssable. Les nombreux changements d'horaires bananiers, les répartitions de fret doivent donc parvenir rapidement aux planteurs sous peine de voir se perdre des quantités considérables de fruits.
Dans ce but, un effort est tenté pour accélérer les liaisons téléphoniques et télégraphiques. par ailleurs, un poste de radio « Radio-Guinée » fonctionne à Conakry et diffuse chaque jour toutes les informations susceptibles d'intéresser les planteurs : horaires bananiers, répartition du fret, etc. Cette innovation a été grandement appréciée.
Enfin, ces mesures sont accompagnées d'un conditionnement très sévère à la sortie. Il faut absolument proscrire la méthode qui consiste à livrer n'importe quoi sous prétexte que cela se vend. Sinon la réaction du consommateur, dès qu'il pourra choisir ses fournisseurs, risquerait d'être très brutale pour les planteurs de Guinée.
En 1946, la production de palmiste de l'ensemble des Colonies françaises était tombée à 72.000 tonnes. Le plan Mermet fixant comme but aux Territoires de l'Union Française le retour aux anciens chiffres de 1939, soit 183.000 tonnes, un gros effort fut fait en Guinée durant l'année 1948. C'était le premier des corps gras dont la France d'après guerre facilitait le développement de la production dans nos Territoires d'Outre-Mer.
Alors que la consommation moyenne des années 1936-37-38 était de 895,000 tonnes, dont 275.000 provenaient de l'Afrique française, en 1947 la France n'a pu disposer que de 450.000 tonnes sur lesquelles 130.000 seulement ont pu être fournies par les Territoires d'Outre-Mer.
Dans ces conditions, les oléagineux qualifiés autrefois de secondaires prennent une importance considérable.
Parmi eux, le palmier à huile mérite une particulière attention. Les dernières découvertes en matières industrielles viennent de démontrer que seule l'huile de palmiste permet la trempe de certains aciers spéciaux. Ce fait peut déterminer dans les années à venir une très forte demande mondiale de palmiste.
La Guinée est à cet égard particulièrement favorisée. Les palmeraies naturelles y sont très étendues, aussi bien dans tous les cercles de Basse-Côte jusqu'à Kindia, que dans l'ensemble de la région forestière,
Les tonnages achetés par le Commerce ont été en 1948 en très nette augmentation par rapport à ceux de 1947. Il n'est pour s'en rendre compte que de comparer les tonnages respectifs de palmistes produits dans chaque cercle au cours des années 1947 et 1948.
|
|
Traite de 1947 | Traite de 1948 |
|
|
||
| Dubréka | 1.200 | 1.356 |
| Boké | 2.163 | 2.317 |
| Boffa | 1.889 | 2.119 |
| Forécariah | 898 | 1.155 |
| Kindia | 250 | 400 |
| Beyla | 16 | 18 |
| Kissidougou | 1.544 | 1.723 |
| Guéckédou | 632 | 854 |
| N'Zérékoré | 2.214 | 5.713 |
| Macenta | 1.672 | 2.920 |
Encore convient-il de noter que les palmistes achetés pendant le mois de janvier 1948 se trouvent compris dans la traite 1947, la traite 1947 n'ayant été déclarée fermée et la traite 1948 ouverte qu'au 2 février 1948, date de la dévaluation du franc C.F.A.
Pour 1949, il avait été escompté que la traite dépasserait 25.000 tonnes. Mais l'engorgement temporaire des stocks d'oléagineux de la Métropole dû à la fois à un excès d'impor tation sur le Plan Marshall et à une sous-consommation inattendue ont brusquement stoppé les achats. Il semble cependant que ceux-ci doivent reprendre bientôt après résorption des importations Marshall et réajustement des prix sur des bases plus saines.
De toute manière, la production guinéenne est en nette augmentation depuis trois ans.
Ce phénomène peut être attribué à deux causes : à la hausse des prix tout d'abord : c'est ainsi que le palmiste qui se payait au producteur de 4 à 7 fr. le kilo, selon les région au cours des années 1946 et 1947, s'est payé de 8 à 12 fr. après la dévaluation. Il est ainsi devenu un des produits les plus rémunérateurs pour le paysan africain.
Un autre facteur a joué également mais plus localisé. Il est facile pourtant de prévoir qu'il ne fera que prendre de l'importance dans les années qui viennent : il s'agit de l'ouverture de la route de Monrovia.
A la lecture du résultat des traites 1947 et 1948, on est en effet frappé par l'augmentation considérable de la production dans les cercles de Macenta' et surtout de N'Zérékoré.
Le cercle de N'Zérékoré était autrefois le plus déshérité de tous les cercles du point de vue de la traite des produits. A 423 km. de Kankan, les frais de transport étaient si élevés que le producteur ne touchait pas seulement le quart du prix F.O.B. de ses produits.
L'ouverture de la route de Monrovia, en abaissant considérablement les frais de transport, a donc permis de relever d'autant les prix payés au producteur. Les prix passèrent de 7 à 9 fr., à 11 et 12 fr., soit une plus-value de 4 francs.
Le jour où son évacuation par le Libéria atteindra son plein rendement, c'est un tonnage de plus de 10.000 tonnes qui pourra être exporté du seul cercle de N'Zérékoré.
A l'heure actuelle, c'est donc essentiellement une question de prix qui détermine l'augmentation du palmiste. Le palmiste n'est encore, en effet, qu'un produit de cueillette.
Produit de cueillette, le seul travail rentable qu'il demande au producteur est le concassage des noix. Ce concassage se fait actuellement à la main. Les rendements obtenus sont évidemment dérisoires.
L'effort à entreprendre doit donc porter essentiellement sur deux points :
Le traitement mécanique des palmistes
Le traitement mécanique des palmistes n'est encore que très peu répandu en Guinée. Le producteur tirera de sa vulgarisation des avantages certains.
Un ouvrier ou une ouvrière habile traite en effet à la main 4 à 5 kg. d'amandes par jour, alors qu'un moto-concasseur débite par heure 800 kg. de noix de palme susceptible de donner 100 à 250 kg. d'amandes.
Les S.I.P. ont déjà accompli un gros effort dans ce sens. Des moto-concasseurs ont été installés dans la plupart des cercles producteurs de palmiste . C'est ainsi que des moto-concasseurs sont aujourd'hui en service dans les cercles suivants :
24 autres moto-concasseurs sont actuellement en commande.
Cet effort doit être poursuivi. La modicité des ressources des S.I.P. constitue toutefois un obstacle majeur. Aussi n'a-t-il pas paru souhaitable de faire couvrir ces dépenses par le produit des cotisations ordinaires, mais plutôt par les producteurs de palmistes bénéficiaires de ces mesures d'amélioration.
A cette fin, après accord avec la Chambre de Commerce, qui a parfaitement compris l'importance de cette question, un véritable système d'investissements collectifs a été imaginé.
Dans tous les cercles producteurs de palmiste où le motoconcassage est assuré par les S.I.P., les frais de concassage mécanique qui incombent au producteur et doivent être remboursés aux S.I.P. ainsi chargées de la réaliser ne sont pas perçus directement par celles-ci au moment de l'opération elle-même, mais réglés par les commerçants, sur une base forfaitaire fixée par le Conseil d'Administration des S.I.P. et qui est en général de 0 fr. 50 par kilo de palmiste.
L'enrichissement des palmeraies naturelles
A ces avantages immédiats s'ajoutent les avantages plus lointains. Avec les fonds ainsi récupérés, des améliorations pourront être entreprises dans les palmeraies, travaux d'entretien et de régénération des palmeraies existantes, création de nouvelles palmeraies en espèces sélectionnées, etc.
Un gros effort a donc été entrepris, particulièrement dans le cercle de Boké, pour aménager ces palmeraies en les sauvegardant tout d'abord, en améliorant leur productivité, ensuite.
Bien que pour améliorer les peuplements la seule méthode rationnelle soit la plantation systématique de variétés à grands rendements, cet effort a dû être réservé pour l'avenir, faute de moyens suffisants.
Pour le présent, le travail entrepris consiste à dépister les îlots de valeur et à les classer pour les sauvegarder de la destruction. Il n'est pas possible, en effet, de classer toute les palmeraies tant que le développement de la culture du riz de marais n'aura pas été plus poussé et ne permettra pas de nourrir toute la population.
Ces îlots de valeur sont en même temps aménagés par éclaircies systématiques et dégagement de taillis qui les encombrent, de manière à obtenir une densité de peuplement de l'ordre de 150 palmiers à l'hectare. Ce travail est conduit par blocs de 100 à 150 ha. A l'intérieur de ceux-ci, des lots de 1 à 2 ha. sont ensuite entièrement rasés pour être plantés en pépinière avec des palmiers sélectionnés commandés à la station d'essai de palmier à huile de la Côte d'Ivoire.
L'avenir du palmiste en Guinée
A l'heure actuelle, le palmiste n'est pas autre chose qu'un produit de cueillette. La conséquence de cet état de choses c'est que les paysans ne livreront du palmiste au commerce qu'autant que les cours seront suffisamment élevés. Les prix F.O.B. fixés par le Département sont nettement supérieurs aux cours mondiaux, de 15 à 20 % pour la côte et de 35 à 40 % pour la forêt. S'ils viennent à s'aligner sur les cours mondiaux, quelle sera la conséquence pour la production guinéenne ?
En Basse-Côte, il est probable que la production devrait rester sensiblement la même. En forêt, le problème sera tout différent. N'Zérékoré supportera sans aucun doute cette baisse grâce, à l'évacuation vers Monrovia. Macenta s'orientera de plus en plus vers Monrovia également. Le problème est différent, pour, Kissidougou et Guéckédou où les prix au producteur devraient s'établir aux environs de 8 francs pour le premier, 7 francs pour le second. Dans ces conditions, il est à craindre que le producteur ne livre plus son palmiste au moins pour un certain temps. Il faudra alors envisager l'ouverture de la route de Freetown par Pendenbu, ou, en cas de refus de l'Office des Changes de délivrer des livres nécessaires, la construction de la route Faranah-Mamou, déjà commencée et qui devra être financée par le F.I.D.E.S.
Pour écarter définitivement de telles difficultés, la meilleure solution serait sans doute de transformer le caractère de la production du palmiste. D'un simple produit de cueillette, il faudrait en faire un véritable produit de plantation. C'est à quoi l'Administration s'emploie depuis un an avec insistance par l'amélioration des palmeraies naturelles et la vulgarisation du traitement mécanique des noix.
Parmi les cultures fruitières de la Guinée, il en est une dont l'importance paraît avoir été mésestimée pendant de longues années. C'est celle de l'ananas. Cette situation va d'ailleurs cesser ; mais il est particulièrement intéressant de noter que le développement qu'elle tend à prendre actuellement résulte de la création sur place d'une industrie de transformation.
Les lois qui règlent le développement de la culture fruitière sont maintenant très connues ; on sait en particulier que les cultures à fortes récoltes saisonnières ne peuvent subsister si elles ne trouvent dans l'usine le débouché assuré que ne peut lui offrir le marché de consommation en produit frais. C'est d'autant plus vrai que le consommateur est plus éloigné du lieu de production, que le produit est plus délicat, que le pourcentage de matières nutritives est plus faible par rapport au poids brut, enfin que les points de production coïncident avec un achalandage pléthorique en fruits frais de provenance locale.
Le marché de l'ananas est particulièrement sensible à ces lois. D'abord il porte sur un fruit délicat à transporter dont le prix unitaire est nécessairement élevé puisqu'il ne peut être débité aux clients qu'en petites quantités. Ensuite, la pointe de récolte de juin coïncide avec l'arrivée massive de fruits rouges sur les marchés européens et les températures élevées sur les lieux de consommation qui réduisent juste à ce moment les chances de bonne conservation au moment où il serait nécessaire de pouvoir étaler la période de vente.
La fabrication de conserves apparaît ainsi comme le seul moyen de s'adapter à ces conditions ; elle permet en effet de présenter un produit homogène et tout préparé, transporté aux moindres frais et surtout capable de se conserver indéfiniment, ce qui permet de régler l'écoulement de la marchandise non plus en fonction des pointes de production, mais bien d'après l'état du marché de consommation.
Le planteur d'ananas à donc partie liée avec l'industriel avec lequel il trouve un coéquipier nécessaire, sans lequel son intérêt est menacé.
Sa forme d'activité est ainsi très différente de celle du planteur de bananes qui compte exclusivement sur la commercialisation en fruits frais pour écouler sa production. Le planteur d'ananas pratique la culture industrielle pour approvisionner une usine. Le planteur de bananes est un exploitant agricole qui approvisionne un marche de consommateurs. Il est donc normal que cette culture industrielle obéisse à des règles particulières et que ces deux espèces d'exploitation que nous venons d'évoquer évoluent chacune dans leur domaine propre.
Celui du planteur d'ananas se définit par les conditions mêmes que doit remplir sa production. De même que l'industriel se doit de présenter un produit fini, de qualité et de présentation constantes, de même qu'il doit, dans l'état actuel de la production mondiale, transformer de grandes quantités pour amortir un matériel coûteux et à grand débit, qu'il doit le faire travailler toute l'année au maximum de rendement et en sortir un produit impeccable et à bon marché ; de même le planteur d'ananas, que l'on peut qualifier de planteur industriel, se doit d'accroître ses rendements et d'abaisser ses prix de revient, de fournir un fruit impeccable et constant, d'augmenter sa production, de l'étaler autant que possible sur l'année.
Les rapports entre eux découlent d'eux-mêmes de cette situation. Le planteur d'ananas demande à l'industriel d'absorber régulièrement sa production en le délivrant de la servitude que faisait peser jusqu'à maintenant sur cette culture les conditions de vente sur le marché des fruits frais. L'industriel, de son côté, demande au planteur de lui assurer le fonctionnement continu et à bon compte de son usine. Son intervention ne doit d'ailleurs pas priver ce dernier des profits plus intéressants qu'il peut couver à l'exportation en frais de la plus grande partie possible de sa production. Mais une fois cette opération menée à bien, les fruits restants peuvent être livrés à l'usine à un prix relativement plus bas au lieu d'être purement et simplement perdus comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Le planteur devient ainsi un homme auquel la sécurité de l'écoulement de sa production ouvre des horizons différents et plus stables.
C'est sur ces bases que va bientôt fonctionner en Guinée la première usine d'Afrique équipée sur un pied qui permette de lutter sur les marchés mondiaux à égalité avec les producteurs du nouveau monde.
Elle possédera ses services généraux autonomes, centrale électrique, alimentation en eau. Son emplacement a été choisi près de Conakry au point de convergence des fruits provenant de différentes régions. Une autre entreprise vient de monter également dans la même région une usine pilote utilisant un autre procédé : la déshydratation des jus. Quoiqu'elle n'en soit pas encore au stade industriel, les plus grands espoirs sont également permis de ce côté.
Ainsi pourront bientôt être mis en oeuvre, grâce à cette organisation rationnelle de tout le cycle de production, nos possibilités de culture d'ananas, possibilités qui sont considérables en Guinée. Elles ont l'avantage d'intéresser un certain nombre de planteurs moyens. En plus des quelques plantations spécialisées qui ont réservé à ce fruit des surfaces de 50 ha., la culture peut en être entreprise sur la plupart des exploitations bananières qui disposent toujours à côté de leurs bas-fonds réservés à la banane, des surfaces de 10 à 30 ha., ou même plus, plantables en ananas.
Il y a donc pour l'agriculture fruitière de la Guinée, grâce à cette culture, une possibilité magnifique de réaliser un profitable équilibre entre les marchés d'exportation susceptibles de toutes les variations en bien comme en mal et un marché intérieur stable qui amortira les effets du premier.
Possibilités de la culture du thé en Guinée
La Guinée ignore jusqu'à présent une culture qui peut représenter un élément de richesse appréciable : la culture du thé.
Le thé n'a été cultivé jusqu'ici que dans peu de territoires : la Chine, l'Indochine et Formose, les Indes Néerlandaises, Ceylan et les Indes Anglaises auxquels sont venus, dans les quelques années qui précèdent la guerre, s'adjoindre les Açores, le Kenya et le Tanganyika britanniques et les plantations que l'U.R.S.S. a faites dans l'Oural et le Caucase pour subvenir au moins partiellement, à ses besoins intérieurs.
L'ensemble de ces plantations suffisait en 1939 à assurer la demande de la consommation mondiale et les cours du produit sur les grands marchés internationaux demeurèrent stables.
La guerre et le brassement des populations qui en a été la conséquence a amené toute une partie de l'humanité à connaître, apprécier et consommer ce produit alors que sa production baissait dans de grandes proportions, du fait des hostilités.
A l'heure présente, la guerre qui sévit toujours en Chine, en Indochine, aux Indes Néerlandaises réduit considérablement la production dans ces pays qui représentait, avec une exportation de 148.118 tonnes en 1939 un peu plus de 40 % de l'exportation mondiale totale de 1936 : 383.395 tonnes.
En même temps que cette diminution des exportations, la demande de la consommation ne cesse de croître, de sorte que nous marchons vers un déséquilibre complet de l'offre et de la demande dans les années qui viennent
En ce qui concerne lés territoires français, la situation était la suivante en 1939 .
| Consommation métropolitaine | 1.400 tonnes |
| Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) | 12.500 tonnes |
| Autres pays de l'Union Française | 3.000 tonnes |
|
Total
|
17.000 tonnes |
En face de quoi, l'Indochine, seul territoire producteur, exportait environ 1.500 tonnes. La différence, soit environ 15 à 16.000 tonnes, devait être achetée à l'étranger et réglée en devises.
Cette situation tolérable avant la guerre ne l'est plus désormais, les devises étant si rares et si parcimonieusement distribuées par les Pouvoirs Publics.
Une seule solution demeure : produire dans des pays nouveaux.
La culture du thé est-elle possible en Guinée ? C'est ce que nous allons examiner.
La Guinée possède dans la région forestière, cercle de Macenta en particulier, une zone montagneuse propice à la culture du théier.
En effet, en dehors des conditions d'altitude requises, 800 à 1.400 mètres, on y rencontre une écologie favorable par sa pluviométrie d'une hauteur d'eau de 2 mètres répartis sur 8 à 9 mois de l'année.
Les sols rouges basiques d'origine dolétirique, très favorables au quinquina et au caféier conviendraient aussi par leurs qualités physiques et chimiques à la culture du théier. Mais leur situation en altitude, sur les pentes abritées des montagnes nécessitera des travaux d'aménagement (déforestation, terrassement) très importants.
Le comportement des théiers du Verger de la Station de Quinquina de Sérédou, issus de graines récoltées sur les théiers du Jardin A. Chevalier de Dalaba, prouve que les théiers trouvent sur la chaîne du Ziama l'écologie voulue.
De récents essais de préparation des feuilles ont abouti à la fabrication d'un thé de bonne qualité gustative.
Devant ces conditions favorables, reste le problème le plus, difficile à résoudre, celui de la main-d'oeuvre. En dehors des, travaux normaux de culture (semis, plantation, soins cultureux) la taille et la cueillette des feuilles demandent une main-d'oeuvre nombreuse et de qualité. La faible démographie de la région, comme la médiocre qualité de la rare main-d'oeuvre disponible, constituent ici une difficulté insurmontable.
L'importation de main-d'oeuvre asiatique, avec tous les aléas qu'elle comporte peut seul permettre, pour le début tout au moins, d'entreprendre cette culture avec chance de succès.
Par la suite, pourra-t-on, par une formation lente et progressive de la main-d'oeuvre locale, satisfaire les besoins ?
Il paraît difficile de répondre — quoiqu'il en soit l'introduction de la culture du théier en Guinée, ne doit pas pour cela être écartée, mais tout au contraire, envisagée et entreprise en tenant le plus grand compte des facteurs défavorables afin d'écarter, par un trop grand optimisme, toutes causes d'insuccès.
La station agricole de Sérédou fut créée par arrêté du Gouverneur de la Guinée Française, du 5 septembre 1939, sous la dénomination de « Station d'Expérimentation du Quinquina et du Caféier » . Le but était de procéder aux études et recherches sur l'acclimation du Quinquina, ainsi que sur la
sélection, l'amélioration et la multiplication des variétés de caféiers à la Région Forestière de Guinée. La création de la Station sanctionnait un état de fait puisque depuis 1933 des semis de cinchena avaient été effectués à Macenta et les plants mis en place sur des emplacements favorables de la chaîne du Ziama, près du col de Vorhoa.
La station était rattachée directement au Service de l'Agriculture de Guinée. Les terrains étaient répartis en 2 parcelles d'une contenance totale d'environ 88 ha.
En 1944, un arrêté général du 5 octobre, groupait les Stations de Sérédou et de Man (Côte d'Ivoire) sous la dénomination « Stations Expérimentales du Quinquina » et les plaçait sur le plan Fédéral. Le premier programme de campagne prévoyait la plantation en 5 ans d'une superficie de 346 ha. de quinquina répartis comme suit :
| C. Ledgériana | C. Succirubra | |
| Année |
|
|
| 1941 | 1 | 12 |
| 1945 | 23 | 16 |
| 1946 | 45 | 20 |
| 1947 | 90 | 14 |
| 1948 | 95 | 30 |
| Total | 254 | 92 |
Le but, produire des écorces de ledgériana, afin de satisfaire les besoins en sulfate de quinine de la Fédération et des écorces de succirubra dont les alcaloïdes totaux pouvaient intéresser la pharmacopée autant que les fabricants de liqueurs toniques.
La plus grande Partie des semences nécessaires furent demandées à la Station du Quinquina (Cameroun) qui possédait déjà des clones sélectionnées à haute teneur en quinine. De plus, les premiers arbres, issus des semis de 1933 et ultérieurs, fournissaient aussi des graines pour alimenter les germoirs. Parmi ces populations, des sujets d'élite pouvant rivaliser avec n'importe quel clone mondial furent repérés après étude de leur comportement et analyse de leurs écorces — l'effort de multiplication porta principalement sur ces derniers, ainsi que sur des hybrides de valeur issus de semences reçues d'Indochine.
La station du Quinquina de Sérédou possédait, de ce fait, un matériel végétal de valeur.
En 1945, les travaux prévus au plan étaient non seulement réalisés, mais encore dépassés. Cinquante-quatre ha. avaient pu être plantés pour les deux stations, soit une avance de 14 ha., malgré des conditions difficiles de travail résultant d'un manque d'outillage, de matériaux et de moyens de transport.
Outre la Station initiale, dénommée « Station-Plaine » , située près du village de Sérédou, les plantations se répartissent actuellement entre 5 postes situés à flanc de montagne. Les postes I, II, III, témoins historiques de la période d'essais, le poste IV d'une altitude moyenne de 900 m. qui reçoit les plants de succirubra et d'hybrides. Le poste V, réservé au programme de plantation de ledgériana (altitude 1,000 à 1.100 m.) et de production d'écorces.
En 1947-48 des difficultés de main-d'oeuvre contrarièrent grandement la réalisation des programmes tracés.
L'affectation de la deuxième portion du contingent, en avril 1948, permit de surmonter, en partie, ces difficultés et de construire les 16 km. de route de montagne reliant la Station-Plaine au poste V à une altitude supérieure de 500 m.
L'application de mesures appropriées doit normalement pallier peu à peu la pénurie de main-d'oeuvre due aux prix élevés des produits de cueillette-palmiste, en même temps qu'un outillage plus perfectionné permettra d'en réduire l'importance.
Outre le quinquina, la Station de Sérédou a introduit diverses autres plantes de grand intérêt.
Des théiers, issus de semis de graines provenant des sujets du Jardin Chevalier (Dalaba), servirent à constituer un verger dont la belle venue et les qualités gustatives des feuilles permettent d'envisager avec succès la culture du théier en Région Forestière.
De même, des clones d'élite de « derris ellîptica » sont suivis de très près à la Station. Des analyses font ressortir la haute teneur en rotémone des racines.
En plus, certaines plantes antilépreuses « taraktogenos » , « hydnocarpus » , « oncoba » sont suivies et multipliées. Leur comportement laisse entrevoir de grandes possibilités de culture.
La Station de Sérédou a bénéficié pour son démarrage des expériences des Stations du Cameroun, d'Indochine et du Congo Belge, Elle a pu, grâce à l'emploi de graines sélectionnées par ces établissements, isoler rapidement des clones très intéressants et les multiplier rapidement par la pratique du greffage et du bouturage, grâce aux hormones végétales.
Les résultats obtenus sont encourageants.
La période d'expérimentation terminée, la phase de plantation est largement amorcée. Grâce à l'aide du « Fides » , les travaux seront activement poussés et on peut, dès maintenant, entrevoir la mise en exploitation des premières plantations et le traitement des écorces.
L'action de la Station du Quinquina de Sérédou, dont le but principal est de subvenir aux besoins en quinquina de la Fédération aura aussi une incidence très grande sur toutes les autres productions d'un intérêt économique élevé tant par leur importance (caféier, cacaoyer), que par leur valeur médicinale (théier, chaulimogras) ou parasiticide.
De par sa situation, elle répond pour le mieux aux buts poursuivis qu'elle doit normalement atteindre avec succès.
Les territoires du Dahomey et de la Guinée se sont désignés d'eux-mêmes à l'attention des spécialistes. La Haute-Guinée et la région forestière font déjà l'objet d'introductions et de cultures suivies. Ceci n'est pas uniquement le fait du hasard, des essais avaient été faits dans nos stations, en particulier à Camayenne (Conakry) et à Kankan, en outre, dans les régions de Kankan et de Kouroussa, des résultats prometteurs avaient été acquis avant guerre par des particuliers (qui abandonnèrent pour des raisons financières et de technique de préparation surtout).
La Région Forestière possède un centre privé de production et de transformation à N'Zérékoré.
Le terrain était déjà préparé par conséquent et il faut s'en féliciter.
La Haute-Guinée et la Région Forestière présentent l'avantage d'être à cheval sur la zone des tabacs blonds et des tabacs bruns, délimitée en gros par le 10° parallèle Nord.
L'altitude du pays Konianké, en outre, présente l'intérêt de retarder la dégénérescence et de conserver au tabac de bonnes qualités dégustatives pendant plusieurs générations.
D'autre part, la saison des pluies y est propice au repiquage tardif en culture semi-dérobée sur les riches terrains des abords des villages pour récolte au début de la saison sèche, ce qui permet un séchage rapide, condition indispensable à l'obtention de tabacs jaunes honorables, tout en facilitant la détente grâce à la fraîcheur des nuits. Ces avantages sont appréciables en des lieux, où, pour l'instant, on ne peut faire d'installation de séchage artificiel.
Quant à la Région Forestière proprement dite, elle offre un choix très satisfaisant des situations se prêtant bien à là culture des tabacs bruns.
Les variétés Burley (tabac jaune) et Kentucky (tabac brun) sont parfaitement acclimatées.
L'évolution de la culture du tabac à laquelle nous assistons est normale et souhaitable. Ici comme ailleurs, il faut en finir avec le « bricolage » et la traite à la sauvette.
Aussi bien la réglementation de la production des tabacs de l'espèce Tabacum, exige-t-elle, là où elle existe, l'obtention préalable d'une licence pour pouvoir participer aux achats. Pour obtenir cette licence, les requérants doivent justifier qu'ils possèdent les moyens voulus pour assurer la formation technique des planteurs, la distribution de semences sou de plants de choix et la transformation de la récolte.
Depuis plusieurs années, le Directeur de la Compagnie Africaine des Plantes à parfums, M. Canousse, poursuit à Labé l'acclimatation des mûriers. Il s'agit là d'une initiative extrêmement intéressante dont l'objectif est finalement d'introduire l'élevage du ver à soie et l'industrie séricicole dans la région du Fouta qui, sur de nombreux points, rappelle notre région méditerranéenne.
Tout d'abord, la mentalité des habitants.
La population de Labé, de nature rustique et sédentaire, s'apparente par son caractère et sa mentalité aux petits propriétaires ruraux du Midi de la France : la récolte et le travail familial seuls les intéressent. La facilité avec laquelle la Compagnie des Plantes à parfums a installé cette industrie, nouvelle pour le pays et pour la population, de l'extraction de l'essence d'orange, il y a vingt ans, le prouve amplement. En effet, cette industrie devenue pour eux ce que la magnanerie l'était il y a cinquante ans en Provence, c'est-à-dire non pas l'industrie mère assurant le train de vie de la famille, mais l'industrie d'appoint qui, sans grand frais ni grande installation permet « à temps perdu » de gagner un peu de superflu.
Sa technique, c'est-à-dire essentiellement le travail de la cueillette, est parfaitement adaptée à la mentalité des habitants. Or, l'industrie séricicole correspond aux mêmes conditions de travail que l'industrie de l'essence d'orange ; elle peut trouver largement dans chaque famille une main-d'oeuvre qui sera nécessaire pour mener à bien un assez important élevage de ver à soie.
Enfin, les qualités d'intelligence des Foulahs qui sont, dans l'ensemble très développées et leur possibilité de réaliser des travaux relativement minutieux, les rendent particulièrement aptes à la réalisation d'une magnanerie familiale.
Le climat est également très favorable à la culture du mûrier. Les sujets qui ont déjà été plantés prospèrent d'une façon satisfaisante. Tous ont été tirés d'une souche provenant de la région méditerranéenne et importés il y a une dizaine d'années. Ces pieds étaient restés à l'abandon et sans soin. M. Canousse a eu l'idée, il y a deux ans environ, de tirer des boutures : l'expérience a été tout à fait satisfaisante. Dès maintenant, le verger compte une cinquantaine d'arbres de deux ans atteignant deux mètres de haut et trois centimètres de diamètre. De nombreuses boutures sont en pépinières (200 environ entre un an et un an et demi). Ces boutures seront distribuées aux chefs indigènes à titre gratuit par la compagnie des plantes à parfum. M. Canousse compte qu'ils pourront, par la suite, eux-mêmes suivant ses conseils, bouturer et distribuer à leur tour parmi la population des arbres à mettre en place comme il a déjà été fait pour les orangers. Disposant d'un personnel très ancien, la C.A.P.P. commence à en distribuer par ses agents, qui pour la plupart connaissent le bouturage et l'entretien des pépinières. Nul doute que ce premier départ ait une influence très grande sur le restant de la population.
Quoique ces essais soient effectués sur les plantations de la compagnie des plantes à parfums, ces remises de boutures et d'arbres seront faites à titre absolument gratuit. Il faut rendre hommage ici à la largeur d'esprit de cette compagnie et à son directeur qui poursuivent les essais avec le souci d'essayer d'améliorer, dans la mesure de leurs moyens et connaissances, le sort des autochtones vivant en collaboration avec eux depuis plus de vingt ans.
Il reste maintenant à implanter le ver à soie dont l'acclimatation est en cours de réalisation avec la station séricicole d'Alès.
L'administration compte suivre de près ces essais. L'industrie de la soie est en fait très grosse consommatrice de cette matière première dont nous ne fournissons qu'à peine un dixième et dont le restant est importé d'Italie et du japon. La question des débouchés ne risque donc pas de se poser si les produits sont de bonne qualité comme on est en droit de l'escompter.
L'élevage des bovins est une des principales ressources de la Guinée, particulièrement pour le Fouta Djallon où il constitue l'occupation essentielle de la population Foulah. Il est également développé en Haute-Guinée dans les régions de Kankan, Siguiri, Beyla, où il partage le premier rôle avec l'exploitation des placers et la culture du riz.
Au total, le troupeau compte actuellement un peu moins de 500.000 têtes. Il est en légère régression par rapport à l'avant-guerre, ce qui est dû à la fois aux prélèvements nécessités par les hostilités [de la deuxième guerre mondiale] et aux maladies infectieuses venues des territoires voisins à la suite d'un relâchement du contrôle sanitaire pendant la guerre [1939-1945].
Le grand problème actuel est d'éduquer les éleveurs et de outiller pour changer radicalement leurs méthodes qui sont restées partout extrêmement archaïques.
Le Guinéen est beaucoup plus un pasteur qu'un éleveur et il ignore même très souvent les notions les plus élémentaires en cette matière : les vaches sont couvertes à n'importe quelle époque de l'année, de sorte que les veaux naissent en pleine saison sèche, la traite est faite sans méthode, enfin et surtout l'élevage extensif sévit partout, entraînant la déprédation arbustive et la ruine du sol. En saison sèche, l'herbe se fait rare et maigre ; il n'y a pas de pâturages artificiels ; c'est pour les troupeaux la soif et les trajets épuisants de la transhumance à la recherche des pâturages d'été. Les résultats sont : une chair de qualité médiocre, un rendement faible en poids, peu de lait, alors que la race N'Dama, qui constitue le troupeau, est particulièrement robuste et bien constituée.
Dans ces conditions, il suffira d'appliquer des méthodes rationnelles à ce troupeau pour en accroître considérablement les qualités et l'importance numérique.
C'est la tâche qui est actuellement entreprise en Guinée par le Service de l'Elevage.
Il fallait tout d'abord que celui-ci s'équipe. Cette première phase des réalisations est en cours. Un centre vaccinogène complet s'élève dans chacun des principaux cercles d'élevage ainsi que deux fermes expérimentales dans le Fouta, destinées à mettre au point les méthodes pour améliorer la race et les conditions de vie des troupeaux.
Parallèlement, la lutte pour améliorer et développer le troupeau a été engagée dans tous les domaines où des résultats efficaces peuvent être attendus : lutte contre les maladies, amélioration de la race, amélioration des conditions de vie.
Les S.I.P. de la Guinée n'ont pas échappé, au cours de ces dernières années aux critiques répétées dont ces institutions sont l'objet dans toute l'A.O.F. Ces critiques sont bien connues : les Sociétés Indigènes de Prévoyance sont entièrement entre les mains du Commandant de Cercle et les indigènes, en fait, ne participent en rien à leur gestion. Elles ne servent qu'à satisfaire les besoins de l'Administration et ne sont d'aucune utilité sociale ou économique aux populations. Enfin, sous la forme d'une cotisation obligatoire, elles perçoivent un super-impôt qui sert surtout à payer hors budget certaines dépenses du cercle.
De l'ensemble de ces critiques, auxquelles certaines sociétés de prévoyance prêtaient particulièrement le flanc, il est résulté un mouvement d'opinion pour demander la suppression de ces institutions et leur remplacement par des coopératives.
La solution, de prime d'abord, paraît simple et séduisante ; les coopératives sont des institutions qui ont déjà fait leurs preuves, particulièrement dans la Métropole. Elles échappent largement à la tutelle administrative et s'administrent elles-mêmes selon la volonté de leurs membres. Enfin, l'adhésion est volontaire et non forcée, comme c'est le cas pour les S.I.P.
Il a donc semblé à beaucoup d'esprits que, dans ce grand mouvement de réforme de nos institutions coloniales, la disparition des S.I.P. et leur remplacement par les coopératives venaient très heureusement compléter, sur le plan local et dans le domaine économique, les mesures économiques et sociales qui ont fait de l'Africain un libre citoyen de l'Union Française.
Le problème, en fait, ne se présente pas sous un aspect simple. Les S.I.P. ont été créées pour un objet bien déterminé et dont l'utilité se fait de plus en plus sentir à mesure que l'économie du pays se développe : faire pour le compte des populations rurales des cercles tous les travaux d'équipement collectif et toutes les interventions économiques qui sont
nécessaires à la prospérité de tous, donner à cet effort collectif un caractère obligatoire en attendant que l'éducation des individus soit suffisamment avancée pour qu'on puisse instaurer un régime de libre adhésion de chacun, faire cependant participer la partie la plus éclairée de la population à la gestion de cet organe collectif sous la forme d'un Conseil
d'administration où l'on espère que l'autorité administrative, représentée par le Commandant de Cercle Président, jouera un rôle de plus en plus effacé.
L'institution des Sociétés de Prévoyance correspond donc à un stade intermédiaire de l'organisation des communautés rurales : celui où l'on est obligé d'employer l'autorité et la réglementation pour imposer à la population un effort collectif d'équipement, qu'elle se refuserait à faire librement dans sa majorité, en l'absence de toute obligation réglementaire ; subsidiairement, elle correspond également à ce fait qu'il est encore très difficile, dans la majorité des circonscriptions administratives, de trouver des personnalités compétentes pour gérer convenablement sur le plan financier et technique un organisme collectif si l'Administration n'est pas là pour les épauler, les guider et redresser leurs erreurs.
Dans ces conditions, remplacer purement et simplement les S.I.P., associations obligatoires sous tutelle administrative, par des coopératives autonomes représentant des individus volontairement groupés, paraît encore impossible dans la plu, part des cas.
Combien d'individus dans nos cercles ou subdivisions adhéreraient volontairement à des coopératives qui se chargeraient d'effectuer pour la collectivité des travaux ou des tâches dont l'utilité immédiate n'apparaît suffisamment certaine à leurs yeux ?
Quand il s'agit d'effectuer les travaux de barrage, les canaux d'irrigation, de construire des deeping-tank, d'acheter des géniteurs sélectionnés, d'installer des moto-compresseurs, de faire des pépinières sélectionnées d'agrumes, de cocotiers, de cacaoyers , de procéder, pour le compte de la population, à certaines opérations commerciales, serait-il vraiment possible de réunir le concours des milliers de cotisants que groupe actuellement chaque Société de Prévoyance, alors que l'oeuvre à entreprendre n'intéressera directement que quelques dizaines ou quelques centaines d'individus qui pourront profiter immédiatement de cette réalisation ?
Il suffit de poser la question pour constater que seule une formule comportant une certaine obligation d'adhérer, permettra de grouper la totalité des concours nécessaires pour accomplir les tâches ci-dessus énumérées, en attendant que l'éducation civique des populations soit assez avancée pour qu'elles comprennent spontanément l'intérêt de certaines réalisations collectives.
Qu'il suffise de citer l'exemple du casier rizicole de Monchon, où les paysans directement intéressés au bon entretien des ouvrages, se refusent néanmoins, jusqu'à maintenant, à assurer eux-mêmes volontairement cette tâche, et où la création d'une coopérative d'exploitation n'a pu, de ce fait, être encore réalisée bien qu'elle ait été prévue dès le début.
Opposer les Coopératives aux Sociétés de Prévoyance n'est donc pas faire oeuvre constructive, puisque les Coopératives ne sont pas en mesure de jouer le rôle dévolu à ces dernières ; dire que l'on réformera le statut des coopératives pour les adapter à l'état d'évolution des populations de la brousse reviendrait simplement à recréer, sous un autre nom, les Sociétés de Prévoyance. Reste à savoir, dans ces conditions, s'il ne vaudrait pas mieux tout simplement réformer les Sociétés actuelles , de Prévoyance, pour supprimer les abus qui, à un moment donné, ont créé contre elles un mouvement d'opinion.
C'est vers cette solution que semble s'être orientée d'elle-même la majorité des Sociétés de Prévoyance de la Guinée depuis quelque temps.
Sous l'impulsion de l'équipe de jeunes administrateurs pleins d'allant et à l'esprit moderne qui a repris en mains la direction de la grande partie de nos Cercles, nos Sociétés de Prévoyance se sont aujourd'hui lancées dans des réalisations où elles retrouvent le sens de leur mission. Qu'il nous suffise de citer la Société de Prévoyance de Télimélé qui créé actuellement la ferme-école de Kaffima où les jeunes gens de la région s'initieront aux méthodes de culture moderne sous la direction d'un jeune ménage de cultivateurs français ; les Sociétés de Pita, de Labé, de Mali, de Tougué, de Mamou qui entreprennent, dans les divers cantons, des travaux de barrage et d'irrigation, qui créent des centres d'élevage avec deeping-tank, herbage artificiel, constitution de troupeaux de géniteurs sélectionnés ; les Sociétés de N'Zérékoré et Macenta qui mettent en culture, pour le compte des villages environ, nants, des plaines jusqu'à maintenant négligées ; celle de Forécariah qui vient de lancer en grand la culture du cocotier ; celle de Boké qui entreprend l'équipement des palmeraies naturelles de toute la région, etc.
L'adhésion enthousiaste à ces travaux de toute la parti éclairée des populations, le concours total de toutes les autorités coutumières et des élus à ces réalisations, l'intérêt enfin que prennent aujourd'hui les séances des Conseils d'administration de ces S.I.P. où tous les esprits éclairés et influents de nos cercles tendent à participer, l'espèce d'émulation qui se développe de plus en plus entre les Sociétés de Prévoyance dans cette course aux réalisations prouve suffisamment qu'il s'agissait beaucoup plus de réformer cette institution en la remettant dans sa véritable voie, que de la supprimer pour les abus qui avaient pu en être faits.
Cette rénovation des S.I.P. va d'ailleurs de pair avec un développement concomitant des coopératives en Guinée. Loin de s'opposer, ces deux institutions, en effet, se complètent fort heureusement et leur expansion commune, à l'heure actuelle, est bien le signe d'un heureux développement du pays.
Nos coopératives, qui se créent aujourd'hui, groupent en effet non plus comme les S.I.P. la totalité des populations d'une division administrative, mais les individus volontairement adhérents, appartenant à une même profession, pour l'heureux développement de leurs activités actuelles.
La coopérative correspond à un stade déjà plus avancé de l'évolution de nos populations rurales : celui où notre paysan guinéen, devenu planteur spécialisé, entend, avec ses collègues tournés vers les mêmes préoccupations, mettre en commun ses efforts pour réaliser, dans le sein de sa profession, certaines tâches collectives qui lui paraissent utiles.
C'est ainsi que viennent de se grouper les planteurs africains de bananes, pour réaliser, en commun, le conditionnement de leurs produits et l'achat de leurs engrais.
Coopérative et S.I.P. ont donc chacune leur terrain propre activité et il ne s'agit pas de les opposer l'une à l'autre mais, au contraire, de les développer ensemble harmonieusement.
Le mouvement de rénovation des S.I.P., conjugué avec l'éclosion des Coopératives, prouve que la Guinée est engagée aujourd'hui dans un sérieux effort pour s'ouvrir largement au progrès économique et social.
Notes
1. Outil indigène.
2. Parcelle de terre cultivable.
3. Petit commerçant indigène dont l'éventaire est installé sur une table en plein air, ou sur les marchés ou dans les rues sur les trottoirs.
4. Chef de village.
5. La production bananière est en forte progression, non seulement en Guinée, mais dans tous les territoires de l'Union Française. Cet élément no. 1 de la situation doit être connu dans toute son ampleur. Voici les chiffres
| Année | Tonnes |
| 1946 | 29.658 |
| 1947 | 83.373 |
| 1948 | 158.681 |
| 1949 | 225.000 |
Ces chiffres sont matérialisés par les graphiques ci-joints :
 Tonnages |
 Prévisions |
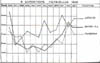 Exportations |
6. Commerçant indigène ambulant.
[ Home | Etat | Pays | Société | Bibliothèque | IGRD | Search | BlogGuinée ]
Contact :info@webguine.site
webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2013 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.
Fulbright Scholar. Rockefeller Foundation Fellow. Internet Society Pioneer. Smithsonian Research Associate.