Editions du Seuil. Paris. 1986. 185 pages
Samba sortit du bois avant le chant du coq. Il se dirigea vers l'est comme indiqué. Il gravit des monts. Il dévala des pentes. Il traversa des fleuves. Il marcha sept jours. Il marcha sept nuits. Sous le soleil. Dans la bourrasque. Se nourrissant à l'improviste. Quand la fatigue s'accentuait, il faisait un petit somme dans un fourré, la tête de guingois sur son baluchon, l'unique bagage qu'il eût emporté pour ce singulier voyage, cette aventure, cette quête faussement biblique d'il ne savait trop quoi. La folle dimension du projet ne l'émouvait guère. Au contraire, la perspective d'une découverte en solitaire, le sentiment de missionnaire élu qu'elle lui inspirait, lui donnaient une confiance sévère. Bien qu'encore tout jeune, il se livrait aux pensées sereines de la maturité. Il venait tout juste d'être circoncis et cela soutenait sa confiance.
Au bois de Boroko, quand son grand-père lui avait transmis ce qu'il devait faire, il s'était dit qu'il sortait d'un cocon emprunté avec lequel il n'avait eu qu'appréhensions et malentendus. Il partait indemne de toutes les passions de Kolisoko. Il n'avait pas eu de petits camarades de jeux, n'avait noué aucun lien affectif, n'avait souscrit aucun contrat moral. Il partait avec ce bon goût de solitude et de liberté qui épousait si bien son fond naturel.
Au bout de sept jours et sept nuits, un village se dessina à l'horizon, flou dans le brouillard du petit matin. Samba s'en approcha, titubant de fatigue et de faim, les pieds tailladés par les épines, le chiendent et les arêtes des cailloux. Il se tapit derrière la palissade de bambous qui ceinturait le village en attendant que le soleil se levât. Il fixa son attention sur les chants des coqs et les aboiements des chiens afin de se tenir éveillé.
Il s'endormit cependant et, quand il se réveilla, une femme fort avancée en âge était penchée sur lui, l'examinant d'un air incrédule. Elle avait un visage grisâtre, desséché et convulsif, des lèvres flétries mais amusées, entre lesquelles se montrait une langue rose et remuante. Elle était arc-boutée à un bâton de bois mort sur lequel ses mains s'agitaient sans discontinuer. Elle conduisit Samba dans sa case en débitant un flot de paroles à voix basse sur le sort inquiétant de la jeunesse d'aujourd'hui :
— Le chemin vous prend dès la naissance. Et ça se met à voyager avant même que les tendons ne se raffermissent. Ça veut fouiller tous les recoins de la terre. Et ça oublie de revenir. Il y en a, paraît-il, qui en meurent, de voyager au hasard comme ça, sur n'importe quel coin de terre étrangère. Mourir loin de chez soi ! Hé hé, vous appelez ça mourir, vous ? C'est ainsi que j'ai un bout de petit-fils qui a grandi à ma traîne. Tranquille et plein de douceur tant qu'il ne savait pas tenir sur ses deux pieds. Et puis, c'est parti dès que ça a appris à marcher. On dit qu'aujourd'hui ça se meut dans une brousse lointaine. Une brousse si lointaine que personne ne connaît son nom, si, toutefois, ces contrées que le rêve lui-même n'atteint pas portent elles aussi un nom. Certains disent que le froid y coupe le doigt… Maintenant, toutes les semaines, ça vient buter contre la porte du village, affamé et épuisé mais ça n'en continue pas moins son chemin. A gambader ! A gambader ! Et dans tout ça, vos pauvres parents, est-ce que vous vous en souciez ? Non. Leurs coeurs pourraient éclater, pourvu que vos pieds bougent.
Elle lui offrit un plein bol de toori-kaaba 1 à l'oseille qu'il se mit aussitôt à ingurgiter en savourant la chaleur bienfaisante que la nourriture procurait à son corps transi. Elle ne lui posa aucune question sur son origine ni sur sa destination ; mais elle sortit un moment et, quand elle fut de retour, elle était accompagnée d'une ribambelle d'hommes, de femmes et d'enfants qui se mirent à le reluquer en écarquillant les yeux et avec des murmures circonspects. Celui qui semblait être le patriarche s'approcha de lui et parla d'une voix forte qui vibrait :
— Enfant, nous ne te connaissons pas. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on te fasse du mal. Ce village est le village de tout le monde. Du moins, il appartient à tous ceux qui, en âge de le faire, mettent la main à la pâte et gagnent honnêtement leur becquetée. Donc, je serai clair une fois pour toutes : je dis que ceux qui ont le mauvais penchant de chaparder ou de traînasser sur leur derrière, sans rien faire, ne sont pas des nôtres et doivent passer leur maudit chemin. Enfant, ne prends pas mal mes propos. Je ne m'adresse pas à toi en particulier. Je dis que nous ne te connaissons pas encore. C'est pour que ce soit clair. Nous ne te harcellerons pas de questions. Les devoirs de l'âge nous obligent cependant à te rappeler que l'aventure est parsemée d'embûches même pour les hommes mûrs, à plus forte raison pour les jeunets sans force et sans expérience. Mais libre à toi de faire à ta guise. Bien que quelque chose me dise que ton chemin n'est pas bon. Tu ferais mieux de retourner sagement dans ton village natal. Voilà ce que nous te proposons : tu nous accompagnes aux champs pour aider un peu, et, à la fin de la journée, tu reviens avec nous pour te reposer, un jour, deux jours si tu veux et, ensuite, tu regagnes ton village en beauté. Il y aura des gens pour te raccompagner ne serait-ce que sur la moitié du chemin.
On était au début de l'hivernage. La nature, jaunie par la saison sèche encore proche, s'imbibait d'eau et renaissait. Les ruisseaux et les marigots reprenaient leur voyage saisonnier. Les plantes reverdissaient de concert et affichaient une rieuse panoplie de jeunes fleurs. Les champs exhalaient une troublante odeur de terre humide et d'herbe tendre. En l'air, insectes et oiseaux fêtaient avec des cris aigus et des vols planés cette renaissance du monde.
Le patriarche distribua les houes. Tout le monde se mit à cultiver avec des “hans” virils et connaisseurs.
Samba fut vite distancé par la ligne des laboureurs. Ses coups étaient mous et son front transpirait. Ses mains prenaient des cals douloureux qui saignaient.
Sur les injonctions d'une femme apitoyée par son état, il fut décidé de lui retirer l'outil et de lui confier la garde d'un enfant braillard dont la mère était occupée avec d'autres femmes à préparer le déjeuner. On le pria de s'installer avec le mioche à l'ombre d'un bosquet et d'essayer de le faire taire à l'aide d'une calebasse de gosi. L'enfant le dégoûtait. Il bavait à force filets et portait une tignasse peuplée de mouches. Son nez était empli d'une bonne crotte de farcin. Dans les mains de Samba, il braillait de plus belle. En vain, celui-ci le fourrait de cuillerées de bouillie qu'il recrachait avec sa bave. Du champ, des voix conseillaient le jeune homme :
— Amuse-le. Frotte-lui le ventre. Surtout ne le pince pas. (Plus bas :) Serait-ce un mauvais garçon qui se plaît à pincer les bébés ?
Samba était excédé. D'ailleurs, tout finissait par l'excéder : les attendrissements de la vieille, la sympathie générale qui ne se départissait néanmoins pas d'une méfiance sournoise, comme atavique. Et puis le bébé… Le bébé qui n'arrêtait pas de crier… La bouillie tiède et appétissante sous son nez qui n'avait flairé depuis des jours qu'une mixture de maïs… La terre humide, ses vers, ses limaces, ses mouches tsé-tsé… Cette absurde corvée de labour dans un champ qui lui était étranger, parmi des gens avec qui il ne se sentait nulle attache…
Il commença à puiser dans la bouillie, par amusement. La nourriture passait bien, le goût de miel et de lait réveillait son appétit. Il finit par vider tout le contenu de la calebasse à grandes lampées voraces, ce qui eut pour effet de redoubler les pleurs du bambin. Des pleurs qui devinrent si stridents que Samba se mit à paniquer. Il remplit la calebasse de feuilles sauvages : rien n'y fit. Il la remplit de boue, cela non plus n'y fit rien. Il la remplit de mouches. Il la remplit de fourmis-magnans. Les bestioles s'en prirent à l'enfant, se fourrèrent dans sa petite tunique, rentrèrent dans son nez, le piquèrent aux bras, aux jambes et jusque dans sa tignasse. Il se mit à saigner. Ses pleurs devinrent hystériques. Il roula par terre en se trémoussant comme un possédé.
Samba prit ses jambes à son cou, bientôt poursuivi par les villageois armés de leurs pioches et qui, avec leur rapidité de chacal, allaient certainement l'attraper. Il eut juste le temps de disparaître dans la brousse et de s'introduire dans une grotte que le miracle offrait. Tapi dans son refuge, il entendait ses poursuivants sonder la brousse, jurer par tous les dieux qu'ils le tondraient, le roueraient de coups jusqu'à ce que mort s'ensuive et qu'ils donneraient son corps à une meute de hyènes :
— Vous hébergez un fils du chemin, venu de vous ne savez quel damné ventre de femme, vous le nourrissez, vous lui faites confiance et, en retour, il torture votre enfant !… Un fainéant de plus qui gémit sous le poids de la houe !… J'aimerais, ha, j'aimerais l'avoir entre pouce et index…
Quand, découragés par la nuit qui tombait, ils regagnèrent leurs cahutes, Samba refit surface. Il traversa la brousse au jugé. Après le village et ses champs, il y avait un boowal où s'égosillaient des hordes de cynocéphales et de chimpanzés qu'il dépassa sans danger en serrant les sept noix de cola qui gonflaient sa poche. Après le boowal, une montagne dénudée, en pain de syénite massif. Derrière la montagne, un chemin battu. Le chemin menait à Djimmeyaɓe…
Djimmeyaɓe ! Ses maisons féeriques : leurs magnifiques escaliers, leurs cours spacieuses et proprettes, leurs jardinets impeccables ! Ses rues larges et perpendiculaires ! Ses lumières de fête céleste ! Ses automobiles ! Sa population bien mise, affairée, toujours pressée de passer et de repasser !… Samba n'avait jamais rien vu de pareil ! La ville était là à sa portée, engageante et terrifiante. Elle le laissait interdit, comme un éphèbe devant une femme trop sensuelle. Il en foula le sol avec circonspection, retenant son souffle, d'un pas indécis sur le macadam. Il posait pied sur le sol lunaire…
Il envisagea de passer la nuit à la belle étoile, sur un morceau de tôle ramassé au marché. Voyant cela, un policier s'empressa de le dissuader :
— Tu veux dormir ici, en plein air et sur la place du Marché de surcroît ? Tu n'y penses pas ! Ne sais-tu pas que tu es ici au centre-ville, le fief des Blancs ? Si on est Noir, couleur de bois flambé, il faudrait être commis. Et même mieux : commis-interprète. Alors, tu es commis, toi ? Hein, tu es commis avec tes haillons de broussard mal déterré ? Si c'est ainsi, écris tout de suite ton nom. Nom. Prénom. Age et lieu de naissance. Domicile… Bon, tu ne sais pas, sacré Dieu. Déguerpis donc. Fou mela kan. Et puis, dans tout ça, d'où viens-tu ? Que fais-tu ? Si tu n'as pas où dormir, va chercher du côté des broussards, à la périphérie de la ville, à Leydi-Bondi : Chauve-souris, Pique-nez, Touguiyé et autres puanteurs. Crois bien que tu seras mieux là-bas. Il faut sortir de la ville et trotter une bonne lieue. Tu vois, là-bas, après le Carrefour-Grand, dans les Bas-Fonds. Allez, ouste, nyaffru !
Au Carrefour-Grand, un étalagiste indiqua à Samba la direction des Bas-Fonds. Du sommet d'une colline, lui apparut, étalé jusqu'au précipice de la falaise, un chapelet de sinistres bourgades. Les habitations se composaient de baraquements sans fenêtres, aux toits bas de torchis ou de tôle brunie, généralement retenus contre le vent par des briques ou des pierres posées. Des toits, des courettes et des ruelles s'élevaient des volutes de fumée âcre. Un territoire de gadoue, d'excréments et d'odeurs fétides ; un monde de détritus, le dépotoir de Djimmeyaɓe. Il y avait là tout ce dont la ville ne voulait pas, tout ce qui la gênait et dérangeait son luxe tranquille. Des morceaux de carton, de plastique, de bouteilles et de quincaillerie élimée. Des amas de souquenilles où des hommes anéantis venaient s'habiller. Des ruelles en lacets, lépreuses, recouvertes d'eaux usées et de rogatons en putréfaction finissaient en impasse devant des puits, des buanderies ou de sordides latrines.
Son émerveillement de tout à l'heure s'était estompé. Samba marcha au hasard, peu engagé. Ici ou là, il s'arrêtait parmi une foule de badauds pour contempler des scènes burlesques : la démarche d'un soûlard, l'accoutrement osé d'une fille de joie que des voyous importunaient. Ce que, somme toute, il aimait dans cette ville, c'était le détachement, une certaine insouciance, le sens de l'instant, et surtout l'anonymat dans lequel il évoluait en solitaire. Il aimait également l'air de fête perpétuelle de la rue à la lueur des rares ampoules électriques et des lampes tempête, les étalages de cigarettes, de bonbons et de mets alléchants : takulata, riz-jolof, tó, ignames, bananes et ananas. Où que vous alliez, cette ville avait de quoi vous offrir et vous séduire, même dans ses Bas-Fonds, en dépit de la misère et du laisser-aller. Partout des gadgets, de la mangeaille et du spectacle. Ici, on ne pouvait s'ennuyer. Il aurait à livrer un rude combat contre ce monstrueux village, mais il sentait déjà qu'il en serait capable, qu'il arriverait à lui soutirer la satisfaction de ce désir confus qu'il suscitait en lui. Il se battrait, il n'y avait pas lieu d'en douter…
Pour l'instant, son estomac le tiraillait, lui rappelant affreusement des objectifs plus immédiats. Il s'approcha d'un étalage sans en avoir l'air, piqua une coudée de manioc et une bonne boule de kanyaa qu'il enfouit en un tour de magicien dans son baluchon. Voilà qui était fait.
Restait la couchette qui ne devait d'ailleurs pas poser plus de problèmes : une bonne moitié des résidents des Bas-Fonds dormait dans les hangars du Marché-du-petit-jour, sous les vétustes vérandas à moins que ce ne fût simplement dans la rue, sous la brise de la mer, sous la bienveillance de la fortune. Il n'avait qu'à se trouver un carton, une planche, une quelconque plaque de métal et s'installer tout comme un autre sur une portion tranquille de trottoir.
Il se réveilla le lendemain, humide et poisseux : une respectable ménagère l'avait malencontreusement aspergé des eaux de sa vaisselle. Signe des dieux à vrai dire, à quelque chose malheur était bon. Sa mésaventure fut compensée par un petit déjeuner copieux et d'autant plus ragoûtant qu'il ne s'y attendait pas le moins du monde. Car la charmante gaffeuse qui, du coup, s'était mise à rire, l'entraîna en s'excusant autour d'un âtre sur lequel chauffait un canari au bon fumet. La bienfaitrice le servit. Elle le regarda manger avec un intérêt amusé. Quand il se fut lavé les mains et rincé la bouche, elle lui parla :
— Je vois, homme, que tu n'es pas d'ici. Oui, rien de plus vrai : tu sens l'étranger comme le bouc sent le bouc. Homme, tu pardonneras à une femme pleine de salive de se mêler de ce qui ne la regarde pas…
Cette ville ne porte rien de bon. Elle promet, elle promet, vous donne de l'envie, use vos nerfs, suce votre force, vous détruit le coeur et, pour finir, vous abandonne comme une vieille savate. Il était bon que tu le saches. C'est que j'en ai vu des comme toi arriver avec leurs ardentes illusions de jeunesse. J'ai vu la ville les terrasser, continuer à leur assener des coups à terre jusqu'à en faire des loques, des débris d'existence, je te dis. Et ce qui hier riait et espérait apprend aujourd'hui le mal dans tous les sens, se met à boire et à cogner, s'effiloche doucement du corps et de l'âme et sombre une fois pour toutes dans la démence.
Homme, combien j'en ai vu crever dans le fossé ! Ici, ne t'attends à aucun appui, à aucun garde-fou. Les hommes vivent côte à côte, c'est tout. Entre eux, rien d'autre que l'argent : de la parenté, de l'amitié, de l'amour, de la solidarité en bons billets de banque froufroutants. Sans argent, l'enfer vaut mieux que cette ville. Tous ces hommes que tu vois se démener aussi fébrilement, où crois-tu qu'ils aillent ? A un enterrement ? Non, ils courent vers l'argent. Seulement, cette satanée proie est comme mât de cocagne. Rares sont les élus qui l'atteignent, tous les autres glissent et répandent inutilement leur sang tandis que Dieu et le diable rigolent de concert. L'argent, le maudit ! Mais, en attendant, c'est bien lui qui fait vivre.
Et j'allais justement te demander comment tu comptais t'y prendre. Et je pose là une question bien idiote. Les choix sont minces. Il faut trouver du travail, n'importe quoi, et, pour cela, il n'y a qu'un moyen : aller au Carrefour-Grand. Tu as dû passer par là avant d'arriver ici. C'est la frontière entre la ville et les Bas-Fonds. Si tu t'y présentes de bonne heure, tu as peut-être quelque chance. Pour aujourd'hui, c'est râpé : il est déjà trop tard. Tu iras demain avant l'aube. Les demandeurs d'emploi sont nombreux et il faut faire la queue. D'ici que tu puisses voler de tes propres ailes, tu pourras toujours rester ici. Il y a un bout de natte.
Pour ce qui est de la bouffe, nous partagerons ce que la chance aura mis dans ma marmite les jours où elle s'avisera de mon existence. Ne me remercie pas. Ne te sens aucune dette. Je le fais parce que cela me plaît de le faire. La vie m'a appris à voir. Des hommes, je n'attends plus grand-chose. Je ne peux plus me payer le luxe des nobles sentiments. Je n'ai qu'à prendre ce qui arrive et à me résigner sans rancune quand le sort m'en dépossède. Les hommes sont innocents, c'est la ville qui a gâté les choses…
Non, je n'attends rien. Ni de toi ni de personne d'autre. Tu feras à ta guise. Tu n'es pas différent d'un autre quand bien même je ne te connais pas encore. Non, tu n'es pas différent, aussi vrai que je m'appelle Oumou-Tiaga… Maintenant, si tu n'as plus faim, va marauder à ton aise. Tu reviendras ce soir. Tiens, une pièce, tu verras que tu en auras toujours besoin.
Lieu d'embauche, le Carrefour-Grand fourmillait de chômeurs avant même que la nuit ne finisse de s'en aller. Ce dérisoire marché de l'emploi — mais aussi de tout ce qui pouvait s'écouler de prohibé et de volé — se tenait en plein air dans un terrain vague attenant au carrefour proprement dit. Les agents d'En-haut venaient y recruter les boys, les cuisiniers, les gardiens de résidence dans le bétail des Bas-Fonds après les avoir tâtés, jaugés et palpés sous tous les angles.
Cela se passait dans un tohu-bohu de foire, bien que ce désordre eût ses règles, ses lois et sa hiérarchie — il faudrait peut-être dire ses rites — comme tout autre service. Comme toute forme d'organisation humaine, ce monde avait ses chefs, ses hommes d'ordre et sa populace.
Pour accéder aux agents recruteurs, les chômeurs étaient tenus de se mettre en rang dans une file interminable après s'être acquittés d'un « impôt de queue » que prélevait un mystérieux syndicat. Plus on payait, mieux on était placé. Et si, par malchance, on n'était pas embauché, il fallait repayer le droit et retourner au bout de la file.
Samba passa des mois d'attente harassante et infructueuse. Oumou-Tiaga le réveillait à l'aube, préparait le déjeuner, lui fourrait une pièce dans la poche et le poussait dehors en le stimulant. Au bout du défilé, un agent renfrogné coulait sur lui un regard antipathique, faisait la moue et secouait la tête avec autorité pour signifier un refus. Entre-temps, lui et la ville s'étaient suffisamment épiés pour se connaître davantage. Il avait occupé sa journée à l'essayer, à l'étudier, à mesurer son importance, ses atouts et ses failles.
De même, Oumou-Tiaga n'était plus cette inconnue qui l'avait aspergé d'eaux usées un certain matin. Entre la femme et lui, la distance s'était amenuisée. Surtout depuis cette fameuse nuit où elle avait délaissé le matelas sur lequel elle dormait d'habitude pour le rejoindre sur la natte quelques mètres plus loin, après avoir pris soin de tirer le rideau sur ses deux enfants qui dormaient du côté de la porte. Elle lui était tombée dessus, tout en flammes, nue sous un pagne nonchalamment retenu au-dessus des seins. Elle lui avait sucé la bouche, mordillé la poitrine avec une ardeur qui lui faisait pousser des saccades de râles. Son corps fiévreux avait éveillé en lui des sensations inconnues de bien-être pernicieux et, pour la première fois, ses mains avaient pétri les formes pulpeuses des arcanes féminins. Ils avaient réuni leurs souffles et leurs corps aux confins des prodiges nocturnes. De cette première épreuve d'amour lui était resté un troublant souvenir de transpiration d'aisselles, d'haleine chaude, d'humidité pudique et comme une faille ouverte à cette nouvelle dimension de l'existence.
Ils s'étaient régulièrement
retrouvés les nuits qui s'étaient ensuivies, non plus sur la natte, mais sur le maigre matelas posé à même le sol et qu'ils partageaient maintenant maritalement. Quand ils avaient fini de faire l'amour, Oumou-Tiaga posait sa tête sur les épaules de Samba avec un air de martyr enfin protégé et se confiait tout à son aise…
Comme lui, elle était née dans un village. Un modeste village de fonio et de taro. Mais un amour de pays. Une pertinente odeur de maïs et d'oranger. Une tendresse close et vigilante qui ne lâcherait pas un seul de ses fils. Mais, voilà, la vie a de ces tours à pendre un cours d'eau… A l'âge de treize ans, ses parents l'avaient donnée en mariage, pour faire son bonheur, suivant en cela certaines prescriptions qu'il convenait de respecter.
L'homme auquel on l'avait destinée habitait la ville. On le disait notable, bon musulman et cousu d'or, ce qu'il avait du reste prouvé en envoyant aux parents de sa promise des malles de tissus, des bonnets, des bijoux ainsi que de l'argent. Le mariage fut célébré en grande pompe, ce fut une fête inoubliable au cours de laquelle une meute de griots s'était livrée une impitoyable joute de musique et de narration. Ce jour-là, les billets de banque avaient fendu l'air, les ventres s'étaient rassasiés et la joie avait régné. Assurément, s'était-on dit, la jeune fille était chanceuse : en cherchant jusqu'aux confins du ciel, on ne pourrait trouver aussi bon parti.
Sagesse et notoriété !
Piété et confort ! Qui aurait pu mieux dire ?… Voilà donc la jeune Oumou en ville, remise en mains propres à son homme.
En fait de notable, c'était un jardinier chez un couple d'Européens gâteux. Sans tirer le diable par la queue, il vivait modestement dans un deux-pièces des plus ordinaires à Touguiyé. La lune de miel consommée, il avouera d'ailleurs que, pour fêter le fameux mariage, il avait dû débourser sept ans de jardinage assidu. Et même, cela n'avait pas suffi : sans le secours des copains, il n'y serait pas arrivé. Bien entendu, il n'avait dit tout cela que pour les charmantes petites oreilles d'Oumou, en ces temps d'hommes aux oreilles préhensiles et aux langues fourchues !
De ce mariage, elle avait eu deux enfants, les deux fillettes qui dormaient avec les poules du côté de la porte, derrière le rideau, pendant qu'elle prenait ses aises avec Samba. Alors qu'elle était grosse de sa deuxième gamine, son mari s'était retrouvé sans travail : ses patrons avaient décidé de retourner dans leur pays… « Jusque-là des Nègres, des moustiques, des tam-tams et des nuits sans opéra. »
L'homme s'était mis à tourner dans la maison comme un cheval en furie, à boire et à envoyer dans le ventre de sa femme des talonnades de diable. Parti un jour au cabaret, il ne revint jamais.
Sans métier, sans expérience, Oumou abandonna le deux-pièces qu'elle n'était plus en mesure de louer et vint s'installer ici. Pour vivre, elle s'employa à laver la vaisselle de plus fortunés qu'elle. En guise d'appoint, pendant la journée, elle recevait un ou deux hommes qui pouvaient payer.
Et c'est pourquoi les ergoteuses du quartier l'avaient affligée de ce sobriquet de Tiaga dont, du reste, elle ne ressentait nulle honte. Elle n'avait pas de comptes à rendre, n'avait plus le temps de s'effaroucher pour pareille vétille. Elle n'avait pas non plus le sens de la comédie, du superflu ni de l'orgueil. Elle cherchait à vivre sans complication mais, en fait, elle survivait plus qu'elle ne vivait, malgré tout heureuse de respirer de l'air, de manger un bout et de s'occuper de ses enfants.
Comme l'eau limpide des sources de son village, une chose était claire : ses filles ne vivraient pas comme elle. Elles n'habiteraient pas Touguiyé ni aucune autre cité des Bas-Fonds. Elles seraient des dames respectables portant talons hauts et sacoches de peau d'iguane. Personne ne les insulterait et elles choisiraient elles-mêmes leurs compagnons : bien sûr de beaux messieurs chaussés de mocassins cirés, habillés de boubous amidonnés ou de costumes de flanelle, nouant cravate et portant montrebracelet en argent, pour le moins. Des messieurs qui l'appelleraient « maman », lui offriraient des fleurs et lui baiseraient la main. Alors serait oubliée Oumou-Tiaga et on reverrait Oumou-tout-court. Car elle ne se sentait pas Tiaga hier comme aujourd'hui à plus forte raison demain. Que les gens continuent leurs jabotages, rien ne l'empêcherait de vivre comme elle pouvait…
Bien entendu, Samba ne paierait pas, même si tout l'or du monde tombait dans son baluchon. Lui, c'était autre chose : elle voulait qu'il soit son homme tant que cela ne le dérangerait pas. Son homme comme ça, rien que pour voir…
Ce furent donc des mois d'amour et de sourde fraternité qu'Oumou et Samba vécurent en attendant que les agents du Carrefour-Grand montrent plus de mansuétude. Des mois d'amour, certes, mais des mois qui pesèrent lourd sur le maigre budget de la femme. Samba se présenta pourtant régulièrement, se soumit stoïquement tous les matins aux acrobaties de la queue-leu-leu sans succès.
Quand la chance lui sourit, il ne l'attendait même plus.
Cela se passa un jour où, comme à son habitude, l'agent avait fait la moue et secoué catégoriquement la tête pour dire non. Mais, derrière lui, à bonne distance de la file, une femme blanche se mit à riposter en agitant une main en direction de Samba. L'agent sortit le garçon du groupe et le mena au devant de la dame qui débita des mots tout droit sortis de la gorge, mots parmi lesquels Samba entendit celui de boy, et son regard s'alluma.
Elle s'appelait Mme Tricochet. Elle était svelte et fessue, avait un visage poupin et tacheté, des cheveux couleur de soleil. Elle voulait un boy. Les Tricochet habitaient une somptueuse demeure en bordure de mer. Une maison blanc crème, faite en bois et recouverte d'un lierre gras d'un beau vert. Le travail de Samba consistait à frotter le plancher, à plonger la vaisselle, à essuyer et ranger assiettes et couverts dans des commodes compliquées, à laver les vitres, à arroser le jardin, à faire la toilette du chat et du chien. Mme Tricochet lui expliqua avec un gloussement plusieurs fois répété qu'elle le prenait à l'essai mais qu'elle pourrait le garder s'il donnait satisfaction.
L'apprenti boy passa son examen avec brio : trois jours plus tard, un demi-sourire de Mme Tricochet le rassura sur son sort.
M. Tricochet était un homme replet, de taille moyenne, au visage empâté d'où pointait un nez hardi et rougeoyant toujours emperlé de sueur. Il partait de la maison tôt, revenait à midi avaler son repas en vitesse et repartait en s'excusant, avec son éternelle vieille sacoche de cuir grenu.
Il parlait peu. Il répondait à sa femme en bougonnant. A la maison, il occupait le plus clair de son temps à compulser des paperasses.
Mme Tricochet demeurait généralement à la maison. Elle cousait, rangeait des objets minuscules auxquels elle semblait vouer un attachement rituel. Elle aimait chanter en s'accompagnant d'un piano vieillot. Elle avait une voix aiguë, légèrement enrouée, qui propageait des notes pitoyables et chevrotantes. Souvent, elle s'installait dans le jardin et se mettait à peindre des forêts, des cafards, des puces géantes. Elle s'amusa même à faire un portrait de Samba : un Samba végétatif et diffus à peine différent des forêts, des cafards et des puces.
Elle recevait parfois une dame entre deux âges, toute ridée, toujours enrhumée et qui parlait comme une pie. Elles s'embrassaient, se congratulaient longuement et s'installaient au salon où Samba leur servait l'apéritif. Là, elles papotaient en gloussant avec profondeur.
Le reste du temps, Mme Tricochet déambulait d'une pièce à l'autre, époussetait en passant un rebord de fenêtre ou remettait un napperon à sa bonne place, en attendant le retour de son mari. Elle pouvait aussi, vêtue d'un maillot deux-pièces, s'installer dans le jardin et lire en gambillant.
Samba dormait dans un galetas au fond du jardin, sur un sommier qui produisait sous le poids de son corps un grincement infernal. Son gîte regorgeait de cafards, de toiles d'araignée et de poussière.
Mais, somme toute, il ne se plaignait pas chez les Tricochet. Son travail ne demandait pas un effort surhumain et il n'y avait là rien de comparable aux corvées champêtres. Et puis s'assurer le gîte et le couvert, c'était toujours ça de pris à cette ville de sécheresse d'âme. D'autant qu'en plus de la nourriture et du logement un bon billet de banque tombait dans sa poche à la fin de chaque mois.
Il terminait sa semaine le samedi soir. Après dîner, ses patrons se paraient, se parfumaient beaucoup et sortaient en voiture. Il débarrassait la table et s'empressait de rejoindre Oumou-Tiaga en rapportant des restes de poulet, d'oeufs et de pain sur lesquels les deux petites se jetaient voracement. Le dimanche, il se permettait une petite grasse matinée.
Ensuite, il se promenait, s'achetait des sandales, de la brillantine, du parfum, quelques vêtements et ramenait une ou deux bricoles pour Oumou et pour les enfants.
Pour un premier contact avec la ville, il n'avait pas à se lamenter. Sans tomber dans l'euphorie, il y avait plutôt de quoi espérer. Maintenant, avec l'oeil bienveillant des dieux et des ancêtres, tout devrait aller comme sur des roulettes. Le broussard avait trouvé un créneau dans l'imbroglio de la ville, se faisait aux exigences du monde moderne, s'adaptait doucement…
Chaque matin, Mme Tricochet l'emmenait en voiture au marché pour faire les courses. Elle improvisait une promenade, prenait lentement la corniche, regardait la mer, dont elle parlait en termes sibyllins…
Le soir, dans sa cabane, Siɓɓe rendait visite à Samba. Le vieux venait s'asseoir au bord du sommier, sans mot dire, prenait un cafard qu'il se mettait à manipuler, posait sur Samba un regard froid…
Par les temps de grande chaleur, le boy sortait prendre l'air dans le jardin, écoutait le clapotis des vagues. Des bribes de conversation lui parvenaient de la chambre de ses patrons : une voix de baryton excédée à laquelle répondaient des mots plaintifs et secoués. Il entendait comme un sanglot névrotique prolongé. Il s'asseyait sur un banc, essayait de deviner le mystère de cette maison, de cette ville, de cette mer…
Siɓɓe apparaissait tout de blanc vêtu, un cafard dans la bouche, à la main une racine torse et noduleuse, puis il disparaissait, s'en allait se confondre avec la mer…
Parfois, c'est un pleur strident suivi d'un bruit de porte qui réveillait Samba. Il sortait et trouvait Mme Tricochet morfondue dans le jardin. Dissimulé derrière un arbre, il l'observait, voyait sous les veilleuses des lampadaires la pâle silhouette, distinguait le visage serré d'une tristesse énigmatique. Sa tête prenait un coup de vertige. Il transpirait et s'en retournait à son sommier…
Entre autres caprices, Mme Tricochet avait la manie de se faire masser. Elle sentait tout le temps des douleurs, et il fallait que Samba la masse. Après avoir nagé dans la piscine, elle s'allongeait sur un lit-Picot ; le garçon l'enduisait de pommade et elle se laissait pétrir puérilement.
Un matin, elle réveilla son boy avec brusquerie en lui intimant l'ordre d'aménager la chambre du rez-de-chaussée.
L'air marin qui s'engouffrait à l'étage lui donnait des rhumes, dit-elle. Dorénavant, elle dormirait au rez-de-chaussée. Elle avait le visage bouffi, plus blanc que d'habitude, un visage
exsangue, des yeux humides, enlaidis par de méchants cernes verdâtres. Sitôt la chambre prête, elle s'enferma à double tour. Elle ne mit pas le nez dehors de la journée.
Elle bouda le dîner, commanda d'un ton désagréable un tube d'aspirine.
Une journée affreuse pour Samba ! Madame cognait la porte, hurlait pour demander un mouchoir, un tube de cachets, un verre d'eau ou un jus de fruits. Et ce n'était pas le bon tube, et le jus de fruits n'était pas frais, et l'eau était infecte, contenait d'abominables souillures. A la fin de la journée, la dame lui avait communiqué une migraine épouvantable qui l'obligea à se coucher tôt…
Siɓɓe vint le voir, le nargua en découvrant des bouts de dents noires et se mit à lui fourrer dans la tête des centaines d'épingles rouillées. Son boubou, le boubou tout blanc de l'autre nuit commençait à se salir…
Les rares présences de M. Tricochet à la maison. Ses silences pieux pour le peu qu'il était là. Son regard vitreux et fuyant qui cherchait toujours à s'échapper vers la sacoche… L'ostracisme de Madame. Son saint détachement. Son indifférence bilieuse. Son corps anémié qui ne quittait plus la robe de chambre. Ses pas de fantôme sur le carrelage de faïence. Ses cheveux décatis qui commençaient même à tomber. Ses yeux ternes… Madame qui boudait les repas, s'énervait à la moindre vétille. Madame qui ne recevait plus, ne chantait plus, ne peignait plus.
Le lendemain, à son réveil, la terre bougeait sous les pieds de Samba. Les plantes du jardin se métamorphosaient en odieux épouvantails. Le clapotis des vagues avait pris le bruit mat de la chute d'un corps lourd et mou. Par chance, Madame garda la chambre les jours suivants, se servant elle-même en cachets, en jus d'orange, en glaces et en biscuits quand elle daignait en ressentir l'envie. Et les dieux, en leur inestimable miséricorde, avaient bien fait les choses ainsi.
Car le jour où elle s'avisa de refaire surface, ce fut une épouvante. Où donc était passée la patronne avenante bien que déconcertante avec son humeur alternative et ses caprices d'enfant unique ? Envolée, l'amante éphémère ?
Même M. Tricochet ne reconnaissait pas la fureur qui jaillissait de la fantaisiste retraite comme un diable courroucé de sa boîte. Son passage faisait l'effet d'un petit ouragan. Les meubles se renversaient. Les assiettes volaient en éclats. Les portes claquaient sec. Madame criait à tue-tête des paroles incohérentes dans lesquelles revenait comme un leitmotiv « je ne supporte plus » — on ne savait jamais quoi. En fait, elle ne supportait simplement rien. Ni M. Tricochet qu'elle houspillait dès qu'il rentrait du boulot, qu'elle poursuivait dans l'escalier et qui se précipitait dans son bureau en se contentant de murmurer : « Calmos, calmos, quand même. »
Ni la piscine dont elle avait fait vider l'eau. Ni les rituels massages. Ni les bains de soleil. Ni les promenades dans le jardin. Ni le chien. Ni le chat. Ni surtout Samba qu'elle venait tirer de son grabat par les cheveux à des heures indues, qu'elle traînait dehors et qu'elle injuriait copieusement :
— Tes cafards ! Tes poussières ! Ton sinistre regard ! Nègre de brousse ! Puanteur ! Insoutenable puanteur ! Tu me repousses ! Tu me dégoûtes ! Tu me donnes la nausée ! Tu me révulses les
yeux ! Souillure ! Faut que je te tue. Que je te tue. Que je te tue…
Elle serinait longtemps sa menace comme pour s'en persuader elle-même. Elle cognait avec ses poings dérisoires et osseux jusqu'à l'épuisement. Elle s'écroulait, se tortillait comme une limace, se contractait, enfonçait ses doigts de babouin diarrhéique dans son ventre, son visage, ses cuisses. Elle vomissait. Elle délirait. Appelait sa maman. Se calmait et gisait piteusement. M. Tricochet grondait :
— Aide-moi donc, moricaud. Aide-moi, nègre de malheur, à la porter dans sa chambre. Ouais, cela ne te dit rien, à toi. Tu en jouirais plutôt. Créature sans coeur ! Grossièreté d'homme ! Et après, arrange-moi la cuisine ! Tu vas en faire une véritable porcherie à la fin !…
La plaie de Siɓɓe s'agrandissait et s'emplissait de pus. Dans sa main, le cafard avait séché. Son boubou avait pris une teinte de terre. Il touillait sa blessure avec la racine torse et noduleuse. Il sautillait, poussait un satanique éclat de rire et repartait dans un envol de charognard burlesque.
Madame finit par couper le dimanche et par interdire à Samba de sortir de la maison. Avec l'assentiment bon enfant de Monsieur qui s'occupa diligemment de veiller à la stricte application de cette mesure, d'ailleurs non sans génie. Car le sérénissime époux, qui commençait à sortir le nez de sa sacoche de paperasses captivantes, jetait comme un premier regard sur la piscine, la mer, la cabane du fond du jardin, sa femme, sa maison, son boy à lui, ce garçon énigmatique et solitaire qui révélait lentement les néfastes penchants enfouis sous la sournoise gentillesse qui l'avait innocenté au début.
Et il venait à M. Tricochet une odeur bizarre de mer. La maison exhalait un air de renfermé, de moisi. Sa femme sentait l'étrangère avec ce qu'une étrangère suscite d'intérêt neuf et enivrant. Samba, lui, sentait le soupçon, le soupçon fait homme. Un soupçon vague et insaisissable, mais agressif, révoltant. Ce sentiment était en outre périlleusement accentué par le mystère insondable du garçon, son mutisme quasi provocateur, son pas de félin, son regard qui ne trahissait rien de ses pensées.
M. Tricochet se prit d'un intérêt animalement haineux pour Samba. Il le surveilla, se mit à le réprimander pour un oui pour un non, pour une feuille qui avait traîné dans le jardin, à le tabasser pour une assiette mal essuyée, pour une fourchette mal placée sur la table.
Madame approuvait, insultait, donnait des coups de pied. Le couple, que les vicissitudes des sentiments avaient séparé du lit tiède de l'étage, retrouvait l'union dans une haine absurde mais confortable. Sans aller jusqu'à la réconciliation des corps, ils se refirent une complicité. Ils parlaient de plus en plus, se chuchotaient des mots doux. Ils avaient même recommencé à passer à table ensemble.
Et c'est au cours d'un de ces repas repartagés que les choses se rompirent une fois pour toutes sous l'oeil d'un ciel pourtant serein de joyeux dimanche.
Samba avait servi sans répit une théorie de bons plats. Des apéritifs. Des vins, toutes sortes d'alcoolatures digestives. Après avoir bien mangé et bien bu, ils s'étaient pris par les épaules, avaient échangé des souvenirs, avaient chanté. Le boy avait vécu quelques instants de paix. Ils l'avaient oublié dans leur joie ivre, tout abandonnés qu'ils étaient à la griserie.
Seulement, leur ivresse était tombée au moment où Samba avait entrepris de débarrasser la table. Madame, dans un accès d'allégresse, était allée loin dans la confidence. Elle avait raconté le massage particulier de l'autre soir. Elle avait fourni des détails sur un ton égal et avait ponctué sa sortie par un « c'est rigolo » expressément détaché.
Non, ce n'était pas rigolo du tout pour M. Tricochet qui, du coup, avait dessoûlé et pris un teint de vert terni, s'était mis à entrechoquer les mâchoires comme atteint d'une violente fièvre, avait posé un regard brouillé sur sa compagne, sur Samba et sur le jardin…
Pourtant, c'était encore peu de chose : Madame expliqua que cela n'avait rien de tragique au point où ils en étaient, même si cela s'était passé avec un boy nègre des plus simples ; ce n'était qu'un stupide accident à propos duquel elle ne pouvait préciser si c'était lui qui l'avait violée ou si c'était elle qui l'avait sollicité. Elle ne regrettait rien. Peut-être qu'elle l'avait fait en toute conscience, par curiosité, par masochisme, par défi, elle ne savait pas bien.
Il se passait des choses plus graves que l'acte en tant que tel : depuis lors, elle n'avait pas vu ses règles. Sans goût pour le catastrophisme, elle avait bien peur d'être enceinte. Il ne manquait plus que ça ! Il ne s'agissait donc pas de gémir sur des considérations d'ordre éthique ou moral. Il s'agissait de résoudre un problème urgent, tout ce qu'il y avait de pratique. Puisque, d'évidence, ce négrillon qui respirait peut-être déjà dans son ventre, il lui fallait s'en écurer. Il devait s'imaginer bien sûr combien cela l'écoeurait.
Au-dessus des chagrins et des regrets, un sentiment régnait en elle plus fort que tous les autres : le dégoût. Un dégoût sans nom, intégral. Dégoût d'elle-même, de son corps comme de sa vie. De son ventre, lui parvenait comme une odeur d'oeuf pourri.
Des nausées lui venaient des intestins, s'arrêtaient à mi-chemin, s'éteignaient dans son gosier en hoquets insoutenables. Sa bouche avait une haleine fétide. En fin de compte, ce coup qui leur tombait dessus, tout cruel qu'il fût, pourrait aboutir à un nouveau départ.
De ce nouveau départ, ils parleraient plus tard. Pour l'instant, ce ventre, il s'imposait de le nettoyer, si toutefois ses soupçons se confirmaient, ce qui, d'après son minutieux flair de femme, avait beaucoup de chance de se produire. Il se confirma en effet que, par une de ces espiègleries
dont l'existence garde jalousement le secret, Mme Tricochet était bel et bien enceinte, comme ça, après un stupide massage au bord de la piscine. La femme aux cheveux couleur soleil venue ici du tréfonds du monde comme on sort prendre un peu d'air, enceinte de Samba fils de Hammadi, lui-même fils de Siɓɓe —, au bon gré des lois de la reproduction ! Enceinte, rien que cela !
M. Tricochet arrêta de se gaspiller en inutiles blêmissements, en coûteuses dépressions, en pleurnicheries superflues de trahi et d'humilié. La situation était au-delà de ces émotions snobs et usantes et exigeait au contraire du calme, du sang-froid, de la lucidité.
Sa femme avait raison. Avant tout, ce qu'il fallait, c'était l'aider, la rassurer, la protéger. Il l'aimait. Il l'aimait plus que jamais : la conscience de cet état lui venait comme une révélation. Un bonheur inconnu le submergeait, légèrement tempéré par une vague culpabilité. Il ne s'était pas assez occupé d'elle. Tout était de sa faute : il lui fallait s'amender. Une fois ce délicat problème résolu, il se vouerait à elle, lui donnerait son corps et tout son temps. Ils changeraient de pays ; si elle le voulait, ils rentreraient chez eux. Il avait mis de côté une somme d'argent assez rondelette qui leur permettrait de vivre sans grand-peine. Ils pourraient l'investir et profiter de la vie.
Quant à cet infâme négrillon de Samba, il lui réserverait un sort qui lui ôterait pour de bon ses envies… Il passa commande d'une carabine qu'il se mit à monter et à démonter dans le jardin, qu'il nettoyait en fumant la pipe avec une concentration de professionnel, avec un amour de collectionneur maniaque…
Si la décision de faire avorter sa femme relevait de l'évidence mathématique, le choix de la thérapeutique posait d'insolubles problèmes. Il ne pouvait être question de s'adresser à l'hôpital, aussi bien pour des raisons juridiques que par gêne. Pas plus que de solliciter l'assistance d'un médecin privé : il y avait un risque que le toubib outrepassât les obligations du secret professionnel et se mît à jaser aux bals, au club de pétanque ou au court de tennis ; tous ces lieux où se rencontrait la trop fameuse colonie des Blancs qui s'y racontaient la toux de leurs mômes, médisaient mondainement, dénigraient la négraille et déployaient soigneusement leurs fastueuses lubies tropicales.
Un jour qu'il avait nettoyé sa carabine plus longtemps que d'habitude, M. Tricochet intima à Samba l'ordre de prendre place à côté de lui dans la voiture. Il démarra avec brusquerie et traversa la ville. La voiture caracola sur une piste de brousse bordée de palmiers nains, de palétuviers, de frangipaniers et de raphia. Elle s'arrêta quand la piste commença à se perdre dans la broussaille. M. Tricochet chargea la carabine et parla à Samba comme au cinéma :
— Maintenant, mon petit père, tu vas faire exactement ce que je vais te dire. Tu sais ce que tu as fait, hein ? Ça, au moins, tu ne vas pas l'oublier ? Fier hein, de planter ses cochonneries dans le ventre de Madame ? Huuum ? Tu as raison va, sacrée crapule ! Eh bien, tes cochonneries, faut que tu nous en débarrasses. Tu entends, faut les bouffer tes cochonneries, fais-en un festin de bamboula. Maintenant, écoute bien : tu vas rentrer dans cette forêt et me rapporter ce qu'il faut de pharmacopée pour nettoyer tes saletés. Tu entends ? Écorces, feuilles, racines… je ne sais pas, moi. Y a rien à savoir dans votre pourriture de médecine, sorciers de mes deux ! Seulement, grouille-toi et fais bien les choses. Si tu loupes ta sorcellerie, je vais t'envoyer ça, regarde bien…
Et il désigna le fusil avec une insistance toute pédagogique. Là-dessus, il pointa le canon dans le dos de Samba et tous deux s'engouffrèrent dans l'obscure forêt.
Dans sa cabane, sans lumière et à l'insu des regards profanes, Samba s'employa à élaborer des décoctions, des mixtures, des pommades de graisse animale, des infusions, des breuvages, des inhalations, des bains de pieds pendant que M. Tricochet tenait son arme derrière la porte.
Cela l'occupa sept jours. Cela l'occupa sept nuits… Il soumit Mme Tricochet à un régime draconien avec du fonio cuit au jus de citron pour toute nourriture. Il fit sceller les volets de la cabane, en masqua les interstices avec de la cotonnade teinte en noir, interdit à la femme de voir le jour comme toute autre source de lumière. Il la sortait la nuit et l'entraînait en silence dans une gymnastique farfelue décomposée en gestes lents et incantatoires. Il la dévêtait jusqu'au poil et lui fourrait des potions glauques et visqueuses par tous les orifices, l'enduisait d'oings et de suifs inconnus, lui frottait le ventre, les hanches et les mamelons…
Après quelques jours de cette phénoménale thérapeutique, Mme Tricochet se mit à vomir des glaires, à rendre d'abondantes mucosités par le nez et à expulser du sang par le bas. Elle s'enfiévra et se mit à transpirer. Son corps, son bon corps potelé se mit à fondre comme beurre au soleil. Des verrues et des glomérules lui poussèrent de la tête aux pieds. Ses os affleurèrent à la surface de sa peau ; une peau méconnaissable, toute flétrie, toute brûlée par la fièvre, avec des taches verdâtres qui se propageaient. Ses cheveux blanchirent, chutèrent sous une mystérieuse pelade. Son visage s'émacia et perdit toute forme, rien qu'un front exorbitant sous lequel s'ouvraient profondément des yeux sans vie.
Elle resta lovée dans son lit des semaines et répandit sa part d'eau, de sang, de chyle et de mucus. Elle rendit l'âme au bout d'une longue agonie.
Un éminent médecin venu constater le décès, décréta du haut de sa connaissance que Mme S. Tricochet, née à Saint-Marcelle… et rendue à Dieu en ce jour… avait été victime d'une foudroyante toxine tropicale et que la Miséricorde de Dieu bénisse son âme.
L'enterrement mobilisa toute la colonie blanche de Djimmeyaɓe. Il y eut une prière à la cathédrale, après laquelle, en bonne chrétienne, la défunte reposa au cimetière européen dans une tombe marbrée plantée d'une croix opaline toute neuve…
En une bizarre attitude maternelle, Siɓɓe tenait un enfant albinos hilare qui lui tétait la plaie. Le vieux ne s'asseyait plus au bord du sommier, il restait debout dans un coin de la pièce et scrutait le plafond…
M. Tricochet abattit le chien. Il aspergea Samba du sang du cadavre. Il lui fourra le canon de la carabine dans le cul, lui fit décrire un manège macabre autour des plantes du jardin, lui fit endosser les habits encore imbibés du parfum de sa femme, le coucha dans le lit mortuaire, alluma des cierges et chanta des requiem. Il pleurait entre deux recueillements et lançait au ciel d'émouvantes jérémiades.
Samba devait rester immobile, les yeux clos sous le voile de gaze qui le recouvrait dans le lit, respirer à peine. Un éternuement, un raclement de gorge, un quelconque frôlement et M. Tricochet rapprochait le canon en caressant nerveusement la détente.
Il égorgea le chat, en colla la peau sur le dos du garçon. De la viande, il fit un bouillon que tous deux dégustèrent sur la plage en le saupoudrant de sable blanc…
Il délaissa son travail et abandonna la maison après l'avoir barricadée et jeté les clefs à la mer : il rejoignit Samba dans la cabane, muni de son fusil dont il ne se séparait plus. Quand le sommeil le gagnait, il passait l'arme au garçon et lui commandait de le mettre en joue pendant qu'il dormait. Pour se nourrir, ils se servaient parmi l'abondante faune qui fourmillait dans la cabane : cafards, araignées, puces, cancrelats, poux, punaises. Tant qu'il en avait la force, M. Tricochet morigénait et menaçait :
— Te presse pas, macaque. T'en fais pas, je t'aurai. Ce que je veux, c'est goûter lentement à ta mort. Lentement, tu comprends ? Quand tu m'auras fait le plaisir de crever, je te donnerai un joyeux coup de grâce. En fanfare ! En apothéose ! Pour ponctuer la fin héroïque du chevalier Samba, négrillon qui, parti de rien, n'en posséda pas moins une femme blanche, la femme de son patron, oui, messieurs dames ! J'entends déjà la négraille chanter cela, en jouant sur de grossières vielles, et en tisser quelque barbare légende ! Eh bien, allons pour la légende. Tu veux de la légende, en voilà. Tu l'auras, ta légende. Mais, pour cela, faut que tu crèves d'abord. Progressivement. Atrocement. Par ma volonté. Par mon désir. Pour mon plaisir. Hein, tu me feras ce plaisir, mon beau singe, ma douce répugnance, mon horreur à moi.
Et il chantait « mon beau singe… ma douce répugnance… mon horreur à moi… » d'une voix caverneuse et vibrante qui demandait un effort soutenu à tout son corps…
Le petit albinos avait démesurément grossi sans augmenter sa taille d'un pouce. Il tétait la plaie d'une façon encore plus goulue qu'auparavant. Siɓɓe faisait tour à tour un pied de nez à Samba et à M. Tricochet avant de disparaître par le toit…
Ce siège extravagant dura sept jours et sept nuits. Sans doute durerait-il encore aujourd'hui si, un soir, de la maison, des bruits douteux n'avaient interrompu le délirant monologue de M. Tricochet. Le patron et son otage de boy se précipitèrent dehors et se retrouvèrent nez à nez avec une bande de cambrioleurs qui avaient forcé la porte et qui se démenaient à charger de l'argent, des bijoux, des vêtements dans des valises. Les brigands sortirent des couteaux et, pour la première fois, M. Tricochet usa de son arme, cette même arme initialement vouée à fermer pour de bon le regard ténébreux de Cousin Samba. Un homme tomba raide mort. Puis ce fut un furtif instant de course, de cris et de sifflements…
Le commissaire de police, le médecin et le prêtre arrivés sur le tard devisèrent à voix basse et froncèrent les sourcils, ahuris devant le spectacle qu'ils trouvèrent dans la maison Tricochet : l'inénarrable désordre qui donnait au lieu un air de sordide capharnaüm, les meubles à la renverse et couverts de poussière, le lit mortuaire de Madame resté. intact, avec les drap crasseux de sang, de morve et de pus séchés, les robinets du lavabo ouverts, l'eau qui était montée à l'étage, les peaux du chat et du chien, les éclaboussures de sang sur les murs, les débris de cancrelats dans la cabane, les mottes de défécation, les traînées de pisse sous le sommier…
Ainsi fut dénoué le passionnel conflit de M. Tricochet et de son boy. Il arrive toujours un moment où le carrefour du destin sépare les voyageurs, indifféremment des sentiments et des rapports qu'ils se seront mutuellement portés pendant la traversée…
M. Tricochet dans l'ambulance, se débattant entre les mains d'escogriffes en blouse blanche en hurlant comme s'il avait toujours été un possédé…
Samba dans le panier à salade, le visage comme une tache insignifiante derrière le grillage ocre… Il reverra pour la dernière fois son patron, bien plus tard, au port, un jour que la Providence lui aura octroyé une journée de manutention raisonnablement payée : M. Tricochet résistait comme un cheval rétif et refusait de monter dans le bateau. Il vociférait comme un démon en furie et faisait de grands gestes en direction de la falaise où l'on voyait les tombes grises et leurs croix multicolores. Entraîné jusqu'à la passerelle, il se mit à chanter : « Mon beau singe… ma douce répugnance… mon horreur à moi… »
***
Oumou-Tiaga ne posa aucune question, n'émit aucun signe de curiosité. En fait, elle était déjà au courant. Tous les Bas-Fonds étaient au courant. L'histoire de Samba était sur toutes les langues. La négraille se la racontait fébrilement, rehaussait les moments ordinaires et pimentait les péripéties les plus fades. Pauvre M. Tricochet ! Il n'aurait jamais pensé si bien dire en parlant de légende. Oui, Samba avait bel et bien eu sa légende. Sans cela, qui sait ce que serait devenu l'obscur fils de Hammadi, lui-même fils de Siɓɓe?
Au coup de feu de M. Tricochet, les cambrioleurs s'étaient enfuis, abandonnant leur complice que la balle avait touché. Ils avaient semé les cars de police en empruntant des sentiers resserrés et zigzagants, impraticables même par des véhicules de petit gabarit. Des itinéraires souterrains et inconnus de la ville leur avaient permis de gagner les Bas-Fonds en toute tranquillité. Autant dire que des poissons égarés avaient rejoint la mer. Car les Bas-Fonds étaient aussi inconnus des habitants du centre-ville qu'un minuscule atoll du Pacifique. La police elle-même se hasardait rarement à y pénétrer. Un uniforme aux Bas-Fonds, c'était une provocation, une outrecuidance, une source d'émeutes. Ces mornes bidonvilles peuplés de petites gens égoïstes et débrouillards se marchant joyeusement sur les pieds, se volant et se torturant mutuellement font immanquablement front devant l'étranger. Et l'étranger, c'était avant tout le centre-ville communément appelé En-Haut. En-Haut, l'impossible désir, le vaniteux vis-à-vis, l'inséparable antinomie.
Être noir ou blanc n'avait plus grande importance du moment que l'on venait d'En-Haut : les Bas-Fonds se sentaient agressés et sortaient leurs meutes de voyous et de femmes bagarreuses si promptes à retrousser le pagne et à s'armer de pilons ; leurs rues s'emplissaient bruyamment et tentaient de déborder du côté d'En-Haut. Une ondée de haine. Un déferlement d'invectives outrées. A se demander ce qui pouvait les rendre aussi jaloux de leurs sordides ruelles, de leurs caniveaux putrescents, de leurs habitations lépreuses percées de souillards nauséabonds et de leurs innommables latrines. Le plus tordu des fils des Bas-Fonds était assuré d'être protégé devant une menace extérieure.
Peu importait l'acte dont on s'était rendu coupable. Une complicité sacrée y unissait les hommes et cimentait les masures. On était des Bas-Fonds tant qu'on y souscrivait religieusement. Y déroger revenait à s'exposer à une mort certaine et vindicative. Les rescapés de chez M. Tricochet
s'étaient donc consciencieusement acquittés de leur devoir : informer les autres de ce qui s'était passé. Sur les injonctions
alarmées d'Oumou-Tiaga, tout le monde se mit à la recherche de Cousin Samba.
Naturellement, on songea vite à l'éventualité d'un emprisonnement. Il était si courant qu'on emprisonnât un ressortissant des Bas-Fonds égaré du ghetto ! Un détenu que l'on venait d'élargir confirma les soupçons : Samba était bel et bien incarcéré à la Prison centrale. On l'avait jeté dans une cellule et, depuis, on l'avait oublié : ni inculpation formelle ni jugement.
Alors, une nuit, le peuple des Bas-Fonds envahit En-Haut, défonça les portes de la prison et rendit Samba à l'air insouciant de la liberté. En vérité, les choses ne se passèrent pas aussi simplement. Depuis quelque temps déjà, des papiers insolites circulaient dans les Bas-Fonds, des papiers jaune sale et racornis, maladroitement imprimés, que les enfants scolarisés lisaient à leurs parents analphabètes à la lueur des lampes tempête. Ils étaient signés d'un « P.I. » inconnu.
Ce sigle qui prétendait signifier le Parti de l'Indépendance ne demandait rien de moins que le renvoi des Blancs à leurs neiges fumantes et l'instauration pour la négraille d'une république comme une autre, sans colon, sans fouet, sans emprisonnement arbitraire ; une république de tout son long couchée dans le lit de la justice, sans En-Haut ni En-Bas.
Dans l'ensemble, ces papiers avaient semé le trouble ; une sorte de honte embarrassée s'était emparée des taudis de Touguiyé, de Chauve-Souris et de Pique-Nez. Seuls quelques désoeuvrés montraient de la passion et fermaient des poings qui se voulaient rageurs et qui n'étaient que ridicules. Les moins malins demandaient ingénument ce qu'était l'Indépendance.
Les autres se prenaient la tête, comme saisis d'atroces migraines, et maugréaient contre les trublions qui dérangeaient la vie avec de tels problèmes ou bien ils houspillaient furieusement l'idée de l'Indépendance.
Mawɗo-Marsail, un ancien tirailleur, était sans doute le plus engagé dans le dernier camp. On l'appelait ainsi parce
que, au cabaret, il disait inlassablement :
— Regardez-moi bien. Tout simple que je paraisse, eh bien, tout simple, j'ai vu Borodo et Marsail et pas par l'oreille mais de mes deux yeux.
Depuis l'apparition du P.I. et de ses fameux bouts de papier, Mawɗo-Marsail ne tenait plus en place. Il déambulait de cabaret en cabaret, lançait son chapeau en l'air et fustigeait les indépendantistes :
— L'Indépendance ? Moi, je dis que ce n'est pas une mauvaise idée en tant que telle. Là n'est pas le problème et je le dis tout haut. Le problème est qu'il est plus facile de cueillir la lune que d'apercevoir le museau de cet animal. Comment donc un pays qui ne sait pas fabriquer une boîte d'allumettes peut-il s'opposer aux sataniques armes à feu de l'homme blanc ? Et moi, j'aimerais bien les voir ces morpions qui nous l'amèneraient. Allons, ce ne sont que des amuseurs qui feraient mieux de ne pas déranger les honnêtes gens.
Il n'en était pas moins vrai que de nombreux volontaires distribuaient les papiers du P.I. et réussissaient, pour l'instant, à mobiliser les Bas-Fonds sur des revendications plus concrètes. Ainsi le mot d'ordre « Eau courante pour tous » qui produisit une mémorable émeute et fit des morts par centaines ; émeute au cours de laquelle apparurent en public pour la première fois les quatre leaders du P.I. : Nduru-Wembiiɗo, Bandiougou, Sana et Foromo. Quatre natifs des Bas-Fonds et qui en portaient tous les stigmates : des visages émaciés et tragiques, des pantalons de flanelle avachis, des chaussures aux grossières semelles de cuir, maintes fois passées dans les mains du cordonnier du quartier, des silhouettes voûtées, des regards timides, comme coupables, où l'on aurait cherché en vain les dirigeants fougueux de l'Indépendance.
Après des études primaires quasi-herculéennes faites d'efforts et de sacrifices, Nduru-Wembiiɗo avait été promu commis aux PTT ; on l'avait licencié après qu'il eut porté la main sur son chef de service, un Blanc rondouillard qui l'avait traité de bicot. Instituteur, Bandiougou avait été démis de sa fonction pour avoir donné un cours dans une langue du pays. Sana et Foromo étaient plus modestes : le premier était maçon et le second coiffeur, et tous les deux n'avaient jamais vécu hors des Bas-Fonds.
Les quatre nationalistes en herbe — qui forceraient la pitié avec leurs gueules de traîne-misère — seront arrêtés à l'issue de l'émeute. Arrestation tout au profit de leur cause. Car, en dépit de leurs morts et de leurs blessés, les Bas-Fonds brandirent des portraits géants des quatre hommes ainsi devenus héros et déferlèrent à travers la ville. Un mot d'ordre de grève fut lancé. Au bout de sept semaines de poubelles archi-pleines et de jardins non entretenus, la ville d'En-Haut assouplit sa position. Ceux que l'on appelait familièrement « les quatre Béliers inséparables » furent libérés. Mieux, forts de cet acquis, ils firent monter les enchères en bons petits politiciens : leur libération ne suffisait plus. La revendication « Eau courante pour tous » restait actuelle dans toute son expression.
En sus, ils demandaient une réévaluation des plus bas salaires. La grève reprendrait si ces deux points n'étaient pas satisfaits, ce que soutenaient tous les hommes des Bas-Fonds même si tous n'étaient pas acquis à l'idée de l'Indépendance ni aux beaux sourires des quatre Béliers. C'est ainsi que notre quartet, à peine sorti du pestilentiel anonymat de Touguiyé et de Chauve-Souris, devint l'interlocuteur direct du gouverneur lui-même, et non d'un quelconque autre sous-fifre, dans une négociation serrée qui aboutit à la réévaluation des salaires — en vérité, à peine de quoi s'acheter une chique — et à l'engagement de l'Administration de procéder à l'adduction d'eau dans les Bas-Fonds dans un délai technique qui serait ultérieurement étudié.
C'était peu, mais c'était déjà une reconnaissance tacite de l'existence du P.I. par le pouvoir colonial et, pour les quatre Béliers, l'occasion ou jamais de se voir consacrés porte-parole des Bas-Fonds. Une étape initiatique en quelque sorte pour le P.I. et ses hommes qui, doucement, s'accaparaient Leydi-Bondi, mobilisaient ses habitants, organisaient leurs réactions coléreuses et désordonnées, les encourageaient, exorcisaient leurs peurs et leurs sempiternelles hésitations.
Indépendantiste ou pas, on venait voir le P.I. pour une amende, pour un élève chassé de l'école, pour une perte d'emploi, pour une embauche et même pour ses rhumatismes. Les Bas-Fonds, ce ramassis de déracinés, d'orphelins et de frustrés, avaient besoin d'une référence, d'un recours, d'une paternité. Avec le P.I., ils avaient un peu tout cela. A telle enseigne qu'avec les cotisations des rares militants, on fut obligé d'installer une permanence à Touguiyé, permanence au fronton de laquelle fut gravé « PARTI DE L'INDÉPENDANCE » en lettres vermeilles comme pour augurer d'un avenir meilleur. Là, les quatre Béliers inséparables recueillaient les doléances et conseillaient ce qu'il convenait de faire.
Naturellement, c'est là qu'Oumou-Tiaga vint s'épancher quand elle apprit la triste mésaventure de Cousin Samba. Et la permanence déclencha une action de masse qui vint se heurter contre un cordon de policiers devant la Prison centrale, mais qui obtint la libération du petit-fils de Siɓɓe après une échauffourée qui fit des blessés… La foule porta Samba à épaules d'hommes et regagna les Bas-Fonds dans une infernale bousculade au son des pipeaux et des tambourins et au cri de « Vive le P.I.! ». Même, une voix enjouée scanda :
— Vive Cousin Samba !
Et la foule reprit « Vive Cousin Samba !» dans une hilarité générale. Cousin Samba esquissait un sourire contrit, mal dans sa peau trop fraîche de héros, comme un balayeur de théâtre absurdement contraint de jouer le premier rôle…
Pour l'occasion, un meeting fut tenu dans la cour de la permanence. Cousin Samba se planta dans la tribune à côté des quatre Béliers inséparables, les jambes cotonneuses, la bouche stupidement entrouverte et les bras embarrassés. Nduru-Wembiiɗo prononça un discours d'une voix de fausset, son premier discours. Le débit était lent, le ton peu assuré, mais le corps fluet et maladroit qui sentait bon les Bas-Fonds avait emporté la sympathie ; son sourire pourtant pincé, ses dents parfaitement blanches et régulièrement rangées avaient séduit. La parole était calme, mais ferme, directe, chargée de vérité nue reflétant sans fioritures les alentours, leurs torchis, leurs dédales de ruelles malsaines, leurs pompes publiques archaïques et ébranlées autour desquelles se bousculaient des garçons teigneux et des fillettes aux cuisses découvertes.
L'orateur ne manquait pas de bagout, malgré son maintien crispé et son regard évasif. Et Dieu sait si ce jour-là les péquenots des Bas-Fonds burent ses paroles. Et ils continuèrent longtemps à les boire au risque de s'en inonder !…
A la fin de ce discours d'essai — ce discours anodin qui, à sa manière, gagnera pourtant les sphères de l'Histoire —, Bandiougou et Samba firent connaissance. Alors que l'assistance encore abasourdie commençait à s'éparpiller par petits groupes, que Nduru-Wembiiɗo rangeait son porte-voix, et que les quatre Béliers inséparables se débarrassaient de leur mise officielle, Bandiougou s'inclina vers le garçon et le scruta avec l'acuité d'un entomologiste avéré. Une poignée de main suivit. Une poignée qui n'avait pas besoin de se faire énergique, forte de sa simplicité, mais que renforceront plus tard, dans l'ordre chronologique, le pacte de sang, le pacte d'urine et celui de pituite qu'ils scelleront païennement.
Personne ne saura — est-il besoin de tout savoir? — la force souterraine qui les attirera ainsi, les connectera comme deux pôles magnétiques, associera leurs rêves et leurs désillusions dans le chaos bouillonnant qu'il leur restera à vivre.
Car, à partir de ce moment-là, l'apprenti leader sollicité par l'envoûtement politique, le bébé nationaliste qui s'essayait à charger sur ses épaules étiques les frocs et les fracs, les failles et les avatars de son pays dont s'étaient jusqu'ici tant moquées les dents grises de l'Histoire, je dis, Bandiougou ne quittait plus Samba d'une semelle. Il s'était pris d'un intérêt obsessionnel pour l'ombre de Kolisoko, lui, Bélier parmi quatre. L'obscur petit-fils de Siɓɓe attirait le jeune politicien comme un trou magnétique sans fond.
Sitôt libéré de ses longues séances de débats militants. Bandiougou se précipitait chez Oumou-Tiaga et entraînait son ami vers la côte. La jeune femme n'en prenait pas ombrage. Elle exprimait plutôt un contentement non dépourvu de fierté. D'ailleurs, elle n'avait aucune raison de prendre la mouche. Son bonhomme n'était-il pas revenu de sa mésaventure en héros de conte bienheureux ? La compagnie de Bandiougou ne faisait-elle pas qu'avaliser cette fortuite célébrité ? Et puis, flair de femme, elle sentait bien que cela ne déplaisait pas à Samba, même si aucune émotion manifeste ne franchissait la barrière de ses lèvres. C'était au contraire une nouvelle raison de vivre, surtout pour elle qui avait toujours pris la vie à bon compte.
Elle s'occupait comme avant de ses chaudrons et de ses mômes. Comme auparavant, quand les circonstances le permettaient, elle appelait un ou deux hommes et empochait quelques pièces pour la pitance. Ce qui, du reste, s'imposait : depuis son triomphal retour, son homme n'avait pas trouvé de job, hormis une journée de manutention au port, durant laquelle il avait chargé sans trêve des cageots de palmistes et de cire — cette même journée, il aperçut M. Tricochet se faire embarquer.
Et ce n'était pas Bandiougou qui aurait pu leur venir en aide, toutes de bonté et de partage que fussent ses intentions. Comme Nduru-Wembiiɗo, l'ancien instituteur vivait lui-même de subsides venant de Sana et de Foromo essentiellement et, plus rarement, de militants dévoués. C'est alors que vint à Oumou-Tiaga cette pertinente idée de confectionner des galettes d'oeufs et de les faire vendre dans la cour de l'école par sa fille aînée Yabouleh qui se devait maintenant de faire profiter ses sept ans au lieu de trottiner dans la nature. Oumou pouvait ainsi renoncer à ses passes quotidiennes, se consacrer tout à loisir à sa maisonnée et se refaire une dignité.
Parfois, Bandiougou et Samba délaissaient le bord de mer pour aller s'enfermer dans la permanence du P.I. Samba aidait comme il pouvait aux petites tâches de routine du militantisme : il allait chercher l'encre et le papier, participait à la préparation des affiches et des tracts. Il assistait aux débats politiques des quatre Béliers. Son effacement d'ombre ne gênait personne.
Doucement, il apprit à lire et à écrire sous l'oeil exigeant mais compréhensif de Bandiougou, avec les encouragements passionnés de Nduru-Wembiiɗo, de Sana et de Foromo.
Sur proposition de Bandiougou, à l'unisson et afin de concilier les mesquines nécessités du quotidien et les hauteurs de vue de l'Histoire, les quatre Béliers inséparables décidèrent de faire travailler Samba au salon de coiffure de Foromo : il apprendrait un métier pas trop harassant et pourrait du coup continuer à aider à la permanence ; quant à Foromo, il serait plus disponible pour le Parti et pour les responsabilités grandissantes qui lui incombaient.
Le salon de coiffure se tenait dans une impasse de Touguiyé, non loin de l'Égout-à-ciel-ouvert, parmi des échoppes de tailleurs, de bijoutiers, de teinturiers et de gargotiers. Un réduit infesté d'odeurs de brillantine et de relents d'urine provenant du trottoir. Sur sa façade, une grande ardoise annonçait d'une écriture enfantine : “Le Salon Moderne.” Un rapin avait apposé des peintures murales où l'on voyait des têtes, tout ce qu'il y a de moderne, coiffées de différentes coupes.
L'artiste n'avait pas manqué d'indiquer le nom de la coupe sous chaque tête : mode Marlon Brando, mode Bobby, mode zazou, mode coco-taillé, raie Sammy Davis Junior, mode Eddie Constantine. A chaque mode, son prix : de vingt francs pour le coco-taillé à quarante francs pour le Marlon Brando.
La réclame consistait en un slogan qui, malgré l'indication des prix, vous apostrophait d'un « Entrez, c'est pas cher ».
A l'intérieur, étaient disposés des chaises en osier et des tabourets d'oukoumé. Devant une glace murale, sur un support d'isorel, des ciseaux, des brosses, des rasoirs et une panoplie de boîtes, de tubes et de flacons. C'était un lieu journellement achalandé, fréquenté surtout par des jeunes gens qui y venaient davantage pour échanger des cigarettes et lier conversation que pour se refaire une beauté.
Après les quelques semaines d'initiation, Foromo ne travailla plus que le matin. Il consacra ses après-midi à la permanence, laissant le salon aux bons soins de Samba. Le jeune homme ne se débrouillait pas mal, ses coupes étaient même appliquées, on l'eût seulement souhaité plus liant.
Il rapportait le gros de ce qu'il gagnait à Oumou-Tiaga. En y ajoutant les bénéfices fournis par les galettes d'oeufs, ils arrivaient à assurer les deux repas quotidiens auxquels Bandiougou était fréquemment convié. Ils parvinrent même à acheter un trousseau pour Yabouleh et à l'inscrire à l'école quand elle atteignit dix ans ; ce fut au tour de la fille cadette, Kanny, de s'occuper des galettes…
Et la vie suivit son cours, sans lésiner sur ses cruels tours de passe-passe : ses espoirs fugaces, ses péremptoires rappels à l'ordre. Elle emporta les Bas-Fonds dans une mouvance vertigineuse dont la roue ne faisait que s'accélérer…
Yabouleh et Kanny grandissaient au gré des repas frugaux, et au bonheur des mouches, des moustiques, des miasmes des Bas-Fonds…
Le P.I. grandissait aussi. A force de meetings, de tracts et de patience, ses géniteurs, sans trop y croire eux-mêmes, avaient maintenant la quasi-totalité des Bas-Fonds pour eux à tel point que, de Pique-Nez à Chauve-Souris et à Touguiyé, les murs, les fûts et les piliers s'étaient recouverts de graffitis victorieux : « Vive Nduru-Wembiiɗo! », « Olé Bandiougou ! », « Mort aux colons ! », « Allez les Béliers ! » ; que les Béliers eux-mêmes, portés par l'euphorie, avaient formulé ce slogan allégrement repris jusqu'aux villages de la forêt : « Vous l'avez compris, le P.I., c'est le pays ! »
Oumou-Tiaga grossissait au secret du matelas, derrière le rideau… Fort de ses militants et sympathisants désormais nombreux, le P.I. s'employa à conquérir la légalité. En effet, bien que déjà maître des Bas-Fonds, bien que célèbre dans tous les coins du pays, son action se trouvait circonscrite aux bidonvilles de Djimmeyaɓe du fait de son inexistence aux yeux des autorités officielles.
Une gigantesque campagne fut organisée en ce sens ; elle reste encore dans les mémoires tant elle marqua Leydi-Bondi. Point n'est besoin de revenir sur les dessous de cet épisode plein de discours, de slogans, d'affrontements, de chantages, de marchandages et de conciliabules. On se souvient que c'est à cette époque que Bandiougou s'en vint trouver Samba dans le salon de Foromo — il avait les yeux bouffis et le visage grave — et qu'il se confia. Il dit qu'il n'aurait jamais espéré voir les Bas-Fonds arriver à un tel degré de conscience et de mobilisation politiques. Sans fausse modestie, il était fier de compter parmi ceux qui y avaient contribué.
Le P.I. était devenu une force. Aujourd'hui, les choses pouvaient changer du jour au lendemain. Peut-être aurait-il la chance de voir arriver les Nouveaux Temps, ce qu'il rangeait, il n'y avait pas longtemps, dans le casier des chimères.
Pourtant, il s'inquiétait : la nuit dernière, une vive confrontation avait eu lieu entre lui et les trois autres Béliers. Il soupçonnait Ndourou de tirer les ficelles pour lui-même, et il l'avait dit.
Ce qu'il ne comprenait pas, c'était l'attitude des autres. Pourquoi Sana et Foromo, dont il avait pourtant éprouvé de longue date l'honnêteté et le désintérêt, s'étaient-ils conduits ainsi ? Comment n'avaient-ils pas pu voir ce qui était gros comme une montagne : que Nduru-Wembiiɗo se désintéressait de plus en plus des préoccupations communes pour ne s'occuper que de ses ambitions personnelles.
Il abusait de la confiance qu'on lui portait. Il commençait à prendre de grands airs, à hausser le ton et à s'esquiver lors des débats. Et c'était cela qui inquiétait tant Bandiougou. Il savait bien que ce n'était pas le moment de se répandre en mesquines querelles, mais il ne pouvait se départir de l'idée que ces petits détails pourraient produire de nuisibles conséquences. Il espérait seulement que la force qui naissait un peu partout dans le pays ferait contrepoids aux velléités de Nduru-Wembiiɗo.
Ce sont, telles quelles, les paroles qu'il a dites et qu'il nous répéta des années plus tard Chez Ngawlo devant Samba en personne, une fois que l'ombre nous eut enfin rejoints.
Quoi qu'il en fût, pendant que le sens politique se généralisait comme une épidémie, que la créature la plus ordinaire s'éprenait de meetings, de slogans, parlait à tout vent de base et de sommet, de solution et de résolution, de thèse et d'antithèse, la grossesse d'Oumou suivait son processus, affirmant de plus en plus sa féconde ventripotence.
L'événement procurait plus de plaisir à Bandiougou qu'à Samba lui-même. Bandiougou palpait savamment le ventre de la jeune femme en taquinant le futur père :
— Pourquoi donc fais-tu cette tête-là ? Quand il naîtra, nous l'appellerons Hettaare 2. Pourvu qu'ils viennent ensemble. Un enfant qui s'appellera Indépendance ! Veinard !…
***
Le jour où Nduru-Wembiiɗo prit la parole à l'occasion du gigantesque meeting organisé au Marché-du-petit-jour sur le thème « P.I. : reconnaissance immédiate », tout le monde s'accorda à dire que quelque chose avait changé ; que les Bas-Fonds — non plus seulement les Bas-Fonds puisque y assistaient aussi des délégués venus des Plateaux, du Fleuve et de la Forêt — avaient pris un coup de secousse. Que la sommeilleuse périphérie de Djimmeyaɓe commençait à se frotter les yeux et à percevoir sa triste condition.
Il y eut une foule si nombreuse que personne ne se serait amusé à la compter : sur toute l'étendue de la place du Marché, mais aussi dans les hangars, au faîte des arbres environnants et même sur les toits. Des hourras dignes d'une arène de lutte saluèrent l'arrivée des Béliers dans une Citroën 2 CV d'emprunt décapotée.
Un artifice chatoyant de fanions et de banderoles se déploya.

Les griots entonnèrent des chants pathétiques et immémoriaux racontant les heurs et les malheurs du pays, retraçant les épopées et pleurant les défaites. Ils évoquaient Farnyitere et d'autres rois qui lui étaient antérieurs ou contemporains. Leurs chants s'écoulaient, faisaient des méandres, passaient par tous les recoins du passé, jusqu'à arriver au Marché-du-petit-jour, à englober la foule, à mettre en exergue les quatre Béliers, renaissance et prolongement de Fargnitéré. Nduru-Wembiiɗo portait un chapeau melon, un costume prince-de-galles quelque peu élimé et une cravate de soie. Il répondit seul aux ovations, se plaça à une bonne distance en avant de ses acolytes et se mit à haranguer la foule à grands slogans gestuels. L'éclat de son sourire et son élégant costume — élégant malgré son léger avachissement — soutenaient au mieux son discours. Plus d'un observa que son art oratoire s'était amélioré depuis la libération de Samba. Il reculait, s'approchait aisément du micro, soumettait sa voix à des inflexions inouïes, marquait les temps forts par un fléchissement du buste et menaçait le colonialisme du doigt sans perdre sa contenance.
Ce soir-là, dans les cabarets des Bas-Fonds, il ne restait plus que Mawɗo-Marsail pour persister à soutenir des idées contraires à celles du pays et de son chef Nduru-Wembiiɗo.
Car, pour un chef, c'en était bien devenu un.
Les Bas-Fonds l'avaient intronisé. Son verbe avait plu, moins par ce qu'il contenait que par son souille, son style et son insolence. De mémoire de Bas-Fonds, on n'avait pas encore vu pareil Nègre. « Un Bas-Fonds, un vrai de vrai, qui portait cravate mais fustigeait les Blancs ! Il est des nôtres, cela va sans dire ! » disait-on. A quoi Mawɗo-Marsail répliquait :
— Ce gosse est un frimeur. On fera tous les discours qu'on voudra, rien ne fera bouger cette inéveillable négraille qui passerait l'éternité à torcher le cul du Blanc.
Paroles qu'il prononçait avec l'assurance cynique d'un prédicateur de mauvais augure, mais que les faits démentiront sous peu comme le montrera la suite de ce récit…
De groupuscule fragile ayant pour toute arme l'innocence du bébé et la sincérité du bon frère, le P.I. avait pris corps et s'était développé. C'était maintenant une bonne petite bête à cornes qui ne se contentait plus de dénoncer pathétiquement, mais qui avait appris à donner des coups et à en encaisser. Une petite pieuvre qui avait graduellement étendu ses tentacules depuis les Bas-Fonds jusqu'aux recoins du pays. Les Nègres d'En-Haut eux-mêmes n'étaient plus insensibles à son action, cela, malgré leurs petits privilèges sans commune mesure avec la vie des Bas-Fonds. On s'accordait à admettre que, si cette vitalité ne s'était pas manifestée plus tôt, c'était parce que, au départ, le P.I. avait manqué d'un dirigeant, d'un vrai ; que les gens n'étaient pas assez stupides pour suivre quelque chose sans tête ni queue. Il fallait une tête. Et la preuve : depuis que Nduru-Wembiiɗo, en solitaire commandant, avait pris le devant, les militants proliféraient comme des mouches. La trésorerie était bien garnie, de sorte que celui que l'on appelait maintenant pour plus de distinction le Bélier des Béliers n'apparaissait plus aux meetings en 2 CV d'emprunt, mais en Traction-avant officielle battant fanion du P.I.
Debout dans le véhicule, il saluait la foule avec un mouchoir aussi blanc que son sourire offert sans parcimonie aux ovations, tandis que ses trois compères, plus modestement rebaptisés les Compagnons, restaient assis et saluaient en agitant la main. En même temps, les tâches du jeune Parti avaient décuplé alors que l'encadrement faisait cruellement défaut. On recrutait des permanents comme on pouvait pour alphabétiser, organiser les jeunes, les femmes, les travailleurs.
Foromo avait fermé « Le Salon Moderne ». Samba et Oumou avaient rejoint les permanents : Samba à la Jeunesse et Oumou au Mouvement des femmes.
Les autorités coloniales restèrent sourdes à ce tohu-bohu politique qu'elles considérèrent avec une imperturbable bonne conscience comme une frasque de Nègres friands de discours pompeux et de grands gestes qui s'en retourneraient assurément à leur misère tranquille après s'être défoulés un moment. Mais la manifestation qui se produisit plus tard, à la suite du refus catégorique du gouverneur de reconnaître le P.I., n'avait pas l'air d'un défoulement sportif. La négraille qui déferla ce jour-là dans Djimmeyaɓe n'était pas venue seulement pour transpirer et se faire du muscle. Certes, les discours grandiloquents et les gestes ingénument triomphalistes étaient à l'honneur. Mais, au-delà du folklore, de la fatuité des tam-tams et des déhanchements simiesques, il y avait le ressort d'une terre zombie, encore groggy, mal remise de son déterrement, mais qui n'en était pas moins persuadée de ressusciter définitivement et de s'arc-bouter à une vie honorable.
Cette négraille-là n'avait plus peur. Elle toisait gaillardement les hélicoptères qui la survolaient. Elle narguait les policiers, se moquait de leurs fusils et de leurs casques en forme de calebasse, de leurs chéchias difformes et de leurs uniformes de pitres constipés.
Et quand se produisit la charge, elle ne recula pas, ne perdit pas la tête. Elle répondit par un jet de pierres et de cheddites. Oumou-Tiaga, elle non plus, n'avait pas peur. Elle avança en première ligne d'un peloton de femmes au pagne décidé. La future mère marchait en tête, comme traînée par sa grossesse : combattante burlesque et néanmoins respectable. Alors qu'elle marchait d'un pas martial en brandissant une pancarte, un policier la saisit par le bras et lui intima l'ordre de rentrer à la maison.
Elle se débattit et, au dire de certains, proféra des injures, ce qu'on ne saura jamais avec exactitude. On sait en revanche que c'est ce policier-là et pas un autre qui fourra dans son ventre la pointe acérée d'une baïonnette et que c'est à l'endroit même où elle tomba dans la flaque de son sang et dans l'écrabouillure de son foetus que sera aménagée plus tard la fameuse place de l'Indépendance…
Des centaines de manifestants tombèrent avec Oumou-Tiaga.
Le sol de Djimmeyaɓe fut jonché de blessés. La négraille tint quand même, guidée par ses Béliers et surtout par Nduru-Wembiiɗo, le plus Bélier de tous. Il n'y eut de répit que lorsque, après de vaines tractations, les autorités arrêtèrent les responsables présumés de l'émeute. Bandiougou, Foromo, Sana et Samba furent emmenés en prison parmi des centaines d'autres. Nduru-Wembiiɗo parvint à s'échapper à travers les mailles serrées de camaraderie et de complicité que le P.I. avait patiemment tissées.
Les détenus purgèrent cinq années de prison, reclus et coupés du monde dans un cul-de-basse-fosse de l'île de Fotoba où Sana et Foromo trouvèrent la mort dans des circonstances que Bandiougou et Samba préféreront ne pas nous raconter.
A leur libération, les deux rescapés trouvèrent que le ciel avait une autre teinte, que l'air s'était fait euphorisant et que l'eau avait pris un délicieux goût d'ivresse. Sur les visages comme dans les bouches, sur les mâts comme sur les frontons des édifices, sur les Plateaux comme dans la Forêt, partout, elle affichait sa petite gueule de Sainte Vierge… l'Indépendance !
L'Inspection générale de l'Enseignement primaire était sise place de l'Indépendance. Un bâtiment agréable aux murs d'une couleur blanche légèrement embuée. De ses fenêtres, on pouvait voir, érigée au milieu de la place, la statue de bronze de l'héroïne nationale Oumou. L'auteur de l'oeuvre avait donné à la martyre une tête haute et divine avec des yeux de fée, sans oublier de souligner la célèbre grossesse.
Une avenue Oumou débouchait sur la place de même que le boulevard Foromo et la rue Sana. Bandiougou écarquillait les yeux, incrédule. Dans sa tête, le sang battait à retardement. Il n'arrivait pas à se faire à la vitesse à laquelle toutes ces années avaient passé, à laquelle toutes ces nouvelles choses étaient arrivées. Il ne réalisait pas la présence, pourtant évidente, de la transformation.
La statue. Le boulevard Foromo… la rue Sana…
Ses yeux erraient dans son bureau, passaient en revue les différents angles de la pièce, s'attardaient sur le portrait de Nduru-Wembiiɗo accroché au mur. Le Bélier des Béliers avait troqué son costume prince-de-galles contre un royal boubou de leppi émaillé de magnifiques broderies. Il était coiffé d'une toque de velours ovale. Le buste de face, la tête légèrement déviée vers la gauche. Son sourire — son légendaire sourire de douce lumière — magnifiait son maintien
digne et sa prestance de prince mythologique. Bandiougou ne pouvait s'empêcher de luire d'admiration. Et puis, ses yeux restaient sur cette photo avec une fixité de momie tandis que ses pensées vagabondaient, allaient se coltiner avec des souvenirs aigres-doux qui lui semblaient appartenir maintenant au domaine de l'imagination…
Lui revenait en tête cette journée où ils étaient sortis de prison. L'un derrière l'autre, Samba et lui avaient foulé cette vieille terre qu'ils avaient laissée sale de toute la chiotte de l'Histoire et qui, entre-temps, avait pris un petit bain. Les modestes demeures des Bas-Fonds avaient été repeintes. Leurs toits étaient pavoisés de la cocarde nationale.
Partout, des portraits de Nduru-Wembiiɗo. Partout des drapeaux. Partout des balafons. A Djimmeyaɓe même, en cette partie de la ville que l'on appelait En-Haut, surnom que l'un des premiers décrets de la République venait d'interdire, on ne voyait plus que des Noirs. Les rares Blancs, qui étaient restés par tolérance politique ou par sens des affaires, portaient à la poitrine des badges montrant Nduru-Wembiiɗo en médaillon.
Il était parti au palais de l'ancien gouverneur colonial, devenu la présidence de la République pour saluer et féliciter son ancien acolyte, sa nouvelle idole.
NdourouWembîdo l'avait reçu instantanément. Ils s'étaient donné l'accolade. Bandiougou avait essuyé une larme. Bien sûr, ils avaient évoqué les Bas-Fonds, les débuts du P.I., les émeutes et Oumou.
Nduru-Wembiiɗo lui avait raconté comment le P.I. avait obtenu sa reconnaissance un an seulement avant l'Indépendance, comment, après cette reconnaissance, le P.I. avait paralysé le pays par des grèves intermittentes, comment la Métropole avait proposé le référendum et comment les indépendantistes l'avaient emporté à la quasi-unanimité. Il avait de nouveau évoqué Oumou, Foromo, Sana et avait émis cette philosophique sentence :
— C'est ainsi, mon vieux…
Peu de temps après cette entrevue, Bandiougou avait reçu une lettre lui annonçant sa nomination au poste d'inspecteur primaire de Djimmeyaɓe. On lui avait attribué un logement de fonction, un coquet appartement plein de lumière où la brise de la mer entrait facilement, ventilée qu'elle était par les feuilles fasciculées des palmiers et des cocotiers. Il se trouvait au cinquième étage d'un bâtiment sis… avenue Farnyitere.
Il emménagea avec Yabouleh, Kanny et Samba, perpétuant ainsi au coeur de Djimmeyaɓe les liens au goût de vieux vin de Touguiyé et de Chauve-Souris. Indéfectible ami aux Bas-Fonds, silencieux et proche compagnon à la prison, Samba était devenu son planton au bureau. La drôle de famille n'avait pas à se plaindre. Le salaire des deux hommes subvenait largement à ses besoins. Des besoins que, du reste, la vie inexorable des Bas-Fonds avait méthodiquement disciplinés. Au regard du passé, leur nouvelle vie semblait paradisiaque. Les deux petites se réveillaient les premières, préparaient le café, descendaient chercher le pain odorant du matin et faisaient un petit peu de ménage. Après déjeuner, elles prenaient leurs cartables de cuir lisse et luisant et partaient en classe. Yabouleh avait terminé son cycle primaire et fréquentait maintenant le lycée. Kanny suivait le cours de sixième. Leurs établissements se situaient à proximité de l'avenue Farnyitere.
Signe des temps, ces établissements que ne fréquentaient jadis que les blancs-becs et quelques rares négrillons privilégiés ne recevaient plus que les autochtones le plus souvent montés des Bas-Fonds et des villages de brousse. Exigence du nouveau cours de la logique, le lycée Jean-Mermoz et le collège de Bercy avaient été rebaptisés lycée Wango et collège de Bombah pour plus de respect envers les palmiers qui leur donnaient de l'ombre. Sans rien exagérer, la vie valait son pesant d'or.
Le pays tout entier exultait, tournoyait comme une sylphide ballerine, étincelait comme une joyeuse lucie sous la griserie de l'Indépendance. La négraille, encore mal réveillée de sa longue nuit, profitait, insouciante de la liberté inespérée, comme transportée au jardin des délices. Le mot « Indépendance » était dans tous les propos et dans toutes les chansons. Restaurant de l'Indépendance. Night-club Indépendance-Cha-Cha. Boucherie de l'Indépendance.
On se chaussait Indépendance. Les hommes se coiffaient à la mode Indépendance. Les femmes portaient des teemure Indépendance, taillés dans un tissu imprimé où l'on voyait Nduru-Wembiiɗo en tenue de guerrier enfoncer une triomphale sagaie dans la gueule du dragon colonial.

Et malheur à vous si vous avanciez quelque parole déplacée, si vous commettiez quelque acte inacceptable, vous vous faisiez immanquablement traiter de colonisé. Du dernier étage des immeubles libérés par les colons, on crachait sur la chaussée en l'honneur de l'Indépendance et on faisait des pieds de nez vindicatifs au colonialisme.
Nduru-Wembiiɗo faisait de fréquentes apparitions dans une interminable procession de torpédos escortées par des Harley-Davidson. A l'ouïe des sirènes, les gens formaient spontanément une haie enthousiaste le long du passage du
cortège et chantaient la chanson du Bélier. Il prenait aussi souvent la parole au stade du Premier-Avril, nouvel édifice gracieusement offert par un des nombreux pays étrangers qui avaient soutenu l'Indépendance et lui avaient proposé leur aide au nom de la sacro-sainte amitié entre les peuples et de l'attendrissante fraternité des nations, les pauvres petites !
Là, le Bélier des Béliers, devenu le Leader-Bien-Aimé, s'enorgueillissait de l'Indépendance, déclamait de longs poèmes en son honneur, hurlait contre la colonisation et contre toutes sortes d'ennemis intérieurs et extérieurs que la marche historique du peuple écraserait forcément tel un rouleau compresseur. Sur les gradins, le peuple se levait, applaudissait à tout rompre et entonnait la chanson du Bélier en un chorus de peuple élu. Je dis que ce fut une vie toute de fanfare et de beauté…
Son travail passionnait Bandiougou, quoiqu'il fût absorbant, harassant et même décourageant par certains de ses aspects. Des services de la nouvelle République, l'enseignement était le plus délicat.
Soucieux de former des cadres autochtones au compte-gouttes, et pour des besoins subalternes, l'Etat colonial avait laissé peu d'écoles. Les instituteurs étaient rares alors que pullulaient les enfants en âge d'être scolarisés. Forts de ces nouveaux droits apportés par l'Indépendance, les parents voyaient d'un très mauvais oeil les tris qu'il était nécessaire d'opérer. Tout cela posait des problèmes que seuls la patience, la lucidité, le sens du sacrifice et un solide goût pour le travail pouvaient résoudre.
Il arrivait souvent à l'inspecteur de sortir tard du bureau, de sauter un repas ou de partager en vitesse un sandwich avec son inséparable planton. Il se déplaçait souvent pour inaugurer une nouvelle école aux Bas-Fonds, pour contrôler des instituteurs et rencontrer des parents d'élèves. Il voyait peu d'amis et avait peu de loisirs. Tout au plus se joignait-il aux haies d'honneur quand le passage de Nduru-Wembiiɗo le surprenait dans une rue.
A mesure que l'homme s'éloignait de lui, emporté par son destin historique, il fascinait Bandiougou, lui communiquait il ne savait quelle mystérieuse raison de vivre et d'espérer, quelque inflexible sentiment de fierté et de confiance en soi. De vieux souvenirs l'assaillaient qu'il chassait en secouant la tête et il regagnait son bureau avec un enthousiasme de gamin récompensé.
Les deux vieux compagnons ne se voyaient plus guère.
Même sans les contraintes de son travail, Bandiougou se serait senti gêné de déranger son ancien collègue avec des salamalecs superflus et une menuaille de souvenirs communs sans rapport avec les nouvelles tâches du leader. « C'est maintenant que tout commence. Chacun à son poste et tout ira pour le mieux », se disait-il.
Et tout alla pour le mieux jusqu'au jour où le lycée Wango commença à s'agiter…
Si ma mémoire est fidèle, cela se passa vers cette époque où le Leader-Bien-Aimé subit son premier chahut public au stade du Premier-Avril. Pendant un de ses nombreux et tonitruants discours, des voix dissidentes s'étaient fait entendre :
— Y en a marre des discours ! Nous voulons des actes : Des actes !
Le Leader-Bien-Aimé avait interrompu son allocution et était reparti dans son infernal cortège.
Effectivement, sans le dire, tout le monde le sentait bien, le malaise s'insinuait, les choses se gâtaient doucement. Progressivement, les marchés s'étaient appauvris. Le prix du riz avait atteint des proportions inquiétantes, frappant en premier lieu et paradoxalement les Bas-Fonds qui attendaient tout d'une indépendance pour laquelle ils avaient tant sué.
Peu de chose avait été construit depuis cette date historique du 1er avril. Le rare héritage colonial commençait à se délabrer faute de soins : les édifices publics, les rues, les installations électriques, les canalisations d'eau, les égouts, etc. Comme grignotée par une armée de termites, Djimmeyaɓe s'effritait ostensiblement…
La négraille effarée se remit à se gratter la tête et reprit sa mine serrée d'obscurs soucis, laissant néanmoins un sursis tacite aux événements, mettant tout et à juste raison sur le compte de la jeunesse de la République et de l'inexpérience de son Leader-Bien-Aimé : « Ce qu'il faut, c'est lui donner le temps. On ne bâtit pas un pays en un temps deux mouvements », affirmaient même les moins indulgents pour le sourire du Leader-Bien-Aimé.
Leader-Bien-Aimé et de mieux en mieux nourri que l'on continuait à acclamer dans les meetings aux allures de fête païenne comme si de rien n'était…
Or donc, les écoles connaissaient la même situation, sinon pire. Peu de locaux pour recevoir les internes. Restauration défectueuse. Dans certains établissements, il manquait même des tables et des chaises. Pour toutes ces raisons et pour d'autres inavouées selon certains, les élèves du lycée Wango déclenchèrent une série de grèves qui bénéficièrent d'un soutien massif des enseignants.
Depuis l'Indépendance, le salaire de ces derniers n'avait pas été revalorisé;. Pis : ils étaient payés irrégulièrement, devant parfois attendre trois ou quatre mois avant de percevoir leur salaire.
Un comité intersyndical proclama une grève générale dans tout le pays accompagnée de manifestations de rues pour demander un internat décent pour les uns et une augmentation de salaire pour les autres. La radio nationale dira qu'il demandait aussi la démission de Nduru-Wembiiɗo, l'abrogation de l'Indépendance et la réhabilitation du colonialisme. Comme beaucoup d'autres, ce point sera commenté et fera des partisans et des contre-partisans avec force démissions et maintes scissions dans un camp comme dans l'autre…
Un tract violent fut diffusé, tract appelant à une manifestation et au bas duquel figuraient les signatures des deux syndicats et d'un certain nombre de personnalités dont Bandiougou lui-même. Nduru-Wembiiɗo fit convoquer son ancien compagnon et le reçut au palais avec la même simplicité et la même spontanéité que la première fois. Il lui offrit du thé maure et des gâteaux de miel. Après une conversation sans formalisme sur leur passé, il évoqua le fameux tract :
— C'est bien toi, ce Bandiougou qui a signé avec les enseignants ?
— N'oublie pas que je suis enseignant moi-même et que tout ce qui touche à la profession me va droit au coeur.
— Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je respecte tes opinions. Je les respecte d'autant plus que je les connais bien. Et puis la Constitution protège le droit d'opinion et même le droit de grève. Au fait, et les petites de Oumou ?
— Je les ai avec moi.
— Et ce jeune homme qui ne dit jamais mot ?
— Samba ?
— Celui-là même.
— Nous vivons tous ensemble.
— Ça va?
— Y a pas de quoi se plaindre.
Il raccompagna Bandiougou jusqu'au perron en le prenant par l'épaule et en badinant comme au bon vieux temps. Il lui donna une chaleureuse accolade et lui dit :
— Au revoir, frère, en le regardant de ses yeux clairs et veloutés.
***
Un bataillon de militaires parés au combat cueillit la manifestation. La fusillade commença place de l'Indépendance, le lieu même que la foule avait choisi comme point de ralliement. Les blessés furent pourchassés et achevés jusque dans l'enceinte des établissements scolaires. Du sang dans tout le centre de Djimmeyaɓe, à croire que les habitants de la ville s'étaient accordés pour y sacrifier des poulets…
Pendant la fusillade, alors que la ville, saisie d'effroi, se terrait comme elle pouvait, des policiers passèrent à l'appartement de l'avenue Farnyitere pour embarquer Bandiougou et Samba. Quand tout se sera calmé, la radio nationale nous apprendra comment « ce traître de Bandiougou, très tôt infiltré dans le P.I. pour le compte de la vermine colonialiste, avait tenté un coup d'État en manipulant de jeunes esprits scolaires et des enseignants égarés ».
Toute à sa pernicieuse alchimie de faits et d'événements, l'Histoire, par un de ses sacrés détours, ramena donc nos deux héros à leur prison d'antan, ce même cul-de-basse-fosse de Fotoba qui, à quelque chose malheur étant bon, détenait un mérite devenu rare : de toutes les institutions laissées par la colonisation, elle était la seule à fonctionner correctement. Ce n'était pas à Fotoba qu'on se serait plaint du manque de personnel, les gardes-chiourme y étaient aussi nombreux que les détenus. L'unique bol de riz sakkarba parcimonieusement servi chaque jour ne requérait aucun des mécanismes compliqués et rigoureux de la gestion.
Naturellement, rien n'y demandait à être entretenu : les murs chancis des cellules infestées d'odeurs d'eau de mer, de vase et d'excréments étant dans les normes.
Aux plus intimes de nos fêtes, Chez Ngawlo, Bandiougou et Samba ne reviendront jamais sur les dix ans qu'ils auront passés à Fotoba. Et personne parmi nous n'osera forcer cette
parenthèse muette. Nos curiosités resteront sur leur faim et se contenteront de suppositions, de sous-entendus lancinants.
Nous saurons seulement que c'est à Fotoba qu'ils signèrent leur premier pacte, ce pacte du sang que Bandiougou aimait à nippeler avec une vénération de dévot.
A leur sortie de prison, le pays était devenu méconnaissable. On eût dit que le cordon qui le rattachait à la logique du monde avait craqué, que le bon sens était tombé en désuétude. La vie avait basculé. La terre chancelait comme sous le coup d'un malin vertige. Acculée par les problèmes intérieurs et extérieurs, embourbée dans le marais de ses nombreux blocages psychologiques et technologiques, l'Indépendance avait été prise de folie — en un si jeune âge — et dépensait anarchiquement son menu potentiel. Elle brassait de l'air, hurlait contre le vent, menaçait le ciel de ses poings non affermis et défonçait avec rage des portes ouvertes.
Djimmeyaɓe n'avait plus figure de ville. Ses rues — non plus seulement celles des Bas-Fonds, mais aussi celles du centre-ville que l'on appelait avant l'Indépendance En-Haut avec une tentation mêlée de crainte — ressemblaient à des sillons de labour avec leur gadoue rouge et leurs flaques d'eau bourbeuse. Ses maisons s'étaient lézardées, recouvertes d'une méchante couche de salissure. Ses jardins étaient tombés en friche.
Çà et là, caracolaient de vieilles guimbardes aux pneus pleins de fissures et d'aspérités, des carrosseries si rocambolesques qu'on les eût crues destinées à quelque cirque préhistorique.
Un terrible réveil avait succédé à l'euphorie. La négraille désenchantée coulait un triste regard sur la nouvelle réalité et étouffait à tout bonheur son amertume. Les flûtes et les coras prêtaient comme elles pouvaient leur alacrité aux hommes à un moment où ils en avaient bien besoin.
Les discours de Nduru-Wembiiɗo étaient devenus un rite hebdomadaire auquel tout le monde était impérativement convié. Des colonnes de policiers et de miliciens exhortaient les militants à coups de machette. Les têtes brûlées, qui trouvaient le moyen d'attraper des blessures sous cette vertueuse incitation, étaient tenues de rester conscientes et de retenir l'ensemble du discours faute de quoi ils avouaient explicitement leur opposition au régime et leur soumission à la hyène colonialiste. Des comités de quartier dressaient la liste des absents, et ceux-ci étaient pendus en guise de préliminaire aux meetings ultérieurs.
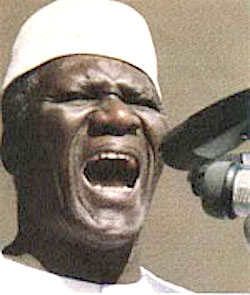
La population de la ville s'entassait donc comme des sardines au stade du Premier-Avril qui, somptueux cadeau d'un peuple ami, ne pouvait contenir tout le monde : des gens mouraient piétinés ou asphyxiés, ou ressortaient du stade avec des membres fracturés et des côtes brisées.
Nduru-Wembiiɗo s'emparait du micro comme d'un fétiche. Il vociférait des slogans introductifs que la foule reprenait sous la surveillance aiguë des miliciens. Au coin de sa bouche perlait une écume de bave. Il levait les bras aux cieux et dénonçait de nombreux complots sataniques : la terre entière se préparait à l'assassiner.
Pour terminer, il partait dans de longues dissertations sur la paléontologie, l'ornithologie, l'héraldique, la topographie, l'histoire de la philosophie et le sport. Il parlait d'espace et de temps, de mnémotechnique. Il persiflait la maïeutique, démontait les mécanismes dangereux du syllogisme, s'en prenait à l'épistémologie et fulminait contre des individus aux noms étranges: Bouddha, le Christ, Soumangourou, Raspoutine, Shango, l'homme de Cro-Magnon, Mahomet, Hegel, Marx, tous comploteurs jusqu'aux os…
C'est donc dans cette atmosphère d'hystérie collective, de théories ratiocinées et d'idéologies artisanales qu'un homme dépenaillé, aux cheveux grisonnants vint buter contre la porte de Chez Ngawlo un soir tumultueux d'abondante bière. Il s'avança jusqu'au milieu de la salle, un ballot de linge sous le bras et dit à la cantonade :
— Je veux manger. Donnez-moi aussi à boire, si vous le voulez bien.
— A mon pire ennemi, je ne saurais refuser du riz et de l'eau, du vin aussi si je peux payer, répondit Ngawlo qui lui fit apporter une calebasse de burakhè 3.
Il mangea et but beaucoup de bière tandis que tout le monde le regardait avec circonspection. Ivre mort, il essaya de tenir debout pour dire quelque chose, mais s'affala front contre sol et vomit abondamment. Bappa Yala, le tailleur, offrit l'hospitalité à celui qui sera pour nous “le Vieux Bandiougou” et que nous nommerons sur un ton mêlé d'estime et de pitié. De ce jour, nous partageâmes sans regarder les menus bonheurs quotidiens, les résignations, les durs réveils de lendemains de cuites et tout ce que nous donna, en son infinie charité, l'écoulement du temps. Nous serons seuls à savoir que cet homme physiquement flétri, négligé de pied en cap, de plus en plus acquis à l'ébriété fut le Bandiougou du P.I. naissant, le héros de Touguiyé et de Chauve-Souris, Bélier parmi quatre. En retrouvant Yabouleh et sa nouvelle vie, il ne s'offusqua point, pas plus qu'il ne laissa percevoir d'émotion en apprenant de la jeune fille la mort accidentelle de Kanny au cours d'une tentative d'avortement.
Après son arrestation, le tournis n'avait pas épargné les deux petites non plus. Sans logis, totalement abandonnées au sort, elles avaient regagné Leydi-Bondi et s'étaient adonnées, faute de mieux, au plus vieux métier du monde. Et c'est dans ce vieux jeu de franchise et d'innocence que Kanny avait pris cette fâcheuse grossesse qui lui avait été indirectement fatale…
Tant qu'elle vécut, Yabouleh s'occupa du linge du Vieux et lui fournit de l'argent de poche, partageant avec lui, en bonne fille des Bas-Fonds, ce que les hommes lui donnaient contre les avantages de son corps chaud.
Les jours heureux, il trouvait lui-même quelques sous en faisant office d'écrivain public dans le hall de la poste.
Le soir, nous nous retrouvions dans l'atmosphère chaotique, mais chaude et fraternelle, de Chez Ngawlo. Et nous buvions au désordre du monde jusqu'aux confins de l'aube avec Bappa Yala, avec Makan, avec Bangus, avec Simiti, avec Mawɗo-Marsail qui ne nomadisait plus de cabaret en cabaret mais qui s'était, comme nous, définitivement fixé Chez Ngawlo.
Moi, je continuais à donner les nouvelles — combien décourageantes ! — contre du gratin et des hardes ; je caressais
aussi mon hoddu les jours où l'alcool avait bon effet. Notre petite vie se passa ainsi sans grand dommage jusqu'à cette fameuse nuit où le Vieux, n'y tenant plus, se mit à nous rebattre les oreilles de cette histoire d'ombre ; cette ombre dont il s'était séparé dans les couloirs de la prison lors de leur seconde libération, ce jeune homme qui lui était fidèle et qu'il n'avait pu retrouver parmi les nombreux détenus, les nombreux gardiens, à travers un impressionnant dédale de couloirs souterrains…
Jusqu'au moment où, par les mailles d'une nuit mal étoilée, Samba s'insinua parmi nous. Nous fêtâmes gaillardement ces retrouvailles, et les deux compagnons scellèrent leur deuxième pacte, le pacte d'urine, en pissant devant nous et à tour de rôle dans un godet qui sera cérémonieusement enveloppé et confié aux bons soins de Bappa-Yala.
Notes
1. Purée de maïs.
2. Hettaare : Indépendance.
3. Plat de riz à base d'huile de palme et de feuilles de manioc.
[ Home | Bibliothèque| BlogGuinée ]
Contact : info@webguine.site
webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2015 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.
Fulbright Scholar. Rockefeller Foundation Fellow. Internet Society Pioneer. Smithsonian Research Associate.