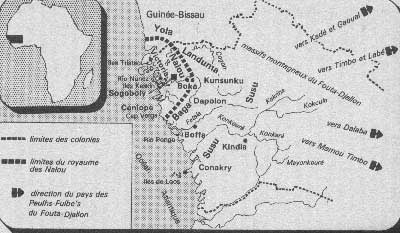
Editions ABC. Paris — Dakar — Abidjan. 95 pages
Collection Grandes Figures Africaines
Direction historique: Ibrahima Baba Kaké.
Agrégé de l'Université
Direction littéraire : François Poli
Français et Anglais sont les plus tenaces. Luttes d'influence, sourdes rivalités, efforts d'implantation au détriment les uns des autres, prises de possession, retraits tactiques, retours en force par surprise, surenchères, c'est un mouvement incessant. Sous prétexte de commerce au prétendu bénéfice des autochtones, des traités sont signés avec ces derniers, tantôt par les uns, tantôt par les autres. Chaque fois quelque clause, bénigne en apparence, affermit l'emprise étrangère, sous prétexte de protection des échanges contre les désordres locaux, contre des chefs jaloux des avantages accordés à tel ou tel. Si le commerce se révèle florissant, c'est à l'occupant le plus actif, le mieux armé, le plus présent que reviendra le droit de conquête. Et comme l'on ne peut être partout à la fois, on se partagera, bien que rivaux, les sphères d'influence. On se concédera réciproquement, mais non sans disputes et tracasseries, les terres à exploiter. Ainsi les Français, après avoir chassé les Hollandais de l'île de Gorée, consolideront-ils, à l'aube du XIXe siècle, leur installation à Saint-Louis du Sénégal. Avec Faidherbe, leur main mise s'appesantira. Le Siné, le Saloum, le Cayor feront, au moins politiquement, leur soumission. De cette base solide la tentation sera grande d'essaimer plus au sud tout le long des côtes, jusqu'au lointain Gabon.
Mais il y a forte concurrence, multiple d'ailleurs. Si Allemands, Hollandais et Belges sont encore des rivaux non négligeables, les plus dangereux — parce que les plus habiles — sont les Anglais. Leur sens du commerce porte ses fruits. Paradoxalement règne à leur endroit un préjugé de crainte, mais aussi de faveur depuis qu'ils ont érigé en règle absolue l'abolition de la traite. Cela leur avait donné l'occasion de manifester leur puissance navale, capitale en ces lieux. Par exemple, il est difficile de leur disputer la Gambie, détestable enclave pour les Français au sein de leurs possessions sénégalaises. De même, pour ces derniers, la lutte en vue de l'hégémonie au Gabon sera dure — à la fois favorisée et retardée par la rouerie bon enfant de Rapontchombo, le célèbre Roi Denis. Celui-ci se complut longtemps à opposer Anglais et Français, se liant d'amitié aussi bien avec les uns qu'avec les autres.
La lutte ne sera pas moins rude pour la France sur les côtes de la future « Guinée française », malgré la proximité des bases de Saint-Louis et de l'île de Gorée. Avant la conquête du Fouta-Diallon, citadelle apparemment imprenable, la région entre ce massif montagneux et la mer, notamment celle du Rio Nunez — depuis longtemps abandonnée des Portugais —, devra en effet être disputée d'abord, ici aux Anglais, là aux Belges agissant en partie pour le compte des Hollandais. Mais le temps viendra où les Français seront enfin pratiquement seuls sur ce territoire. Administrateurs et commerçants tenteront d'y faire la loi. Souvent contrecarrés par les Anglais, ils y parviendront néanmoins, à force d'obstination patience et ruse mêlées — à force de convoitise, en jouant des rivalités entre chefs locaux, qu'ils soient rois ou notables. A force aussi d'intimidation par le mécanisme des traités, qui, misant ouvertement sur la bonne foi, supposée, de part et d'autre, ne feront en définitive que livrer sournoisement à l'arbitraire le plus faible, au bénéfice du plus fort. Tout le monde en effet ne peut s'appeler Rapontchombo (qui signifie : « ce que tu m'as donné ne m'a pas été prêté, mais donné pour de bon »). Pour un Roi Denis qui, au Gabon, a pu se jouer des Français avec duplicité, humour et sympathie, combien de chefs noirs ont été, à terme, dupes des contrats auxquels — trop avides peut-être — ils avaient souscrit!
N'exagérons rien cependant. Avec des fortunes diverses et des tempéraments différents, le Roi Denis a eu de nombreux émules et, souvent, le colonisateur a été pris à son propre piège. Mais il est, hélas ! d'autres cas. Tel celui du dernier chef des Nalous, le roi Dinah Salifou, au Rio Nunez précisément, vers les années 1880.
C'est une assez triste histoire où la duplicité d'un administrateur colonial — que n'a pas désavoué officiellement son gouvernement — efface en partie des gestes de compréhension et de générosité (calculée, il est vrai) que l'on ne peut par ailleurs dénier à la France.
Dinah Salifou, fier guerrier à son heure, n'était certes pas un saint. Ce fut, plus simplement, un homme que sa parenté avec un chef d'ethnie avait fait roi à son tour. Et cela à l'époque où les Français, depuis longtemps déjà présents sur les rives du Rio Nunez, s'efforçaient — selon l'opportunité du moment d'appuyer leur autorité tour à tour sur les Nalous ou sur les Landouman, antagonistes qui peuplaient en amont les bords du fleuve. Dualité plus ou moins heureusement équilibrée, les Anglais, pour leur part, ayant longtemps fait de même. Rivalité entre Européens qui ajoutait à la confusion régnant déjà dans une région aux populations instables, périodiquement en lutte les unes contre les autres.
Mais pour bien situer l'histoire de Dinah Salifou et surtout celle de ses mésaventures, il faut revenir quelque peu en arrière.
On n'ignorait pas au pays nalou, et Dinah Salifou moins que tout autre, combien de péripéties avaient agité le passé récent. C'est — de fait — un véritable imbroglio où il n'est pas facile de discerner une continuité, même incertaine. Un fil d'Ariane permet cependant de s'y retrouver, plus ou moins d'ailleurs : ce sont les traités, signes indéniables de l'appétit des colonisateurs. La France, au premier plan, ne négligeait aucune de ses chances.
Témoin le traité de 1839, signé à Wakrya entre ses représentants d'une part et, d'autre part, le roi des Landouman, Sarah, et l'envoyé de leur suzerain, l'Almamy du Fouta-Djallon, puis le traité de 1842 qui retirait la protection de la France à Sarah pour l'accorder à Lamina, roi des Nalous — enfin celui de 1845, avec les Nalous encore, lesquels à cette occasion acceptaient de faire cesser la vente d'esclaves sur tout leur territoire. Ce dernier traité concédait en échange, tous les ans (pour une durée de cinq années consécutives) à titre de « coutumes », un lot important de fusils (50), de poudre (40 barils), de tabac (100 livres), à quoi s'ajoutaient « 1000 francs en argent et deux pièces de guinée ».
La tranquillité nécessaire au commerce ne dure pas longtemps. En amont du fleuve les Landouman, à la mort du roi Sarah, sèment de nouveau la confusion. La succession du chef oppose ses deux neveux : Tongo, résidant à Wakrya, et Mayoré, habitant Boké. Les commerçants français soutiennent ce dernier, qui, allié aux Nalous, sur leurs conseils, se fait proclamer roi après avoir mis à feu Wakrya, fief de son rival. Sans tarder la riposte a lieu : Boké est assiégée à son tour par Tongo. C'est, durant des mois, une mêlée générale. Pour y mettre fin les Français interviennent avec la goélette Amaranthe. Les Anglais s'en mêlent, venus à bord du Grappler. Et le pouvoir royal passe de Mayoré à Tongo, puis revient à Mayoré, qui signe un traité avec la France, à laquelle il cède un terrain, sur le plateau de Boké. On est encore en 1848.
Un troisième larron survient alors, à bord de la goélette de guerre Louise-Marie, battant pavillon belge, commandée par le lieutenant de vaisseau Van Haverbeke. Celui-ci agit au nom du premier roi des Belges S. M. Léopold.
C'est alors un beau charivari. Le Rio Nunez — de Victoria, au bord de l'Océan, jusqu'à Boké, au pied des montagnes, en passant par Rapass et Wakrya — est sans cesse remonté ou descendu par les bateaux de guerre anglais, par les Français, et par ce Belge nouveau venu. Ils ont donc noms la Louise-Marie, l'Amaranthe, le Grappler, déjà nommés, et encore La Recherche, La Prudente. Bientôt viennent encore le trois-mâts Emma, la Dorade, le brick de guerre Duc de Brabant... Toujours sous couvert de protection du commerce, c'est l'envahissement des Européens, acharnés à se partager un territoire convoité par tous.
Les chefs locaux, Landouman et Nalous, qui possèdent les terres le long du fleuve — les premiers en amont, de Rapass à Boké, les autres en aval jusqu'à l'embouchure (Victoria) —, demeurent cependant, du moins en apparence, les maîtres d'œuvre. En effet Anglais, Français et Belges rivalisent en gages et promesses pour se concilier leurs faveurs.
Etrange époque où les marchés de dupe étaient la règle quasi permanente. On jouait des uns contre les autres, aussi bien d'un côté que de l'autre. Où que l'on se trouve d'ailleurs. Et, à l'intérieur d'un territoire, d'un prétendant contre l'autre.
Voici donc qu'avec les Belges Lamina (à cette époque « chef suprême des Nalous ») s'arrange pour écarter la tutelle des Français. Il signe, en rade de Caniope à bord de la Louise-Marie, un traité fort avantageux (4 mars 1848). Il ne l'était pas moins pour les Belges, évidemment. C'est alors que le commandant de la Louise-Marie veut étendre sa prépondérance au pays landouman, comptant couvrir ainsi la partie haute du Rio Nunez.
Mais là règne Mayoré, que les Français, on l'a vu, se sont concilié, avec concession d'un terrain privilégié à Boké. Mais Mayoré supporte mal l'emprise étrangère. Il s'est révélé un adversaire résolu, malgré les apparences. A tel point que, finalement, Belges et Français vont se liguer contre lui pour encourager Tongo, son rival évincé, à reprendre le pouvoir. Ce qui sera fait, non sans dégâts puisqu'une attaque conjuguée des Belges, des Français et des hommes de Tongo aboutira à la destruction de Boké, totalement incendiée, à la destitution de Mayoré, à un autre traité avec le nouveau roi. Ce traité sera contresigné par le chef des Nalous, Lamina Towel, et ses deux frères: Youra et Carimou. Il reconnaît que le droit au commerce et à une certaine tutelle de protection revient, dans le pays landouman, aux Français , dans le pays nalou, aux Belges. Accord conclu le 5 avril 1849 — plusieurs négociants belges, anglais et français ayant servi de témoins.
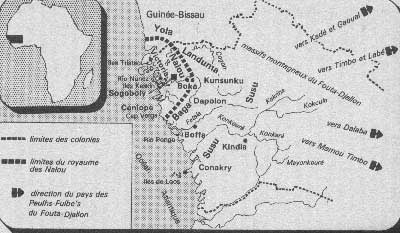
On est encore loin, dans le temps, du règne de Dinah Salifou, grand chef des Nalous. Près de trente années nous en séparent encore. Et combien de péripéties surtout, tout au long du Rio Nunez ! Aussi bien ne pourrait-on guère comprendre la suite de cette histoire si l'on passait sous silence les principaux événements qui la précèdent.
En 1857, les Belges déclarent caducs leurs traités. Se retirant pratiquement de la région, ils laissent la place libre aux Français sur le territoire nalou. Les Anglais continuent bien d'intriguer ici et là, notamment à Victoria, mais sans s'accrocher réellement au terrain, alors que les commerçants français ont poursuivi le développement de leurs exploitations. Ainsi les chances de leur pays se sont accrues. Une plus totale implantation devient possible. Ce qui ne veut pas dire que les difficultés aient disparu comme par enchantement. Loin de là! On ne s'incruste pas sans peine sur une terre qui n'est pas la vôtre. Il faut en payer le prix.
1860. Le colonel Faidherbe est gouverneur du Sénégal. A ce titre cet homme entreprenant vient inspecter les « Rivières du Sud ». Il trouve que les traités conclus avec les chefs du Rio Nunez « sont passés à l'état de lettres mortes ». Dans le rapport qu'il adresse à son ministre, il signale que les négociants de la région « désirent vivement l'occupation de Boké ». Il ajoute aussitôt : « Je suis tout à fait partisan de cette mesure. » Il propose le début de l'année 1861 pour cet établissement « si les affaires du Cayor sont définitivement réglées ». Optimisme prudent. Il écrit néanmoins : « Je pense qu'il faudrait occuper le plateau par une redoute en terre qui aurait une bonne centaine de mètres de côté : parapet pour la fusillade, une pièce de canon dans chacun des bastions, placée de manière à battre tout le terrain environnant. Cette redoute pourrait contenir en cas de troubles toute la population du comptoir, puis une caserne avec une cour entourée de murs formerait le logement de la garnison et le réduit de la redoute. » Voilà qui est clair. Tout est bien prévu : occupation des lieux, mais occupation militaire. On a tout à y gagner. Faidherbe commente en effet sa proposition :
« Un poste à Boké, destiné à permettre aux négociants français d'y avoir de beaux et vastes établissements, attirera davantage le commerce du Fouta-Djallon et luttera contre les Anglais de Sierra Leone et les Portugais de Géba. »
Telle est la conclusion du colonel Faidherbe au terme de son inspection.
C'était, du point de vue français, de bonne politique. Redonner vigueur aux traités par la présence d'un contrôle militaire efficace ne pouvait être, toujours du point de vue de l'occupant, qu'une chose excellente. Faidherbe sut d'ailleurs, à ce moment, parachever son plan en amenant le chef principal nalou d'alors, Youra, à signer pour ses populations le premier traité sérieux avec la France (28 novembre 1865). Youra était reconnu comme seul chef des Nalous et recevait annuellement une coutume de 5.000 francs. L'acte fut signé à Victoria, au nom du gouverneur du Sénégal, par le lieutenant de vaisseau Reguin. Le Castor, aviso de la base de Gorée, était au mouillage dans la rade de Victoria.
Ainsi, de l'embouchure du Rio Nunez jusqu'à Boké, point terminal de sa navigation, l'occupant français marquait des avantages. Deux mois plus tard en effet — le 19 janvier 1866 — le plateau de Boké était investi par les troupes amenées clandestinement par les avisos Le Castor et Le Grand Bassam, la goélette La Fourmi. Trois jours après, le 22 janvier, le même lieutenant Reguin signait un traité avec Douka, le roi des Landouman. La boucle était bouclée.
En vérité cette occupation de Boké, faite sans coup férir, et la construction du poste fortifié entraîneront l'année suivante des affrontements tardifs avec les chefs locaux, aussi bien avec celui de Boké, Dionk, qu'avec le roi Douka lui-même, celui-ci appuyé par une troupe de Foulahs, venus du Fouta-Djallon. Les représailles de l'occupant seront violentes. Un notable landouman et deux chefs foulahs seront fusillés. Dionk et Douka n'échapperont pas à la vindicte : ils seront internés à Gorée durant plusieurs mois.
1874. Les années passent. Mais il y a du nouveau, toujours, sur les bords du Rio Nunez. De retour au pays, Dionk, — le chef de Boké — ne finira pas l'année. Il meurt, de façon curieuse d'ailleurs pour un guerrier. Un soir d'ivresse, il se bat avec une de ses femmes. Celle-ci le mord au doigt. « Le tétanos, rapporte le chroniqueur, a fait le reste... » Le roi Douka, lui, fort assagi malgré les tentations subtiles des Anglais, semble vouloir respecter le traité signé avec la France.
En revanche, au royaume nalou, on enregistre d'importants changements qui voient entrer en scène le jeune chef Dinah Salifou. Lamina Towel, l'ancien, est mort, remplacé à la tête du modeste royaume par Youra, son frère, fort âgé lui-même. L'autre frère, Carimou, est mort aussi, en 1869. Malgré cela Youra, peu sûr de lui, veut consolider son pouvoir. Il réside à Sokoboly, sur la rive gauche du fleuve. Sur l'autre rive, Tam — fils de son frère Carimou — est chef du village de Caniope et de la région alentour. Pour prévenir les velléités de ce rival en puissance, Youra fait envahir ses terres par un autre de ses nombreux neveux, mais le plus habile et le plus fort : Dinah. Il a été éduqué au Fouta-Djallon, dans l'obédience de l'Islam. Son allure est celle d'un vrai prince. C'est aussi un guerrier redoutable.
Il accomplit sa mission sans faiblesse, agissant par surprise, la ruse ne lui étant point étrangère. En cette première occasion, il donne toute sa mesure, à la façon d'un chef de clan, comme il l'a vu faire tant de fois par ses voisins et ses propres parents. Au nom de Youra il prend possession de tout le territoire de son cousin Tam. Incendies et pillages en sont le prix, comme il se doit en ce temps d'incessantes guérillas. Tam fait alors alliance avec un certain Momo Foulah, venu du Sud. Devant la menace de massacres en série, les Français interviennent de toute leur autorité. Sur leurs injonctions, Youra feint de vouloir restituer à Tam ses terres et ses biens. Alors apparaît un nouveau personnage qui fera bientôt beaucoup parler de lui : Bokari. C'est un ancien esclave dont Youra a fait son gendre et le chef du village de Catinou. Il est chargé d'amener Tam et Momo Foulah à une rencontre avec Youra, à Sokoboly. C'est, en réalité, un guet-apens auquel les deux « invités » échappent de justesse. Sur une nouvelle intervention des Français, Tam obtient satisfaction. Succès de courte durée, car ce malheureux meurt peu de temps après (janvier 1876). Aussitôt Youra reprend possession de ses biens.
En fait ces incidents ont mis en lumière ce qui, peu à peu, devient une évidence: Youra est vieux, fatigué, usé, dit-on, par les excès. Il s'est révélé de moins en moins capable d'assurer son rôle de chef. La preuve en est que Dinah et Bokari ont, dans la récente conjoncture, agi à sa place. Les Français s'inquiètent de cette carence. En vertu des pouvoirs qu'ils se sont arrogés, ils vont donc s'entremettre pour provoquer l'abdication de Youra. Hâtive, imprudente décision qui ne manquera pas de mettre, comme l'on dit, le feu aux poudres.
Depuis longtemps déjà, en effet, la vacance du pouvoir au pays nalou était prévisible. Deux hommes s'y préparaient: Dinah Salifou, neveu de Youra, et Bokari, de Catinou, son gendre. En principe, selon les règles coutumières, Dinah ne devait avoir aucune chance. Mais les Nalous ne sont plus tout à fait chez eux. La présence de l'étranger, si l'on obtient son appui, peut inverser les rôles. Dinah l'a bien compris, qui n'a rien négligé pour cela.
Après l'abdication de Youra, les chefs de village et les notables se conforment au droit traditionnel : Bokari est désigné comme successeur légitime. Mais Bokari est suspect d'être plus ou moins inféodé aux Anglais. Les Nalous apprennent donc bientôt que les Français entendent, contre le choix de la coutume, imposer Dinah Salifou. C'est une surprise sans précédent. Bokari semble bien avoir prévu ce qui arrive. Il s'est abouché avec un autre ami des Anglais, Bobo Margaine, le chef de la région de Victoria, toujours quelque peu rétif à l'autorité du roi de Sokoboly.
Aussitôt connu le choix que veulent imposer les Français, les deux alliés réagissent avec la plus grande promptitude. La région est quadrillée par leurs troupes. Tout village soupçonné d'être partisan de Dinah Salifou est pillé et incendié. La rébellion s'étend jusqu'au pays des Landouman, où Bokari trouve aussi des appuis. Inquiet, le chef du poste français de Boké se décide à intervenir encore, mais cette fois militairement. Il enferme le roi des Landouman dans le fortin, puis, à la tête de soldats et armé d'un canon, ce chef de poste (capitaine Lecomte) prête main-forte à Dinah, partout où il le peut, au hasard des rencontres. Il est vrai que tout cela se déroule sur de modestes espaces, à des distances de moins de cent kilomètres.
Quoi qu'il en soit, les antagonistes s'épuisent en vain. Tant et si bien que, pour mettre fin à ces combats sans issue et à une situation qui semble inextricable, les Français décident soudainement de restituer le pouvoir à Youra (traité du 31 décembre 1877). L'envoyé du gouverneur du Sénégal qui est venu appliquer la décision relève de son commandement le capitaine Lecomte, dont les initiatives ont été jugées contraires au règlement. Par ailleurs, sans doute pour ne pas paraître trop illogiques dans leur revirement, les autorités coloniales font en sorte que Bokari soit désigné comme le principal ministre de Youra. Amère constatation pour Dinah Salifou. Lui faudra-t-il attendre la mort de son vieux parent pour reprendre la lutte contre son rival ? Non, car Bokari, de son côté, ayant été une première fois investi du pouvoir royal, n'aura pas davantage la patience de temporiser.
Le voici en effet qui repart à l'attaque à la première occasion. Sans crier gare, il arrive avec ses hommes de Catinou sur les terres de Youra, à Sokoboly. On incendie, on ravage, on capture hommes et femmes jusqu'autour des cases mêmes du roi. Bokari compte livrer un grand nombre des prisonniers à son allié Bobo Margaine pour s'assurer son concours dans la suite des combats. Alerté cependant, Dinah Salifou est arrivé sur les lieux avec ses propres combattants. Son cousin Tocba l'accompagne. C'est un autre fils de Carimou Towel, qui a succédé à Tam comme chef du village de Caniope. Avec leurs troupes, les deux jeunes chefs réussissent enfin à faire reculer puis se retirer les assaillants. Mais la lutte a été terriblement meurtrière et, au soir du dernier combat, c'est un spectacle de désolation à Sokoboly. Les femmes qui avaient réussi à se réfugier dans la brousse reviennent en pressant contre elles leurs bambins. Elles éclatent en sanglots aigus à la vue des cases incendiées et des cadavres qui gisent dans la poussière rouge. Des hommes errent, de-ci de-là, avec des mines sombres. Certains brandissent encore leur sagaie comme pour l'enfoncer dans le corps d'un ennemi. D'autres serrent les poings, lançant des malédictions. Des enfants pleurent de peur et de fatigue.
Le soleil disparaît lentement de l'autre côté du Rio Nunez aux eaux jaunâtres. Pourtant, les braseros ne s'allument pas dans les courettes, derrière les clôtures en nattes de raphia. Personne ne songe à cuire du riz pour le repas du soir. On n'aperçoit nulle part les jeunes filles aux seins fiers allant chercher de l'eau sur les berges du fleuve. Pas une seule vieille ne trottine aux alentours du village à la recherche d'un cabri ou d'une brebis égarés. Oui, la désolation règne à Sokoboly.
Les assaillants ont été repoussés, c'est vrai. Mais à quel prix ! Il y a de nombreux morts. L'ennemi a emmené de jeunes épouses, des adolescentes, détruit la moitié des cases, volé chèvres et moutons. Le pis de tout, peut-être, c'est que Bokari a réussi à s'emparer de Makoumba, la sœur du roi, lorsqu'elle est sortie du palais (tata) pour encourager ses défenseurs. La capture de la vieille femme, contée différemment selon les récits, est une scène dramatique dont la tragique authenticité ne saurait faire de doute. Une complainte, célèbre au pays nalou, l'a transmise jusqu'à nous.
Pour bien comprendre ce chant, triste et poignant, il faut se rappeler que Bokari était un ancien esclave de Youra, que Makoumba, sœur de celui-ci, était la mère de Dinah Salifou, le rival exécré. La complainte, ou cantilène, remémore d'abord longuement les bontés du roi pour son esclave. Puis elle évoque la jalousie de Bokari quand il apprend qu'il devra obéir à Dinah. Il devient alors comme un tigre assoiffé de sang. Envoyant, selon la coutume, les kolas rouges à Sokoboly, il déclare la guerre.
La complainte, avec alternance du soliste et des voix du chœur, se termine ainsi
Soliste
Un jour les gens de Catinou prirent une pirogue
de Sokoboly où se trouvait la vieille Makoumba
et, l'ayant attachée par le cou, la conduisirent à Bokari
qui lui fit ôter son pagne et, quand elle fit nue, l'insulta.Chœur :
Il y a dans Catinou un tigre
et ce tigre est le vieux BokariSoliste :
L'esclave prit entre ses mains les seins de Makoumba
et lui dit : « Tu t'en iras sans ces mamelles qui ont nourri
celui qu'on veut nommer à ma place.
Aussi plate qu'une feuille de bananier,
aussi rouge que la fleur du flamboyant,
tu iras vers celui dont j'aurai un jour la tête. »Chœur :
Il y a dans Catinou un tigre
et ce tigre est le vieux BokariSoliste :
Il dit, et un de ses guerriers abattit d'un coup
de sabre les seins flétris de la vieille Makoumba
qui ne poussa pas un soupir et, sanglante,
s'en alla mourir à Sokoboly.Chœur :
Il y a dans Catinou un tigre
et ce tigre est le vieux chef Bokari
On peut imaginer la scène finale. Le jour s'est levé sur Sokoboly. Au lendemain du désastre chacun tente de secouer l'hébétude qui a succédé à la fureur guerrière. On commence à s'assembler sur là place du village. Dinah est là, avec Tocba, exhortant les hommes qui doivent demeurer prêts à combattre. Les enfants, encore tout tremblants de peur, sont blottis contre leurs mères. Les plus jeunes de celles-ci donnent le sein à leur bébé.
Soudain Dinah se tait. Il regarde vers l'extrémité de la place. Que se passe-t-il donc ? Entre les pans noircis de deux cases une silhouette décharnée vient d'apparaître. Elle avance en titubant et au fur et à mesure, sur son passage, tous reculent avec effroi. Makoumba !
On a du mal à la reconnaître. Dans son visage tuméfié, les yeux sont comme morts. Elle est toute nue. Et pourtant, sur son corps, du sang coagulé ou ruisselant fait comme une tunique rouge et noir. Et l'on voit qu'à la place des seins il n'y a plus que deux plaies béantes. Dans le brouillard de sa vue, elle aperçoit enfin son fils. Elle lui tend les bras. Dinah se précipite vers elle. Makoumba cherche sa main à tâtons, la serre avec le peu de force qui lui reste et parvient à dire :
— Bokari...
Mais la vie l'abandonne. D'une voix tout juste audible, elle dit encore : « Punir... »
Puis elle s'effondre aux pieds de son fils et meurt.
Depuis ce jour Dinah Salifou — on peut le comprendre — ne songera plus qu'à la vengeance, tant il est vrai que la violence engendre la violence. Cependant il lui faudra attendre de longs mois avant que ne soit abattu le vieux tigre. Il sera d'ailleurs partiellement frustré de sa vengeance puisque Bokari sera tué au cours d'un combat. Mais, dans l'instant, plus qu'un règlement de comptes entre hommes, c'est d'abord l'exercice du pouvoir qui est en jeu. Craignant les représailles après son geste cruel, Bokari se terre à Catinou, tandis que son allié Bobo Margaine, lui, affirme son autorité sur le Bas-Nunez, se couvrant du pavillon anglais qui flotte sur la plupart de ses embarcations.
A l'approche de l'année 1880, rien n'est simple dans cette région des Rivières du Sud. Les Français ne savent plus trop à quel saint se vouer — c'est-à-dire qui choisir pour consolider leur propre conquête. Dinah Salifou leur avait paru être une bonne mise. Mais voici qu'en accord avec le vieux roi Youra il appelle à la rescousse, pour faire pièce à Bokari, les Foulahs, qui n'attendent que de telles occasions pour descendre du Fouta-Djalon. Les Français, de leur place forte de Boké, les voient installer leur campement sur le Plateau. Quelques jours plus tard, sommé de s'expliquer sur cette intrusion, Dinah se présente au poste militaire, accompagné de son cousin Tocba, qui est encore son allié.
Ce sera là sa première mésaventure avec les Français. Le commandant de cercle Martin (qui a remplacé le capitaine Lecomte) prend en effet, et sur-le-champ, une grave décision : sans vouloir entendre leurs explications, il procède à l'arrestation de Dinah et de Tocba, lesquels avaient osé venir armés de poignards. Cela n'était pas si surprenant à cette époque et dans une telle région. Mais Dinah — circonstance aggravante — dissimulait en outre, sous son boubou, un revolver chargé. L'officier français ne plaisante pas. Après avoir menacé de les fusiller, il les garde prisonniers jusqu'à leur transfert à Gorée.
Voilà qui est inattendu. Quelle carte vont jouer maintenant les occupants ? Le pays donnera quelque temps l'illusion d'être pacifié. Dinah, le trouble-fête, a été éliminé. Il est interné à Saint-Louis, ainsi que son cousin. Mais il semble bien que l'un comme l'autre aient donné alors au gouverneur du Sénégal des gages tangibles de coopération, jugée de ce fait loyale. En effet, alors qu'un rapport d'inspection au Rio Nunez concluait encore, au milieu de l'année 1879, que le retour de Dinah comportait de grands risques, la décision était prise, à Saint-Louis, de libérer les deux captifs. Mais les gages sont sérieux puisque chacun d'eux a proposé de faire venir à sa place, en otage et comme garantie de sa bonne foi, un de ses fils. L'échange étant opéré, les deux chefs rentrent au Rio Nunez en octobre de cette même année 1879. Leur exil aura duré un peu plus d'un an.
Avec ce retour, le jeu de « pile ou face » va recommencer. Politique et commerce — du côté des étrangers — sont les éléments du jeu. Par exemple, si les négociants anglais traitent avec Bokari, aussitôt les Français, politiquement, jouent sur Dinah, qui lui, en effet, préfère traiter avec leurs commerçants. Si donc, d'un côté, on joue pile sur tel chef, de l'autre on joue face sur son rival, en espérant bien gagner. La suite des événements va se dérouler selon ces règles.
Fort des gages donnés aux Français, conscient de la hantise que ces derniers ont de l'influence anglaise, Dinah, dès son retour, se met en campagne. Tocba l'assiste toujours. Le vieux roi Youra, encore régnant, laisse faire. On revient pratiquement en arrière, exactement comme s'il ne s'était rien passé : Bokari et Margaine dans un camp, Dinah et Tocba dans l'autre. Pillages de factoreries et de navires marchands, razzias dans les villages adverses, tout recommence donc, y compris, du côté de Dinah, l'appel aux Foulahs. Mais, cette fois, les Français ne s'y opposent pas , tout est bon pour neutraliser l'ami des commerçants anglais, Bokari.
On arrive ainsi en décembre 1883.
Pour Dinah Salifou les choses ne vont pas si mal. Ayant misé sur lui, les Français le laissent agir, se disant que plus leur « protégé » se rendra maître de la situation et plus il pourra, succédant bientôt à Youra, concéder à la France terrains et privilèges en échange de son alliance protectrice. C'est, de la part de l'occupant, un risque calculé. Encore faut-il que certaines limites ne soient pas franchies à l'encontre du camp adverse, sinon prudemment et progressivement.
Pourtant, en cette fin de 1883, le point de rupture semble bien devoir être atteint. Enhardi par la tolérance de l'autorité coloniale devant les raids de ses partisans à travers le pays et considérant sans doute que les Nalous sont toujours maîtres de leur destin, Dinah trouve l'occasion de frapper un grand coup : l'élimination de Bobo Margaine, l'allié de Bokari. La présence du chef du Bas-Nunez a été signalée au village de Bel-Air, à quelques lieues à peine en amont de Sokoboly, sur l'autre rive. C'est, en réalité, une visite pacifique. Ses piroguiers ont raconté que leur chef venait au comptoir de Bel-Air, réputé pour ses belles marchandises, acheter des pagnes pour ses filles, la cérémonie de leur excision étant proche. Ses emplettes terminées, Bobo Margaine, pour rentrer à Victoria, ne peut que passer devant Sokoboly. Le jour de son retour, 10 décembre, arrivé à la hauteur du village il donne prudemment l'ordre à ses hommes de s'en tenir à l'écart, le plus loin possible, au long de l'autre rivage.
Précaution inutile. Une dizaine d'embarcations font barrage, un peu plus bas. On lui crie d'aborder du côté de Sokoboly. Peut-être a-t-il le temps de gagner l'autre bord ? La pirogue, propulsée avec vigueur, glisse, rapide et légère malgré sa charge. Mais il est trop tard. Plus légères encore, les autres la rejoignent au moment précis où ses occupants sautent à terre. Les flèches clouent au sol les compagnons de Bobo Margaine. Lui-même est frappé à la tête de deux coups de sabre. Maîtrisé alors sans peine, le captif est emmené, après qu'on eut retraversé le fleuve, jusqu'au pays de Youra.
Que s'est-il passé alors ? Il ne semble pas que le vieux roi ait vraiment voulu sa tête. Il aurait tenté d'obtenir sa soumission, mais à des conditions que son prisonnier, sans doute, ne crut pas pouvoir accepter. Son refus devait lui coûter la vie. D'un coup de sabre, bien ajusté cette fois, Dinah lui-même, dit-on, l'aurait décapité.
Les ennemis de Bokari sont allés trop loin. La nouvelle se répand rapidement. Le « tigre » de Catinou ne saurait tarder à réagir. A Sokoboly, tous les hommes valides sont sur le pied de guerre. Le choc risque d'être plus brutal et plus meurtrier que jamais. M. de Beeckman, le nouveau commandant du Nunez, se rend aussitôt à Sokoboly, faisant connaître sa venue dans toute la région. Il pense que sa présence fera hésiter les antagonistes et évitera, ou du moins retardera, les représailles. Constatant sur place l'agressivité des hommes de Dinah, il estime alors que sa seule autorité ne pourra en venir à bout. Il lui faut l'appui des plus hautes instances. Il dépêche donc un message, début janvier, au lieutenant-gouverneur, le Dr Bayol, responsable de tous les territoires des Rivières du Sud, demandant le renfort d'un navire de guerre. Le lieutenant-gouverneur arrive en personne, fin janvier, à bord de l'aviso Le Héron, dans la rade de Victoria.
Entre-temps, de Beeckman s'est employé à préparer l'entrevue qui doit, sinon mettre fin aux conflits, du moins désamorcer la poudrière qui menace de prendre feu à tout instant. Sur l'invitation du lieutenant-gouverneur tout le monde se retrouve à bord du Héron aux derniers jours du mois. Tout le monde, c'est-à-dire les Français d'une part, le roi Youra et les chefs nalous d'autre part, y compris Bokari (Bokar Kotondu).
Le 30 janvier 1884 une convention est signée dont l'article premier est péremptoire : « La paix est faite entre Bokar Kotondu et le roi Youra Towel. » Astucieusement (du moins les Français le croient), des compensations sont offertes à Bokari, qui aurait tort, pense-t-on, de refuser. Mort, Bobo Margaine sert de monnaie d'échange puisque Bokari est chargé de régler sa succession et (art. 2) « continuera à toucher les rentes du bas de la rivière », cela jusqu'à sa propre mort. Il sera par ailleurs (art. 5) « personnellement responsable du maintien de la paix dans le bas Rio Nunez ». Naturellement, au passage, le « Gouvernement de la République française » prend sa dîme en se faisant concéder par Youra (art. 6) « en toute propriété et libre d'impôts » une bande de territoire « entre le marigot de Caniope et celui de Rapass, jusqu'à deux kilomètres des rives du fleuve ». Enfin, on a bien pris garde de ne pas oublier une mention spéciale pour Dinah afin que celui-ci comprenne bien qu'au fond rien n'est changé et que le choix des Français se porte toujours sur lui. C'est l'article 7 de la convention : « Pour assurer la sécurité de la rivière si nécessaire aux transactions commerciales, Dinah est nommé ministre responsable du roi Youra. Il touchera 1200 francs de rente payables à Boké. »
Ont signé, pour les Nalous, notamment et dans cet ordre : Youra, Dinah, Tocba et, en tout dernier, Bokari.
Que voilà des textes mesurés et, juge-t-on, bien pesés! Ils ne représentent cependant que de la diplomatie à la petite semaine. C'est bien là l'expression qui convient le mieux, comme va le démontrer la suite des événements.
Bokari, en effet, ne désarme en aucune manière. Manifestement, le territoire de Catinou et ses droits sur le Bas-Nunez ne lui suffisent pas. La nomination de Dinah comme ministre du roi — charge que lui-même occupait naguère — signifie de toute façon son éviction, le moment venu, comme chef suprême des Nalous. A lui donc de conquérir de haute lutte ce qu'on lui refuse.
Tandis que, circonvenu par lui, Sarah, le roi des Landouman, vient camper au nord de Sokoboly, Bokari prend position au sud. Un mois à peine après la signature de la convention, il passe à l'attaque (6 mars). Après avoir réussi à incendier une partie du village, Sarah et Bokari, l'effet de surprise passé, sont battus à plate couture par Dinah. Et c'est, ensuite, toujours le même scénario : Sarah, encore une fois, reçoit le renfort des Foulahs, tandis que le clan de Youra peut se targuer de l'aide de ses voisins, les Mikiforé.
Dinah, ministre responsable, voudrait bien limiter les pertes et les dégâts. Il a cependant la conscience tranquille par rapport, aux engagements qu'il a pris puisque ce n'est pas lui qui a donné le signal de ce nouvel affrontement. C'est bien ce que le commandant du cercle, M. de Beeckman, affirme au lieutenant-gouverneur. Il lui écrit à propos de Dinah : « Il a maintenu sa parole autant que cela lui a été possible. Maintenant il est obligé de se défendre. » C'est d'autant plus vrai qu'en ces moments Dinah voit poindre une autre menace : son cousin Tocba lui paraît moins sûr. Il prend, contre ses avis, des positions dangereuses, multipliant, sans instructions, les incendies et les pillages jusque dans les villages avoisinant le fort de Boké. Plus tard ces soupçons recevront confirmation. Tocba a décidé de faire cavalier seul.
Et pourtant, au sein de cette confusion, l'heure du triomphe approche pour Dinah Salifou.
La situation est toujours dramatique au Rio Nunez. Il n'y a pas un seul village où l'on soit en sécurité. Des bandes armées sillonnent le pays, attaquant par surprise. Les pirogues, sur le fleuve, sont plus souvent chargées de butin après le pillage d'une factorerie que de marchandises provenant d'un commerce régulier. La paralysie des affaires, tout autant que la recrudescence de l'anarchie, provoque le retour du lieutenant-gouverneur au mois de juin. Pour marquer son autorité, le Dr Bayol a fait remonter tout le cours navigable du fleuve à son aviso Le Héron. C'est donc à une portée de canon du fortin de Boké que l'administrateur des Rivières du Sud convoque à son bord, une nouvelle fois, les chefs nalous. Il entend exiger d'eux le respect du traité signé le 30 janvier précédent à Victoria.
En présence des Blancs, la méthode des chefs intéressés ne varie pas. Ils sont d'accord sur tout, jusqu'à ce que les Français s'en aillent. Après, on s'expliquera entre soi. Et on sait ce que s'expliquer veut dire. Aussi, après le départ du lieutenant-gouverneur et l'inévitable reprise des hostilités, le commandant de cercle, M. de Beeckman, semble avoir compris enfin ce mécanisme. Il sait que ce n'est pas avec les seuls tirailleurs de sa garnison qu'il pourra l'enrayer.
1885. Six mois se sont écoulés depuis le dernier semblant d'accord. Celui-ci n'a eu aucune suite. Dans le pays l'insécurité est totale, la confusion absolue. Le seul moyen d'en finir, pense M. de Beeckman, c'est de prendre fait et cause militairement pour l'un des adversaires et lui assurer une victoire définitive. D'où les messages qu'il envoie, courrier après courrier, pour signaler la gravité de la situation et demander la présence permanente d'un navire de guerre sur le fleuve. Le lieutenant-gouverneur a dû être ulcéré en apprenant l'échec de sa dernière intervention car, saisissant l'occasion offerte, il va au-delà de ce qui lui a été demandé. Ce sont en effet deux avisos (Le Héron et L'Ardent), et non un seul, qui, le 27 mars, vont mouiller à Bel-Air. A Bel-Air d'où l'on peut commander, en amont comme en aval, tout le cours du Rio Nunez.
Cette fois, il n'y aura pas de palabres pour de vains accords. Dinah Salifou sera seul dans le secret des opérations qui viennent d'être décidées après une sorte de conseil de guerre entre les officiers, le commandant de cercle et le Dr Bayol. Quel est le raisonnement du lieutenant-gouverneur ? Pour bien tenir en main le pays nalou, il n'y a pas de meilleur moyen que d'être le soutien efficace du chef que l'on souhaite voir exercer le pouvoir. Puisque Bokari n'a donné aucun gage aux Français, il n'y a rien qui permette de revenir sur l'appui promis à Dinah Salifou. C'est pourquoi il convient d'associer ouvertement celui-ci à l'expédition punitive qui va être menée contre les villages inféodés à son rival.
Telles sont les vues du colonisateur. De Victoria à Catinou, il s'agit de réduire à néant l'opposition à Dinah Salifou. On se partage la besogne. L'incendie des villages suspects est décrété. Tirer à vue sur tout ce qui bouge. Ce sont les ordres. Dinah s'est réservé le privilège de détruire Catinou. A l'aide de trois cents guerriers, il épaule l'action des militaires. Bokari, assiégé, sans recours, tente sa dernière ruse, qui est sa dernière chance. Il fait hisser le drapeau français à l'entrée du village. A ce moment, criblé de balles, il s'effondre. C'est alors un grand massacre. Presque tous ses partisans sont exterminés. Puis on lui tranche la tête. Selon la coutume elle est apportée au vieux roi, à Sokoboly, pour attester sa défaite.
Est-ce la fin des tueries ? Pas encore. Les canots des avisos, en aval et en amont de Bel-Air, débarquent des groupes d'assaut : Kassandra, Kabassa, Kabasso, chaque village l'un après l'autre est mis à sac, réduit en cendres. A l'intérieur des terres, Dinah Salifou, pour sa part, en fera brûler une douzaine. Sa fureur s'apaise enfin.
Quelques jours plus tard, quand tout est à peu près rentré dans l'ordre, Dinah — pour sceller son amitié avec les Français, pour renforcer encore son autorité parmi les siens — a l'idée d'une parade spectaculaire. Débarrassé de Bokari, le vieux tigre égorgé, c'est le moment ou jamais de montrer sa supériorité, sa force. Alors, à la tête de plusieurs centaines de guerriers, entouré des chefs de village qui lui ont été fidèles, il organise une marche triomphale jusqu'au plateau de Boké. Là, faisant sonner de la trompe et jouer du balafon — sa troupe improvisant chants de victoire et danses effrénées — il donne une sorte d'aubade, théâtrale à souhait, devant le fort. M. de Beeckman — qu'un messager avait prévenu pour éviter toute confusion — fait tirer sept coups de canon en l'honneur du chef victorieux. Puis, sur une sonnerie de clairon, les portes du fortin s'ouvrent et le commandant de cercle vient saluer gravement Dinah Salifou.
L'allégresse est générale. Chacun ayant, de part et d'autre, atteint son but, tout le monde est pleinement satisfait.
A un autre titre, ce mois d'avril 1885 devait marquer encore une date importante dans l'histoire du Rio Nunez. Au cours du mois en effet, et début mai, sur la pression de Dinah, agissant comme ministre de Youra, les populations bagas, au Bas-Nunez, se ralliaient au chef suprême des Nalous. Or les Bagas, jusqu'alors, avaient échappé à toute influence, d'où qu'elle vienne. Mais les succès de Dinah et sa réputation de justicier inflexible incitaient à la soumission. C'est donc sans trop de peine qu'il amena les chefs bagas à traiter, sous son égide, avec les Français. Ceux-ci, décidément, avaient bien choisi. M. de Beeckman s'entremit en hâte pour la signature des accords. Tour à tour, les chefs de Bakomé, de Bottini, de Katoko, de Monchon, les notables de Taïbé et de Taïdi (grand et petit Talibouche) firent allégeance.
Que tous ces chefs se soient engagés envers la France avec quelque réticence n'empêche pas qu'ils aient, dans le même temps, reconnu le roi des Nalous comme chef légitime. Celui-ci, faisant ainsi — selon l'expression consacrée d'une pierre deux coups —, remportait grâce à Dinah un nouveau et grand succès. Quelques mois plus tôt, il n'aurait même pas pu l'imaginer. Mais, pour le vieux chef, c'est le dernier.
6 juin 1885. Grand deuil à Sokoboly. Les cris des pleureuses retentissent à tous les échos : Youra Towel est mort. Au milieu de la désolation que chacun se doit d'afficher, Dinah se sent au cœur une joie sourde. Son heure est enfin venue.
Il satisfait bien sûr à toutes les exigences du cérémonial qu'impose la disparition d'un chef vénéré. Mais, sans retard, il dépêche message sur message pour informer les chefs de village et recevoir leur obédience, qui va de soi. Dans le même temps il fait connaître aux Français le choix ainsi adopté par les notables et dont personne d'ailleurs ne doutait. Dans son message à M. de Beeckman il estime que, en don de joyeux avènement et pour pouvoir faire honneur à ses hôtes lors de son investiture, un cadeau en argent de la part de la France est tout indiqué. Il suggère la somme de 2.000 francs.
Mais, en cette occasion solennelle, le nouveau roi, tout en marquant sa fidélité à l'égard des engagements qu'il a pris, va tenir à manifester également son indépendance et sa liberté. Il est maintenant le chef suprême des Nalous. Il entend bien être considéré comme tel. Le gouverneur du Sénégal, qui ne demande qu'à voir la souveraineté de Dinah Salifou reconnue par toutes les populations du Rio Nunez, imagine alors de lui apporter en grand apparat la caution de la France.
Le cadeau de 2.000 francs est accordé volontiers. On l'accompagnera d'un « brevet » établissant sans conteste sa qualité de roi. Pour frapper les esprits, l'autorité coloniale, à son tour, prévoit une parade qui devrait se dérouler devant un grand concours de peuple. Le plateau de Boké, dominé par le fortin, demeure le lieu idéal. Tous les chefs de village et les plus grands notables y seront rassemblés, ainsi que tous les commerçants dont les comptoirs sont échelonnés le long du fleuve. Au moment de la remise du brevet, la garnison du fort présentera les armes. Tout est prévu dans le moindre détail : sonneries de clairon, battements de tambour auxquels répondront les tam-tams et les balafons. Comme « clou » de la cérémonie, sept coups de canon seront tirés en l'honneur du roi et le commandant de cercle remettra alors à celui-ci un drapeau « en l'assurant de toute la sympathie du gouvernement français ».
Tout cela est programmé pour la fin du mois d'août. Mais, ô surprise ! Dinah voit les choses différemment. C'est chez lui, à Sokoboly, que la cérémonie doit avoir lieu. Il n'a pas à recevoir son investiture des Français. C'est à eux de venir reconnaître devant tous, là où il gouverne, qu'ils le considèrent bien comme le chef suprême des Nalous. M. de Beeckman se rend à ses raisons. Le 31 août, il arrive à Sokoboly, et c'est lui qui est salué, par son hôte, des sept coups de canon. Ensuite, d'égal à égal, on se congratule. Le commandant apporte, avec le brevet, les félicitations officielles de la France.
Dinah Salifou a donc très bien su renverser les rôles. Certes M. de Beeckman ne manque pas d'allure, mais c'est le nouveau roi qui attire tous les regards. Fils de l'Islam, il est drapé dans son immense boubou blanc, revêtu d'un ample manteau noir aux parements d'or, coiffé de son turban en lamé scintillant sous le soleil. Aux compliments du commandant de cercle il répond dans un français un peu hésitant, mais avec beaucoup de noblesse, reconnaissant les vertus du grand peuple frère et le remerciant de son amitié et de son aide. Enfin Dinah (il s'est renseigné) sait comment il convient de clore la cérémonie. Soudain, à la stupéfaction de tous, retentissent vingt et un coups de canon en l'honneur du gouverneur du Sénégal, représentant de la République française...
Ces jours de gloire ne font pas oublier à Dinah Salifou le nombre toujours grand des envieux, la rancœur certaine de ceux qui, malgré leurs sourires, demeurent ses ennemis. Il y a Tocba, son cousin, qui, le moins hypocrite de tous, cache mal sa jalousie. Il y a les commerçants anglais qui craignent que le nouveau souverain, allié des Français, favorise de plus en plus le négoce de ceux-ci aux dépens du leur.
Enfin les Landouman, à l'hostilité toujours latente, pourraient bien reporter sur lui la menace de toutes les anciennes querelles. De ce côté pourtant il devrait être rassuré puisque — avant la disparition de Youra — leur roi, Mengua Sarah, s'est retrouvé avec lui sur Le Goéland, à Victoria, pour signer un accord d'amitié et de coopération. Ministre de Youra à l'époque, il est maintenant son successeur reconnu, ce qui ne peut que renforcer l'engagement des deux signataires, d'autant que les Français ont approuvé chaleureusement ce contrat.
Mais l'eau calme d'un marigot peut couvrir des dangers redoutables. De même Dinah sait que les apparences pourraient, s'il s'y fiait, le tromper mortellement. Il doit donc poursuivre la politique de force, d'intimidation, qui lui a si bien réussi. Pour lui, le rôle de chef passe par ces exigences. C'est parce que la vieillesse avait amolli sa détermination que Youra s'était laissé déborder. Comment par exemple avait-il pu supporter les intrigues d'un Bokari et, jour après jour, son insubordination ? Vigilance, fermeté, répression s'il le faut, sont les conditions de l'exercice du pouvoir. Telle est sa conviction. S'il en avait eu besoin, la manière forte des Français incendiant les villages rebelles aurait suffi à le conforter dans cette disposition.
Pas une seule fois son comportement, en ces premières années, ne sera en contradiction avec ces principes. Beaucoup en pâtiront qui le verront collecter les impôts sous des formes abusives, souvent violentes, à seule fin de manifester son autorité. N'est-il pas le roi ? C'est encore le temps où le rapt d'esclaves est une possibilité de prélèvement compensatoire. Dinah ne s'en prive pas. La méthode est-elle bonne ? En fait elle lui réussit car, en ce début de règne, il est craint et, extérieurement du moins, respecté.
Méthode dangereuse cependant, car elle crée des précédents. Quelques velléités d'opposition ont été rapidement étouffées, mais tout est loin d'être parfait. La préoccupation la plus sérieuse pour Dinah Salifou demeure l'activité de Tocba, qui gouverne à sa façon son fief de Caniope — c'est-à-dire, en principe, en vassal fidèle, mais saisissant toute occasion d'agrandir son domaine, ne faisant d'ailleurs rien d'autre pour cela qu'appliquer les méthodes de Dinah. Il y a là un risque certain pour l'unité du royaume nalou. Cependant Tocba, avec une habileté consommée, n'a jusqu'alors commis aucune faute répréhensible. Il a pu s'exposer à des réprimandes ; il n'a donné aucune prise à des sanctions répressives. Ou, du moins, Dinah Salifou — prudent lui-même — n'a pas encore jugé bon de mater son cousin détesté.
1888. En France, on prépare la grande Exposition universelle de l'année suivante, celle qui verra s'élever en plein cœur de Paris l'étonnante tour Eiffel, devenue depuis, pour tous les touristes du monde, un signe de ralliement. Cette exposition, parce que dite universelle, étant l'occasion d'un immense rassemblement des amis de la France, doit mettre en valeur toutes les réalisations dont celle-ci s'enorgueillit. Son action coloniale sera donc au palmarès. N'est-elle pas, pour les Français, le signe de leur haute mission civilisatrice ? Les organisateurs, voulant donner à l'exposition la forme le plus originale possible, ont certainement été convaincus que les chaudes couleurs d'Afrique, l'excentricité des costumes, la présence physique des rois ou grands chefs amis de la France donneraient un éclat particulier, inédit, aux réceptions officielles. C'est pourquoi, plus d'un an à l'avance, on a fixé la liste des invités. Dinah Salifou est parmi les élus.
Mais est-ce bien là une décision opportune? La situation, en pays nalou, n'est pas tellement claire. Tocba en effet, dans les palabres, fait beaucoup parler de lui. On rapporte que les relations entre les deux cousins se sont gravement détériorées. Les Français eux-mêmes n'ont guère arrangé les choses. Là comme ailleurs l'autorité coloniale — fidèle à une tactique bien connue — aime faire sentir à son « protégé » les limites de son indépendance. Qu'il soit maître de faire tirer une salve de coups de canon en l'honneur de la République peut satisfaire son amour-propre, mais la réalité est ailleurs. Il faut que le chef suprême des Nalous se rende compte que sa suprématie ne tient qu'à un fil. Tocba, truffé d'ambitions, est apparu comme un bon atout pour obtenir que Dinah fasse montre d'une certaine souplesse et, surtout, soit conscient de sa relative dépendance.
Méthode classique donc : on a donné partiellement satisfaction aux appétits du dangereux cousin. Le colonisateur, selon les prérogatives qu'il s'est attribuées, a usé de son autorité de tutelle pour accroître l'importance de Tocba en le désignant au Bas-Nunez comme chef d'une sous-région, celle de Victoria.
Dinah écrit lettre sur lettre, au gouverneur du Sénégal. On ne peut pas, affirme-t-il, faire confiance à Tocba. Ce n'est pas un bon chef pour une province. Lui, Dinah, se doit de prévenir les Français... La première lettre est du 12 mars 1888, alors que l'on songe déjà à le faire venir à Paris.
« Gloire au Seigneur !
De la part de Mahmadou Dinah, roi des Nalous, au gouverneur du Sénégal
Salutation amicale.
Monsieur,
Je vous remercie de votre aimable missive qui m'a causé une joie inexprimable ( ... ).
Je suis prêt à exécuter les ordres que vous m'avez ordonné de faire sur mon frère Tocba, c'est-à-dire le nommer chef du village de Victoria, malgré qu'il y a dans la famille des personnes bien plus âgées que lui ; mais la confiance que vous avez eue de moi pour me charger de cette nomination me fera remplir avec honneur cette tâche.
Cependant, je tiens à vous faire savoir que depuis quelque temps Tocba prend des haines contre moi, mais moi, je ferai tout mon possible pour lui être agréable. Maintenant, s'il continue toujours à rester dans la mauvaise voie et que je ne peux rien sur lui, je serai obligé de rester neutre.
Je vois, M. le Gouverneur, par ses allures, que mon frère cherche le moyen de me trahir et je sais qu'il a reçu des mauvais conseils envers moi et qu'il cherche à me détrôner, tandis que moi, je n'agirai rien de mal sur lui. Je vous prie de le mettre à l'ordre en lui faisant savoir que je suis son chef. »
Malheureusement les objurgations de Dinah ne changent rien au choix dont son cousin Tocba a été le bénéficiaire. Si, selon la coutume, il l'appelle son frère, cela n'empêche pas celui-ci de dresser sur son chemin, par son comportement outrancier, les plus perfides embûches. Fort de sa nomination à Victoria, ce faux frère, ce frère ennemi, se laisse aller à tous les excès, sans doute pour braver l'autorité du roi et l'affaiblir d'autant.
Alors Dinah intervient de nouveau, en février 1889. Sa protestation, cette fois, se fait véhémente. Voici le texte de sa lettre — brève et impérative — au gouverneur du Sénégal :
« Louange à Dieu...
De la part du roi des Nalous, Dinah Salifou, au gouverneur du Sénégal.
Salut le plus complet.
Monsieur,
Le but de cette missive est de vous apprendre qu'un nommé Tocba a importuné mon territoire par les torts qu'il cause souvent aux pauvres personnes et aux étrangers, qu'il donne parfois la mort. Il est la terreur de tout le monde.
Je vous prie donc, M. le Gouverneur, de nous débarrasser de cet homme qui nous nuit grandement. Par ce moyen, tout mon territoire sera paisible et tranquille. »
Le ton de cette correspondance, plutôt insolite à l'égard du gouverneur, est tout à fait significatif. Dinah estime que son cousin doit être totalement évincé. « Nous débarrasser de cet homme... » On comprend bien qu'il ne s'agit pas là, pour lui, d'une formule creuse. Mais peut-il, dans sa contestation, aller au-delà ? Ne semblerait-il pas douter de la parole des Français au moment même où ceux-ci, l'invitant à l'Exposition universelle, lui donnent un gage éclatant et flatteur de leur considération ? Même si quelque crainte l'habite de voir Tocba profiter de son absence pour pousser ses avantages, il ne peut guère en faire état puisque le gouverneur a déjà trouvé la parade à cet éventuel argument : Dinah ayant toujours fait le plus grand éloge de Sayon, son frère cadet, son homme de confiance, son véritable second, celui-ci est tout désigné pour assurer l'intérim en son absence. Que répondre à cela ? Et comment résister à l'attrait d'être reçu en grande pompe par cette puissante nation qu'est la France ! Un tel geste n'est-il pas, aux yeux de tous, la consécration de sa puissance ? Il partira donc.
Dinah Salifou s'embarque pour l"Exposition Universelle àve Paris.
L'embarquement eut lieu vers la mi-juin. Une traversée en mer, pour qui n'a jamais fait tel voyage, apporte de multiples sensations — depuis un certain effroi devant l'immensité de l'eau qui bouge, jusqu'à cette paix qui envahit l'âme face à cette même immensité lorsque, tous vents tombés, la mer n'est plus qu'un grand miroir immobile sous le soleil.
On voit si bien Dinah durant cette traversée ! C'est tout autre chose que la valse légère des pirogues sur le Rio Nunez. Le puissant navire, dans le bruit sourd de ses machines, avance lentement, mais régulièrement, obstinément, en ligne bien droite. Il ira ainsi jusqu'au terme de sa course. Pas de rives verdoyantes, nul village au loin — simplement parfois, dans la brume de chaleur, une ligne grise, sur la droite : les côtes de l'Afrique, qui s'éloignent et bientôt disparaissent. Appuyé au bastingage Dinah contemple la mer, d'un bleu d'ardoise. Le drapeau tricolore des Français flotte à l'arrière du bateau. De la cheminée trapue une épaisse fumée noire s'échappe et s'étire dans l'air comme une chevelure, aussi noire que celle des filles de son pays.
Son pays ! Il en est maître et responsable depuis déjà de nombreuses lunes. Et voilà qu'il l'a laissé derrière lui... Pour un temps très court, c'est vrai. Mais n'est-ce pas tenter le destin ? Une scène lui revient en mémoire. Il s'en souvient comme si elle avait eu lieu la veille. La saison des pluies venait de commencer. Cette nuit-là, des trombes d'eau s'abattaient avec un bruit assourdissant sur Sokoboly. Rassemblés autour du vieux roi agonisant, lui-même, Tocba et les anciens étaient obligés de se pencher vers lui pour entendre ses dernières paroles à peine murmurées, entrecoupées de râles :
— Dinah, toi le premier-né de Makoumba, je ... t'ai choisi. Tu... as été un bon ministre. Tu seras ... un bon roi.
Les anciens avaient alors promis solennellement
— Nous l'assisterons de notre mieux et lui obéirons.
Seul Tocba était demeuré silencieux et, à la lueur des torches que tenaient les esclaves, Dinah avait surpris sur ses lèvres un sourire à peine esquissé, à la fois méprisant et narquois. Son cousin n'avait pas davantage desserré les dents au cours de la longue veillée funèbre, tandis que retentissaient les plaintes stridentes des pleureuses.
Oui, il se souvenait. Tocba s'était encore tenu à l'écart, avec la même expression maussade, le jour où le conseil des anciens l'avait proclamé roi, lui Dinah, devant les Nalous et les Bagas accourus de tous les villages. Il ne s'était pas non plus déridé lorsque les griots, selon la coutume, avaient chanté les mérites du fils de Makoumba. Plus tard il avait à peine goûté aux viandes succulentes, au riz, aux ignames, aux dattes fraîches et juteuses servis dans la cour du palais. Il avait été le premier à se retirer. Mais avant de partir Tocba s'était approché de lui et, d'une voix sourde, contenue, lui avait dit : « Je ne t'ai pas choisi. Je ne t'ai rien promis... »
Dinah soupire et se met à arpenter le pont. Dans le ciel, des mouettes passent comme des flèches. Il les ignore et se mord les lèvres : il n'a pas oublié les paroles de son cousin. En apparence pourtant il n'a à se plaindre de rien. Aucun deuil de famille, aucun malheur nouveau au cours de ces récentes années. Ses femmes lui ont donné des enfants beaux et vigoureux. Ses troupeaux se sont multipliés et, dans ses champs, ses récoltes sont abondantes. Les affaires avec les Blancs sont fructueuses. Tout cela grâce à la paix relative qui s'est instaurée sur tout le territoire. Mengua Sarah lui-même respecte le traité signé à bord du Goéland. Quant aux chefs de la région, ils jugent plus prudent de se tenir tranquilles puisque le roi bénéficie de l'appui des Français. Et Bokari, le plus redoutable d'entre eux, n'est plus.
C'est vrai que les Français l'estiment. La preuve en est qu'ils le convient à Paris pour leur grande exposition. D'ailleurs, M. le Gouverneur du Sénégal ne manque pas de se rendre chez lui lorsqu'il vient au Rio Nunez. Cependant Dinah préférerait qu'à Boké les commandants de cercle se succèdent moins rapidement. A peine s'est-il habitué à l'un d'eux qu'il repart. C'est même là, aujourd'hui, sa préoccupation principale. Le dernier venu est un certain Dr Lesquendieu. Il n'est pas antipathique et lui donne l'impression d'être plein de bonne volonté. Mais, connaissant mal la situation au Rio Nunez, il semble un peu perdu dans la complexité des rapports entre les chefs de la région. Tocba, profitant de cette circonstance, a intrigué de plus belle. Sa méthode lui a réussi puisque le commandant de cercle ne s'est pas du tout opposé, malgré les avis de Dinah, à ce que le peu recommandable cousin soit désigné comme chef de province, à Victoria. Pourquoi ? Sont-ils de connivence, lui et Tocba, pour quelque obscur dessein ? Toujours est-il que, depuis, l'audace de Tocba a dépassé les bornes. Il s'est emparé de tout ce qui lui plaisait et se gêne de moins en moins pour organiser des razzias sur les terres de ses voisins. Avant ce départ pour la France, ses victimes étaient de plus en plus nombreuses à venir à Sokoboly pour réclamer justice. S'il en a été ainsi, malgré la présence du roi, que va-t-il en être en son absence ? Toléré ainsi par le commandant français, que va pouvoir inventer Tocba ?
Durant toute la traversée, Dinah Salifou, malgré les aurores brillantes, les journées câlines et belles, les soirs aux somptueux crépuscules, garde à l'esprit cette inquiétude. Pourtant les officiers du bord sont pleins de prévenances à son égard. Ses épouses qui l'ont accompagné ne comprennent guère ses silences quand elles rient et battent des mains aux cabrioles du singe apprivoisé, mascotte des matelots.
Enfin apparaissent les côtes de France. On arrive en vue de Bordeaux, très grand port — encombré de navires, aux quais remplis de machines curieuses, wagons, grues, palans — auprès duquel les mouillages de Caniope, de Bel-Air, et même de Victoria paraissent minuscules gazelles à côté d'un éléphant. Les notables de la grande cité maritime se sont rassemblés tout près du débarcadère pour saluer Sa Majesté Dinah Salifou Ier sa famille et sa suite. On fait des discours, on échange présents et accolades devant les journalistes. Dans les rues les badauds applaudissent au passage du roi noir et la fanfare municipale joue en son honneur des marches militaires.
Mais tout cela n'est rien en comparaison de l'accueil que ces voyageurs exotiques reçoivent à Paris. La gare de Lyon disparaît sous les drapeaux et les banderoles. Des personnages chamarrés de galons et de décorations saluent gravement, tandis qu'en leur nom de joyeuses jeunes filles offrent des fleurs aux femmes du roi pour leur souhaiter la bienvenue. De nouveaux discours sont prononcés. Dehors, la foule lance des vivats. Le lendemain et les jours suivants l'enthousiasme des Parisiens ne fait que croître tant l'euphorie est maîtresse en ces heures de fête. Ils ne se lassent pas d'admirer ce roi africain, chaussé de bottines vernies, coiffé d'une calotte de velours noir autour de laquelle s'enroule un turban de soie blanche brodée d'or, enveloppé dans un burnous également noir, couvert de tresses dorées. Ils ont lu dans leurs journaux que c'était un disciple de Mohamed, un musulman. C'est pour cela qu'il est accompagné de plusieurs épouses. Les Parisiens s'attendrissent, les femmes surtout, sur ces jeunes reines aux rires et aux timidités de fillettes. Chacun remarque, à leurs côtés, le fils aîné du roi, Ibrahima, déjà grave et digne bien qu'il ait à peine douze ans. La foule écoute, ébahie, les griots frapper sur leurs balafons et pincer les cordes de leurs korahs.
Les hôtes venus d'Afrique ne sont pas moins émerveillés. Les épouses royales commentent sans fin les toilettes des Européennes. Elles séduisent tout le monde par leur grâce et leur gaieté. Elles apprennent avec une rapidité étonnante à traverser les chaussées sans avoir peur des omnibus à impériale, à effectuer des achats dans les magasins en montrant du doigt ce qu'elles désirent, à se servir d'une fourchette et d'un couteau à la manière des Blancs. Quant à Ibrahima, il se conduit en véritable prince et se montre aimable avec tous, sans jamais se laisser aller à d'inconvenantes familiarités. Il raffole surtout des gardes républicains qui, avec leur casque brillant au long panache noir, figurent dans toutes les cérémonies officielles, caracolant majestueusement sur leurs chevaux.
Pour Dinah, c'est la gloire ! Il se montre à toutes les réceptions, participe à des banquets et, surtout, rencontre les personnages les plus importants, ceux qui donnent des ordres au commandant de cercle du Rio Nunez et même à M. le Gouverneur du Sénégal. Il se promène aussi beaucoup. Tout souci semble l'avoir abandonné, à la grande joie de ses compagnes, quand il admire la prodigieuse tour de métal qui, au bord de la Seine, domine Paris. On dirait, pense-t-il, une girafe jamais vue, plantée là par quelque magicien, comme le sont ces forgerons d'Afrique aux recettes mystérieuses, créant armes et bijoux sans pareils.
Un jour, non retenu par les cérémonies officielles, le gouverneur des Rivières du Sud, présent à Paris lui aussi, vient trouver Dinah Salifou dans les appartements que le gouvernement de la République lui a réservés, pour toute la durée de son séjour, dans un luxueux hôtel de la rive gauche. Après les salutations d'usage, le Dr Bayol passe rapidement à l'objet de sa visite. Dès les premières paroles échangées, son air soucieux alerte le roi des Nalous. Selon le lieutenant-gouverneur, les nouvelles qui lui sont parvenues ne permettent pas de se féliciter de la situation au Rio Nunez. Loin de là ! Bien qu'il s'agisse d'informations plutôt confuses, il semble certain que, ici et là, on pille, on brûle, on massacre. Mais qui ?
— C'est sûrement Tocba, répond aussitôt Dinah. Mon frère Sayon n'a pas dû savoir l'intimider comme il fallait le faire. N'avais-je pas dit qu'on devait l'obliger, par tous les moyens, à se contenter de son rôle de chef sur le seul territoire de Caniope ? Au lieu de cela on lui a confié les terres du Bas-Nunez. Comme si l'expérience avec Bokari n'avait pas suffit. Maintenant Tocba se croit tout permis.
Dinah, pris de fureur, marche de long en large. De temps en temps il injurie et maudit son cousin dans sa langue maternelle. Le gouverneur laisse passer l'orage. Puis, lorsque Dinah, calmé enfin, a repris place en face de lui, il se met à lui parler posément, amicalement, comme ce Français sait le faire quand il veut apaiser et convaincre.
— Vous avez sans doute raison. Mais, pour l'instant, nous n'en avons pas confirmation. Les informations ne se recoupent pas parfaitement. On parle d'une guerre dans le haut du pays et non pas chez les Nalous. Est-ce Tocba le responsable ? Nous n'en savons rien. Si je suis venu aujourd'hui vous voir, c'est pour vous mettre au courant, car il me semble que vous seul pouvez reprendre les choses en main. Je sais que vous vous plaisez beaucoup à Paris. Mais les cérémonies, les réceptions les plus importantes sont terminées...
Dinah Salifou interrompt brutalement son interlocuteur :
— Oui, je me plais ici. Vous autres Français, vous savez flatter quand il le faut ceux qui vous sont utiles. C'est vous qui avez insisté pour que je vienne dans votre capitale. J'ai été tenté, c'est vrai. Mais vous savez parfaitement, je vous l'ai dit, que je voyais là une erreur. Je suis certain que plus tôt je rentrerai là-bas, et mieux ce sera. S'il n'est pas trop tard !
Le Dr Bayol ne peut décemment reconnaître l'erreur dénoncée par son hôte, et dont il s'est rendu coupable. Mais il se dit, en lui-même, qu'une faute a bien été commise. Et tout cela pour satisfaire à des besoins de prestige. De toute façon, Dinah a vu juste: il n'y a pas de temps à perdre. Il enchaîne :
— Je vais donner immédiatement des instructions pour que le premier navire en partance pour le Sénégal vous réserve le passage, pour vous et toute votre suite. En échange, je vous demanderai de me faire savoir dès que possible quelle situation vous aurez trouvée et les dispositions que vous estimerez devoir prendre. Nous avons signé un traité d'assistance. Vous pouvez donc compter sur moi pour toute l'aide qui vous sera nécessaire en vue de rétablir la concorde et, s'il le faut, mettre les coupables hors d'état de nuire.
Le retour du roi ne se fit pas dans l'immédiat. Les courriers pour l'Afrique n'étaient certes pas quotidiens. L'attente de son prochain départ le rongeait comme une sorte de cancer à l'idée de tout ce qui pouvait arriver encore dans son pays. L'éblouissement où l'avaient plongé les fastes de l'Exposition universelle s'estompait de plus en plus dans le brouillard de ses anxiétés, de ses inquiétudes. Les témoignages d'amitié, de considération qu'on lui avait prodigués, l'évidente volonté — de la part des autorités officielles — de mettre en valeur sa majesté royale ne flattaient plus guère son amour-propre, tant il était obsédé par la fragilité de son pouvoir, exalté ici, mais terriblement menacé là-bas. Les seuls moments de satisfaction, maintenant, étaient ceux où quelque compagnon lui signalait les échos qui paraissaient dans la presse le concernant.
Présent au Roi Dinah Salifou,
Dans la matinée d'hier, le shah a fait envoyer au roi Dinah Salifou un superbe sabre constellé de diamants et de pierreries. Il a été remis au roi par M. de Balloy et le prince Mirza, aide de camp du shah.
Cet entrefilet, paru un matin dans le Petit Parisien, l'avait comblé d'aise — plus peut-être que le somptueux cadeau lui-même. Voir son nom imprimé dans ce journal lu par des milliers et des milliers de personnes le réjouissait, le réconfortait. La foule parisienne avait admiré la prodigieuse richesse des équipages du souverain perse lors du cortège qui traversait les quartiers de la capitale. Comparé à la petite royauté du Rio Nunez, l'empire du shah était immense, immense. Mais le shah et lui étaient musulmans. Ils étaient tous deux disciples du Prophète, frères en Islam. Et tout le monde savait maintenant que ce grand roi l'avait traité en ami.
Les aléas des traversées en mer firent que Dinah Salifou retrouva — au cours de son escale à Saint-Louis du Sénégal le Dr Bayol, qui devait bientôt gagner Conakry, avec le titre de gouverneur des Rivières du Sud. A son arrivée dans la noble capitale sénégalaise, une mauvaise surprise guettait le roi des Nalous. Mais était-ce une surprise ? Une lettre l'attendait, d'un de ses familiers les plus sûrs, confirmant les rumeurs dont, à Paris, on lui avait déjà fait part. Tout allait mal au Rio Nunez. Tout allait de plus en plus mal, par la faute du seul Tocba.
Avant de reprendre la mer, s'appuyant sur ces révélations, Dinah insiste de toutes ses forces auprès du nouveau gouverneur pour qu'il vienne lui-même l'aider à remettre de l'ordre dans le pays. Le Dr Bayol promet. Cependant, dit-il, il doit se rendre auparavant à Porto Novo, au Dahomey, ville sous protectorat de la France. De là, il rejoindra son nouveau poste. Que Dinah rentre au Rio Nunez et lui écrive aussitôt, à Conakry, pour lui décrire comment, en vérité, se présente la situation. Dès réception de cette missive, le gouverneur verra quelles mesures prendre. Le chef des Nalous n'est guère satisfait de ces atermoiements. Il ne peut cependant que s'incliner et, encore une fois, faire néanmoins confiance aux Français qui lui doivent assistance.
Voici Dinah de retour à Sokoboly. Quel gâchis ! Tout ce qu'il apprend, par son frère Sayon, dépasse ce qu'il craignait. Ses pressentiments ne l'avaient pas trompé, mais ils étaient bien en deçà de la réalité. En fait la région est plongée dans une confusion pratiquement indescriptible. Tocba s'est dépensé partout comme un insensé au cours de son absence. Il ne s'est pas conduit en guerrier mais en véritable pillard, entraînant avec lui des hommes cupides et cruels. Ses bandes armées se sont attaquées à des paysans sans défense, volant leurs troupeaux, saccageant les récoltes. Depuis, la terreur règne le long du fleuve. Le peuple nalou s'est senti abandonné.
C'est ce qui affecte le plus Dinah Salifou. Il comprend qu'on ne lui pardonne pas d'avoir quitté le pays ; il l'a, en quelque sorte, livré à ce forcené. Les anciens surtout lui en tiennent rigueur. Mais, ce qui le trouble plus encore, c'est le reproche muet qu'il lit dans les yeux de ses proches comme dans ceux du plus humble de ses sujets. Son frère même, s'il n'ose blâmer ouvertement son aîné, ne lui a pas réservé l'accueil affectueux qu'il attendait. Lui, si gai, si spontané d'ordinaire, est souvent d'humeur sombre, comme si le poids des responsabilités avait porté un coup fatal à son insouciance.
Oui, le cousin ambitieux se conduit de plus en plus en rival déclaré. Il est plus que temps de le mettre au pas car il est prouvé que parfois, chez les Nalous, le pouvoir — en dépit des coutumes — appartient à qui sait le prendre. Mais, aux yeux de Dinah, la situation n'est pas seulement préoccupante pour le maintien de son autorité. Tocba en effet ne s'est pas contenté de spolier les paysans, de supplanter certains chefs de village : il a exposé le peuple nalou tout entier à de menaçantes représailles en attaquant, au nord, Bourang, le chef des Tanda, et cela au mépris de la règle établie, c'est-à-dire sans avoir envoyé au préalable les kolas rouges... Aussi, quand il a envahi le territoire de Bourang, l'effet de surprise a joué en sa faveur. Il n'a eu aucun mal à piller, impunément, plusieurs villages et à emmener des prisonniers.
Or que dit-on dans le pays ? Tocba, parait-il, répète à qui veut l'entendre qu'il a agi sur les instructions que lui aurait données le roi avant son départ pour la France, alors que lui, Tocba, s'il avait été le maître des Nalous, n'aurait eu de cesse au contraire qu'un traité soit signé avec Bourang pour la paix et la bonne entente entre leurs deux peuples.
Ainsi donc Dinah aurait beau, même sur le Coran, attesté sa bonne foi, le mal est fait. Plus que jamais le temps presse. Il ne faut pas laisser s'accréditer cette rumeur selon laquelle il aurait été lui-même l'inspirateur des troubles survenus en son absence.
Heureusement le Dr Bayol, de retour à Conakry, semble avoir pris très au sérieux l'affaire du Rio Nunez. Avant même d'avoir reçu des nouvelles de Dinah Salifou, il lui écrit pour le presser de lui donner les informations qu'il attend. Cela devient d'autant plus urgent qu'il a eu communication, de la part du commandant de cercle de Boké, de nouvelles fort alarmantes au sujet de « gens du Foréah » qui menacent d'envahir le Rio Nunez.
Relancé par cette intervention du gouverneur, Dinah, au début de décembre, obtempère. Dieu, que Paris est loin! Il écrit donc au Dr Bayol. Ce qui ressort de cette missive, c'est, avant tout, l'obsession créée chez Dinah par son terrible cousin.
« Gloire à Dieu
De la part de Dinah Salifou, roi des Nalous, à M. Bayol, gouverneur des Rivières du Sud, à Conakry.
Je viens vous informer que j'ai reçu votre lettre, j'ai entendu son contenu, je sais par là que vous ne m'avez pas oublié, que vous vous souvenez encore de moi.
J'ai entendu par cette lettre que vous me parlez des gens du Foréah qui viennent faire la guerre dans le Rio Nunez et qu'ils sont venus même piller jusqu'auprès du poste de Boké, à Baralandé. Et vous me dites que je ne dois pas rester à regarder ces choses, que je dois veiller et empêcher cela. Je vous annonce que tout cela, c'est la faute de Tocba, et je viens vous rappeler ce que je vous avais dit à mon retour de France et que nous nous sommes, trouvés à Saint-Louis. Je vous avais dit que j'ai reçu une lettre de chez moi m'annonçant que Tocba a bouleversé tout le pays pendant mon absence : il a pillé les badolos (cultivateurs) et leur a fait un grand tort, il a même pris parmi eux des hommes libres qu'il a vendus, il en a tué trois sans ordre ni justice.
Vous m'aviez répondu que vous partiez pour Porto Novo et que, quand je serai de retour au Rio Nunez, de voir si le contenu de la lettre est vrai et de vous l'écrire. A mon arrivée au Rio Nunez, j'ai trouvé que le tout était vrai, c'est pour cela que je vous écris cette lettre et vous demande de m'aider sur Tocba, car il veut bouleverser le pays et cherche à me trahir.
Le jour que le Gouvernement français m'a nommé roi des Nalous, on m'avait dit que tout ce qui me nuira dans mes Etats, de le prévenir. Je vous écris alors pour vous annoncer que Tocba me nuit et cherche à me trahir.
Fait au Rio Nunez, le 1er décembre 1889. »
On le voit, Dinah Salifou apporte au gouverneur confirmation de tout ce qu'il lui a déjà dit. Au reproche qui lui est fait, à propos des pillards venus du Foréah, de « rester à regarder ces choses », il ne répond pas directement. Ou, plutôt, il en profite pour rechercher l'appui des Français contre son cousin : « Je vous annonce que tout cela, c'est la faute de Tocba. »
Cependant, si l'on se réfère à la lettre du gouverneur, il semble bien que celui-ci est plus préoccupé par la situation générale que par les incartades de Tocba. Sans innocenter Dinah de tout artifice, on peut penser qu'il prit conscience de cela assez rapidement, ce qui lui aurait donné l'idée de provoquer une séance de réconciliation avec les uns et les autres pour lutter contre le péril extérieur. Il espérait, on le verra, confondre Tocba, à cette occasion, devant les Français. Si sa tentative échouait il serait toujours temps, ensuite, de régler son compte à ce trublion si, d'aventure, il persistait dans ses tortueuses machinations.
D'où la lettre de Dinah à l'administrateur du cercle, suggérant qu'une rencontre — véritable confrontation — ait lieu en présence du commandant, celui-ci faisant office d'arbitre entre les parties. A la vérité, en lisant attentivement la lettre du roi à l'administrateur, on s'aperçoit que, sous couleur de réconciliation, celui-ci comptait bien attirer Tocba dans un piège, se faisant fort de démontrer sa culpabilité. La réconciliation se ferait entre Landouman, Tandas et Nalous en sacrifiant le principal responsable de tous les troubles récents et en l'éliminant enfin définitivement.
La lettre de Dinah Salifou au Dr. Lesquendieu se termine ainsi :
« A mon retour de France, j'ai trouvé que Tocba a bouleversé tout le pays. ( ... ) Comme vous êtes l'administrateur ici et que vous représentez le gouverneur, je vous demande de faire venir Tocba et les notables du pays et de dire à Sarah de venir aussi, ainsi que Bourang, chef de Tanda; nous viendrons tous au poste pour régler cette affaire, et celui qui a le tort vous l'enverrez à Saint-Louis, car, en quittant le pays pour me rendre en France, le pays était tranquille, et à mon retour j'ai trouvé que Tocba avait tout bouleversé et je ne sais celui qui a donné l'ordre de faire la guerre.
En l'envoyant à Saint-Louis, le gouverneur le lui demandera.
Fait à Sokoboly, le 10 décembre 1889. »
Quelle qu'ait été l'intention secrète de Dinah — que d'ailleurs il ne dissimule pas au Dr Lesquendieu — on ne pouvait contester le bien-fondé de son initiative. Il ne restait pas à « regarder ces choses ». Il veillait.
Ce ne serait pas la première fois que des antagonistes irréductibles en viendraient à composition. Le préjugé de faveur dont bénéficie Dinah devrait peser dans la balance. Bon gré mal gré, le chef des Landouman et celui des Tandas, comme Tocba, seraient amenés à signer un nouveau pacte pour la cessation des combats. Puisque son cousin relève de son autorité, le roi des Nalous pourrait ensuite prendre toute initiative contre lui en cas de manquement à la parole donnée.
En soi le calcul était bon. Le commandant Lesquendieu lui fit savoir en effet qu'il avait invité Sarah, Bourang et Tocba à Boké pour la rencontre projetée. Le plan de Dinah était simple. Son meilleur atout pour clarifier la situation : mettre en lumière la duplicité de son cousin. Le chef des Tandas, comprenant qu'il avait été joué, accepterait sans peine de faire la paix avec le chef suprême des Nalous. En échange de cette attitude raisonnable il recevrait — au détriment de Tocba — des compensations suffisantes pour les dommages subis. Ce serait justice. Du côté de Sarah, il suffirait de rappeler les termes de la convention signée à bord du Goéland pour que tout rentre dans l'ordre. Pour toutes ces propositions, l'approbation des Français lui paraissait acquise d'avance.
Pourquoi ce plan fut-il totalement réduit à néant ? Parce qu'il n'exista qu'à l'état d'ébauche et dans la seule tête de Dinah. Celui-ci, convié à Boké, attendit durant quatre longs jours la venue des autres chefs.
Aucun d'eux ne se présenta. Il est difficile d'imaginer échec plus cuisant et plus grande humiliation. De la part des adversaires il est vrai, cette dérobade était la meilleure tactique à suivre. Mais comment ont-ils osé se soustraire à cette entrevue ? Ils ont dû tabler sur le fait que Dinah Salifou, au lieu de vouloir que les affaires soient réglées entre eux, s'était adressé aux Français, ceux-ci faisant toujours figure d'intrus au Rio Nunez. La manœuvre était habile car, ou bien les Blancs prendraient le parti de Dinah — qui se compromettrait ainsi avec eux encore davantage — ou bien, voyant grandir l'hostilité des autres à son égard, ils lui retireraient leur appui pour se concilier, à la fin, les Landouman avec Sarah, les Tandas avec Bourang, et les Nalous avec Tocba...
C'est la première hypothèse qui, d'abord, parut se vérifier. Le Dr Lesquendieu en effet rendit très objectivement compte du rendez-vous manqué, soulignant que Dinah avait attendu ses interlocuteurs, mais que ceux-ci n'avaient pas jugé bon de venir le rejoindre à Boké. La lettre du commandant de cercle est datée du 25 décembre. De son côté Dinah Salifou, le dernier jour du même mois, écrit au gouverneur des Rivières du Sud. Dans sa lettre (30 décembre 1889) tout semble indiquer qu'il veut sauvegarder à tout prix la paix au Rio Nunez. Il se conforme ainsi à l'esprit des traités qui ont été signés avec la France du temps de Youra — celui du 28 novembre 1865, complété par la convention du 30 janvier 1884 que lui-même a cosignée avec Youra.
Il rappelle que, à la suite des incursions de son cousin Tocba en pays tanda, le chef Bourang a exercé des représailles, comme cela était à prévoir, tuant une vingtaine de Nalous et emmenant captifs près d'une centaine d'autres. Malgré cela Dinah laisse entendre qu'il ne veut pas céder à la tentation de lui rendre la pareille, n'étant en rien lui-même cause du conflit. Il dénonce toujours le seul coupable: son cousin Tocba, le chef de Caniope. Puisque le traité du 28 novembre 1865 signé avec la France suppose mutuelle assistance dans les difficultés, l'occasion se présente aujourd'hui d'appliquer l'article 3 qui fait mention de cette clause. En conséquence Dinah demande encore une fois au gouverneur de faire en sorte que Tocba soit convoqué à Saint-Louis pour qu'il s'explique sur ses agissements et que des sanctions soient prises contre lui.
Il paraît évident, d'après cette lettre, que Dinah Salifou estime la solution qu'il préconise comme la plus indiquée pour sortir de l'imbroglio créé par son cousin. La mise à l'écart de celui-ci rétablirait chez les Nalous eux-mêmes l'autorité de leur roi. Cette décision, prise par les Français, confirmerait en outre l'appui qu'ils entendent continuer d'apporter à Dinah. Son prestige serait ainsi rétabli non seulement dans son royaume mais, du même coup, auprès des Landouman, des Tandas et autres chefs de la région.
Malheureusement il ne se passa rien de tout cela.
Les événements vont prendre une tournure inattendue avec le départ de M. Lesquendieu. Un nommé Opigez le remplace. Un de ces hommes que secrète immanquablement, une fois ou l'autre, le prurit colonisateur. Un homme aux yeux froids, au ton cassant, sûr de ses idées, de ses méthodes et pour qui la fin justifie n'importe quel moyen si celui-ci permet d'atteindre le but recherché. Ainsi pourrait-on aller jusqu'à croire qu'il n'a pas hésité à intercepter certains messages de Dinah Salifou pour le gouverneur, ou les réponses de celui-ci, dans la mesure où cette correspondance risquait d'aller à l'encontre de ses vues. Rien ne permet cependant d'accorder créance, de façon certaine, à cette supposition. La réalité n'en est pas moins cruelle pour le roi des Nalous : à toutes ses missives concernant l'exil de Tocba, nulle réponse. Sans doute lui a-t-on fait savoir verbalement qu'il n'était pas opportun de contraindre le chef de Caniope à quitter le Rio Nunez.
Les faits qui se sont produits peuvent expliquer cet état d'esprit chez les Français. Les querelles intestines, dans toute la région de cette partie des Rivières du Sud, ont causé entraves et grandes pertes aux commerçants européens. Mais on pouvait garder espoir de rétablir localement la tranquillité nécessaire aux affaires. L'éviction de Tocba aurait même pu être considérée comme positive à cet égard. Or c'est précisément cela qui maintenant paraît contestable. La menace nouvelle qui se précise est en effet plus grave et plus difficile à écarter. Dans le Foréah, territoire séparant le Fouta-Djallon des premières marches du Rio Nunez, les Foulacoundas, pasteurs guerriers et pillards, ont — depuis longtemps déjà — occupé de larges espaces. Mais cela ne leur suffit plus, semble-t-il. Ce sont eux qui font en pays landouman et jusque chez les Nalous des incursions de plus en plus fréquentes. Ils repartent de là chargés de butin et emmènent en esclavage de nombreux prisonniers. Leur tactique est si pleine de surprises, leurs attaques sont si brusques et, une, fois leurs rapts accomplis, leur disparition est si rapide qu'il est impossible, d'abord d'échapper à leurs coups et ensuite, plus encore, de les poursuivre pour châtier leur audace. Des quelques affrontements qui ont quand même eu lieu ici ou là, ils sont toujours sortis victorieux, laissant sur place ruines et cadavres.
C'est là une situation très préoccupante pour le colonisateur, qui risque de voir vaincus et sans aucun pouvoir les chefs qu'il est parvenu à se concilier par de nombreux traités. Les raids des Foulacoundas sont devenus si rapprochés qu'on peut craindre qu'ils finissent par envahir le Rio Nunez pour s'y implanter, comme ils l'ont fait au Foréah. Ce n'est donc pas le moment d'affaiblir la capacité de résistance des Landouman et des Nalous. Tocba étant, chez ces derniers, l'un des chefs les plus combatifs, on ne saurait se passer de son concours, d'autant que ses guerriers — habitués aux coups de main — sont peut-être les seuls à pouvoir inspirer quelque respect aux dangereux pillards du Foréah...
Il n'est guère possible d'expliquer autrement l'impunité dont bénéficiait le turbulent et dangereux chef de Caniope, bien que le déroulement des faits et certaine prise de position du commandement local, à Boké, fourmillent de contradictions. Le drame, en tout cas, c'est que l'indifférence des autorités françaises à l'égard des avertissements de Dinah Salifou semble avoir peu à peu annihilé chez le roi des Nalous toute confiance en lui-même. Totalement obnubilé par la hargne de son cousin, redoutant sans cesse d'être supplanté par lui, il n'a plus qu'une hantise — le faire corriger par les nouveaux maîtres du Rio Nunez, qui ont pour eux la puissance et les armes. Aussi bien, après l'échec de son stratagème à Boké, est-il littéralement aux abois. Il envoie message sur message.
Au terme des événements qui vont suivre il écrira au lieutenant-gouverneur à Conakry (18 octobre 1890) :
« ... Combien de fois j'ai écrit au gouverneur du Sénégal, M. Largeau aussi, pour demander à ce qu'on fasse disparaître cet homme de la Rivière pour quelques années, pour le punir, à Saint-Louis ou ailleurs. Pas de réponse...
Après le départ de M. Largeau, j'ai aussi parlé à M. Guillou, commandant, de le faire disparaître, par la demande de M. le Gouverneur. Mais de tout cela, pas de réponse.
Moi-même j'ai écrit deux fois au gouverneur du Sénégal, afin qu'il puisse savoir ce qui se passe dans la Rivière et ce que fait Tocba. Pas de réponse... »
Apparemment, Dinah Salifou ne voulait pas la mort de Tocba. Il voulait simplement qu'on l'en débarrasse, qu'on l'éloigne du Rio Nunez. Il n'est pas question de minimiser ici, par cette remarque, le caractère brutal des mœurs de ce temps. En maintes circonstances — comme lors du meurtre de Bokari — le roi des Nalous a montré qu'il pouvait lui aussi être sanguinaire, implacable, assoiffé de vengeance. Pourtant il a fait preuve de patience à l'égard de Tocba et même d'une certaine tolérance malgré leur violente animosité — à moins que ce ne soit de faiblesse. Il voulait qu'il soit « convoqué» à Saint-Louis seulement pour y recevoir remontrance. Il n'allait pas jusqu'à réclamer, au moins ouvertement, sa déportation — cela parce qu'il était de sa famille.
« Vous m'avez demandé, écrira-t-il, si je voulais qu'on le déporte et qu'il ne verra plus le pays. Je vous ai répondu non, parce que c'est mon cousin. »
Par ailleurs son voyage en France l'avait mis en contact, durant de longs jours, avec une civilisation policée lui faisant apparaître sous un jour nouveau les relations entre les hommes. Cela pourrait expliquer ses réticences avant de se lancer, comme au temps de Youra Towel, dans des luttes sans merci. Pour qu'il revienne à de tels comportements, il faudra l'insistance d'un de ces hommes dits civilisés, le commandant même du cercle de Boké.
Une suite de circonstances va conduire en effet Dinah Salifou à la pire extrémité. Le premier semestre de l'année 1890 verra se nouer toutes les intrigues qui vont le conduire au dénouement fatal.
Fidèle à sa parole et répondant aux sollicitations du gouverneur, le roi des Nalous, durant les premiers mois de l'année, s'est efforcé de prendre en main la défense du territoire contre les redoutables Foulacoundas. Il a demandé au commandant de cercle quelques subsides et, d'autre part — toujours peu assuré du concours de Sarah, et surtout de Bourang et de Tocba —, il a fait appel à Mody Yaya, prince du diiwal Labé (Fouta-Djallon), qui ne négligeait jamais une occasion d'affirmer sa suzeraineté sur cette région des Rivières du Sud.
Bien que les renseignements sur cette période soient imprécis, il apparaît que Bourang et Tocba se sont alors comportés en réfractaires, n'obtempérant pas aux injonctions de M. Opigez, le nouveau commandant de cercle, qui les voulait, aux côtés de Dinah Salifou, dans son obédience. Ce sont vraiment des « mauvais sujets ».
Pendant plusieurs mois encore les choses traînent en longueur. Chaque initiative de Dinah est battue en brèche par les deux chefs récalcitrants. Mais sa patience ne saurait être sans limites. M. Opigez, qui est pour la manière forte, ne comprend pas la trop grande mansuétude du roi. Adresser seulement une réprimande à Tocba lui paraît de l'enfantillage. Il faut frapper dur, très dur. Les exigences de la guerre imminente le commandent.
Cependant Dinah Salifou, toujours soucieux d'agir selon ses engagements, attend.
Une lettre de M. Opigez, en date du 3 août 1890, le délivrera enfin de ses scrupules. La voici, dans sa brièveté — et son cynisme à peine voilé :
« Le commandant du cercle de Rio Nunez à Dinah Salifou, roi des Nalous.
Moi, le commandant à Boké, vous annonce que je vous envoie les 500 francs que vous m'avez demandés, mais vous ne me dites rien au sujet de la guerre, ni de Mody Yaya, le prince du Fouta Jallon qui est avec vous ; je crois que sous peu vous me direz ce qui se passe surtout sur ce que je vous demande pour les deux mauvais sujets dont je vous demande les têtes. Je veux avoir ces deux têtes.
Votre ami, le commandant de poste de Boké.
Opigez. »
Puisque les troubles ont éclaté au Rio Nunez, pendant l'absence du roi, par la faute de Bourang et de Tocba, la meilleure façon d'en terminer c'est de se débarrasser de l'un et de l'autre. Bon. D'accord. Dinah ne souhaitait pas aller jusque-là ou, du moins, ne s'y croyait pas autorisé. Mais puisque le commandant de cercle voit les choses ainsi, le sort en est jeté. Ces deux têtes, M. Opigez les aura !
Deux jours plus tard, la mission est accomplie. Que s'est-il passé exactement ? Dinah Salifou s'en est expliqué dans une lettre à Opigez, du 15 août de la même année, et dans une autre adressée au gouverneur du Sénégal, le 18 octobre — puis dans une autre encore, à cette même date, au Dr Bayol. En rassemblant et comparant les données de ces divers écrits, on peut reconstituer les péripéties de la sanglante aventure.
Mais il faut pour cela revoir d'abord, en pensée, le maître du pays nalou se débattant dans cette conjoncture embrouillée, difficile.
Depuis son retour de France, les mois ont passé. La saison humide se termine. En apparence, la vie s'écoule, immuable, au palais et à Sokoboly. Dinah suit de près, malgré ses soucis, les études de son fils aîné, Ibrahima. Il surveille le travail des esclaves dans ses champs, ses palmeraies et ses rizières. Cependant il se promène plus souvent qu'auparavant dans le grand village, entrant dans les paillotes pour se tenir au courant de ce que pense son peuple.
Dans les cours intérieures, les artisans pratiquent leur métier. Les vanniers tressent des paniers et des corbeilles avec les tiges de bambou cueillies sur les berges du fleuve. Les orfèvres cisèlent des bijoux de cuivre et d'argent. Les fabricants d'instruments de musique façonnent pour les griots des balafons, des korahs et des tam-tams.
Feignant l'enjouement, le roi lance aux uns et aux autres :
— Ah, que j'aimerais changer ma place contre la vôtre! Rester assis sur une natte de raphia, chanter en travaillant et n'avoir pas la tête comme une calebasse pleine de scorpions qui la dévorent...
Le ton est fraternel, mais la plaisanterie tombe à plat, comme l'on dit. Les visages ne s'éclairent plus comme avant. Parfois les moins timides s'enhardissent:
— Ne nous envie pas, roi. Nous avons notre part ! et chaque jour davantage. A présent, nos femmes et nos filles refusent d'aller seules sur les bords de la rivière. Elles ont peur d'être enlevées. Même nous, les hommes, nous n'allons plus à l'aventure dans la forêt, si ce n'est en bandes, avec des armes, pour éviter les mauvaises surprises. Des guerriers ennemis et des pillards rôdent partout. Plus personne ne vient échanger nos produits contre du sel, du tissu ou d'autres choses dont nous avons besoin. On dit partout que tu permets à des voleurs de faire la loi chez toi, C'est pour cela qu'on ne vient plus commercer sur tes terres...
Dinah écoute, les paupières à demi fermées et les lèvres serrées. Puis il s'exclame :
— Les Landouman, et Bourang, et Tocba se trompent. C'est moi qui gouverne ici. Ils s'en apercevront bientôt à leurs dépens!
Et il repart sans se presser, ne laissant rien voir du trouble de son cœur. Du temps de son oncle, le vieux Youra, aucun Nalou ne se serait adressé avec tant de franchise et de liberté à son souverain. Peut-être ne devrait-il pas lui-même tolérer une telle familiarité. Mais comment en vouloir à ceux qui lui livrent ainsi le fond de leurs pensées ? Il sait bien qu'ils ne mentent pas.
Ce n'est que trop vrai : cette année 1890 n'est pas, au pays nalou, une année heureuse. L'impudence de Tocba et de ses complices n'a plus de limites. Avec leurs troupes ils continuent d'attaquer les voyageurs, de capturer pour les vendre des cultivateurs et des pêcheurs isolés. Ils s'emparent d'adolescentes et même de fillettes. Ils incendient les paillotes éparses dans la campagne et aussi des villages. Dinah a eu beau envoyer des messages alarmés au commandant de cercle, à M. le Lieutenant-Gouverneur, et même à M. le Gouverneur du Sénégal, pour des raisons qui lui sont incompréhensibles ces messieurs ne lui expédient ni soldats ni armes. Ils ne prennent même pas la peine de répondre à ses lettres.
C'en est trop vraiment. Or voici que le commandant de cercle, sans répondre à ses récriminations contre son cousin, lui demande de partir en guerre au-delà des frontières de son pays, justement contre ces Diolas de Tanda, autrefois amis de bon voisinage mais devenus, par la faute de Tocba, des ennemis pleins de ruse. Si l'on fait appel à lui, c'est donc qu'il est toujours considéré comme un roi puissant, un allié utile.
Dinah saisit l'occasion de pouvoir prouver aux Français sa fidélité aux traités qu'il a signés.
Une grande activité règne maintenant à Sokoboly. Dinah a mandé ses principaux chefs de village et les guerriers les plus attachés à son clan. En grand secret il a invité Mody Yaya, du Fouta-Djallon, à venir se concerter avec lui pour attaquer sur son terrain le chef Bourang, qui a le tort de déplaire à l'autorité française. Cette alliance avec Mody Yaya est précieuse. Elle devrait permettre de terminer au plus vite cette guerre qu'on lui impose. C'est ce qu'il explique à M. Opigez, en lui demandant quelques subsides.
Mais il voit aussi dans cette affaire le moyen, peut-être, de neutraliser Tocba et, qui sait, de le faire disparaître. De toute façon, c'est toujours l'un de ses sujets. Il ne peut le tenir en dehors de ces combats où il lui doit assistance. Il l'a donc convoqué à Sokoboly, au même titre que les autres chefs de village. Mais Tocba, fidèle à sa tactique d'insubordination, n'a pas donné signe de vie.
Par chance pour lui, Dinah ne manque pas d'informateurs. Il sait que, toujours sur ses gardes, Tocba compte autant que lui profiter des circonstances pour trancher dans le vif la querelle qui les déchire. Il est si facile, au cours d'une embuscade, de se tromper d'adversaire... Le chef de Caniope intrigue depuis longtemps pour ravir à son cousin le titre de roi. Il a entraîné dans son sillage tous ceux que le chef des Nalous a, une fois ou l'autre, mécontentés, brimés ou punis. Et comme il a appris les démarches répétées de Dinah auprès des Français pour le faire convoquer à Saint-Louis, son animosité n'a fait que croître. Chacun pense de son côté : « C'est lui ou moi. » Dinah l'a compris depuis longtemps. Le dénouement est proche. Laissons celui qui est encore le chef suprême des Nalous s'exprimer sur ce qui est survenu alors. Il l'a fait dans une lettre au gouverneur du Sénégal :
« De la part de Dinah Salifou, roi des Nalous, au gouverneur du Sénégal. Salut.
Le but de cette lettre est de venir vous informer l'état de mon pays.
( ... ) Depuis cette époque (le retour de France) Tocba ne fait que continuer ses pillages. Je lui ai fait plusieurs fois des observations à cet égard, et finalement je lui ai dit que j'ai fait ma réclamation au commandant.
Tocba sachant cela n'a cherché qu'à me trahir, pour me tuer et prendre ma place.
Il a fait venir chez lui mes ennemis et il a tenu conseil avec eux pour chercher le moyen de se débarrasser de moi. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai prévenu le commandant et je lui ai demandé à envoyer Tocba à Saint-Louis. Depuis, j'ai resté trois mois sans réponse et après le commandant m'envoie faire la guerre ; j'ai fait appel à tous mes sujets. Tocba n'est pas venu à l'appel, mais quand j'étais en route, il est venu me rejoindre, il était accompagné avec mes ennemis. Lorsque j'ai vu cela et que j'étais dans le désert, je ne pouvais plus patienter ni prévenir le commandant, et là je l'ai tué: pour me sauver la vie, car si je ne l'avais pas fait, il m'aurait tué puisqu'il est venu me rejoindre douze jours après mon départ et son intention était de m'assassiner... »
Cette lettre est du 18 octobre 1890. Ainsi, la ruse imaginée par Tocba s'est retournée contre lui. Dinah Salifou a, selon ses dires, considéré qu'il était en état de légitime défense. Comme le hantait par ailleurs l'invitation pressante de M. Opigez « Je veux ces deux têtes », il avait deux raisons plutôt qu'une de passer à l'action et de faire tomber la première tête sans plus attendre. Ce qui est expliqué dans le passage de la lettre ci-dessus adressée au gouverneur du Sénégal, il le confirme le même jour au lieutenant-gouverneur à Conakry en soulignant les motifs de cette justice expéditive :
« Tocba a été exécuté, d'après tout ce qu'il a fait dans le pays, attendu qu'il y avait que des pleurs partout. »
Mais c'est dans un billet écrit « à chaud » si l'on peut dire, rédigé le 15 août pour le commandant de cercle, donc peu de temps après cette « exécution », que Dinah relate les circonstances du drame. Les termes en sont à la fois sobres et précis, mais les détails peu nombreux. A l'imagination de compléter ce bref récit, effectué dans un langage comme toujours un peu heurté et malhabile, mais combien évocateur !
« ... Vous m'avez fait faire la guerre aux Diolas de Tanda. Tocba est venu me trouver dans ma forêt avec ses hommes, cherchant à me tuer. Sachant que si je ne le débarrasse, il me tuerait, je l'ai tué car si je ne l'avais pas fait, j'y resterai, et rien ne vaut sur moi ma vie. Aussitôt tôt après l'avoir tué, je vous l'ai fait savoir ainsi que la cause de sa mort. »
Il faut se reporter à la lettre adressée au lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud (18 octobre) pour connaître d'autres précisions et, notamment, l'ampleur de la conjuration fomentée par Tocba, à tel point, précise Dinah, qu' « on a publié dans tous les journeaux de France que j'ai été assassiné par Tocba ». D'après le roi des Nalous, son cousin aurait même été jusqu'à circonvenir Mody Yaya, son allié. C'est la loyauté de celui-ci qui lui aurait permis de saisir ainsi toute l'imminence du danger. Tocba n'en était pas à sa première tentative, si l'on en croit son « frère ».
« ... Tocba a cherché tous les moyens pour me tuer. Il donnait des fusils chargés à des hommes pour me guetter la nuit chez moi pour me tuer. Et chaque fois, je suis averti. Cette dernière guerre, lorsque j'étais avec Mody Yaya, il lui a fait cadeau d'une caisse de fusils et beaucoup de marchandises d'accord avec lui pour me tuer. Cet homme, plus intelligent que Tocba, m'a tout montré et m'a tout avoué ; il a même promis à Mody Yaya une somme de 2 000 francs en plus après ma mort. Vous voyez donc, M. le Lieutenant-Gouverneur que réellement je n'ai pas tort de le tuer... »
La révélation faite à Dinah par son allié semble bien avoir été l'élément déterminant pour lui, mettant fin à toutes ses hésitations et à tous ses scrupules à l'égard de son « frère » Tocba. Il a donc été exécuté, précise-t-il, le jour même, à 3 heures de l'après-midi.
C'était le 5 août.
Mais l'administrateur avait demandé deux têtes... Singulier administrateur qui, voyant ses recommandations prises trop à la lettre, cherchera très vite à se dégager de toute responsabilité dans cette mésaventure. Dinah, lui, est tout heureux au contraire d'annoncer qu'il a rempli toute la mission dont il s'est cru chargé. Il écrit : « Après cela (le meurtre de Tocba), je me suis battu avec Bourang, chef de Tanda, je l'ai tué et j'ai remis sa tête au commandant de Boké, comme il me l'avait demandé... »
Peut-être revoyait-il alors les terribles scènes qui s'étaient déroulées à Sokoboly lorsqu'on avait apporté à Youra Towel, dans son palais, la tête de son ennemi Bokari. Après avoir tendu vers le soleil couchant, à bout de bras, la tête sanglante, le vieux roi aveugle, en tâtonnant, plongeait ses doigts, avec une sorte d'ivresse, dans les orbites du mort.
Certes, si Dinah Salifou n'imaginait pas le commandant de cercle se livrant à une telle bacchanale avec les têtes de ses adversaires vaincus, il ne s'attendait pas non plus à se voir désavoué par celui-là même qui l'avait impérativement poussé à agir. Et pourtant Opigez n'y manque pas. Il écrit à Dinah (14 août) :
« ... J'ai entendu ce que vous avez dit avoir tué Tocba et que ce sont les Français qui vous ont donné la permission de le tuer, vous devez savoir que ce n'est pas vrai. »
Dinah, conciliant, répond le lendemain, de son campement de Kilak Lak :
« J'ai reçu votre lettre datée du 14. J'ai entendu ce que vous avez dit dans cette lettre. Pour ce que vous dites de la mort de Tocba, ceux qui vous ont dit que ce sont les Français qui m'ont autorisé à tuer Tocba, ce n'est pas vrai. Je ne l'ai jamais dit et je ne dis jamais que ce qui est vrai... »
Dinah, par cette réponse, tente d'amadouer le commandant de cercle, qu'il devine violemment indisposé à son égard. Peine perdue, car il y a cette lettre (on la retrouvera plus tard), si imprudente, où Opigez lui a dit : « Je veux ces deux têtes. » De l'avoir pris au mot, Dinah s'en est fait un ennemi mortel. Il aura à le payer durant tout le reste de sa vie.
La malchance en effet va le poursuivre, qui donnera prise au vindicatif commandant pour travailler à sa perte. Dans un premier temps tout semble d'abord aller bien. Aussitôt après la mort de Tocba, son vainqueur a envoyé une partie de ses hommes occuper le village de Caniope. On a fait main basse sur tous les biens du disparu. C'est la coutume. Sur ce butin, Dinah a prélevé quarante bœufs. Il les offre à Mody Yaya, pour payer celui-ci de sa loyauté.
Mais il faut finir la guerre, c'est-à-dire remporter la victoire sur les Foulacoundas. M. Opigez a dit :
« Il faut vous dépêcher pour que toutes les affaires de la guerre finissent. »
Expéditif, l'administrateur ajoutait:
« Ce que vous pouvez faire, faites-le avant la fin du mois d'août. Avant quinze jours, il faut que vous finissiez. »
Toujours dans sa lettre du 15 août, Dinah avait répondu :
« Vous me dites de finir la guerre dans une quinzaine de jours ; je l'ai compris et l'ai fait savoir à Mody Yaya, mais vous devez savoir que les affaires des Noirs ne se fassent pas si vite que les affaires des Blancs. Nous commencerons à nous rassembler mercredi, et nous choisirons un jour pour tomber sur les Diolas. Envoyez-nous les guerriers de Sarah pour nous renforcer, comme vous me l'aviez promis. »
En fait les Diolas de Tanda étant devenus les alliés des Foulacoundas, Dinah savait que la lutte serait dure. Mais son traité d'alliance avec les Français ne lui permettait pas de se dérober. Toutefois, les affaires des Noirs ne se faisant pas « si vite que les affaires des Blancs », il fallait prendre le temps de mobiliser toutes les forces disponibles. Cela allait le conduire, non pas à la fin du mois d'août, mais jusqu'au 8 octobre.
C'est ce jour-là que, selon un chroniqueur, Nalous, Landouman et Foulahs passent à l'attaque au village de Compony. L'issue est désastreuse.
« Dès le début du combat les Foulahs, sévèrement atteints par la fusillade ennemie, lâchent pied ; les Landouman, qui ne veulent pas aider Dinah, s'empressent de fuir sans avoir perdu un seul homme. Réduits à leurs seules forces, les Nalous, complètement battus, se retirent à Caniope abandonnant le pays aux pillards. »
« Là, j'étais battu », dira quelque temps plus tard, sans commentaires, le combattant malchanceux. Et c'est bien là en effet qu'est né ce mauvais sort qui va le poursuivre et ne plus jamais le laisser en repos.
Le tyranneau qui règne à Boké, cet Opigez peu scrupuleux, imbu de lui-même «( Moi, le commandant »), retors et rancunier, n'aura de cesse qu'il ait éliminé ce chef encombrant. Il y a deux têtes qui pèsent trop lourd dans la balance. Toute la carrière coloniale d'Opigez risque d'être compromise par la bévue de cette lettre malencontreuse qui a provoqué le meurtre de Tocba et de Bourang. C'est donc l'autre, ce Dinah, qu'il faut à tout prix compromettre pour détourner l'attention. On comptait sur lui. Il a déçu au-delà de toute mesure. On ne peut plus le considérer comme un chef responsable. Tous les traités passés avec lui ne veulent plus rien dire. C'est un homme devenu totalement inutile.
Il est bien vrai qu'un homme vaincu est toujours en situation d'infériorité. Très vite donc, Opigez va lui porter le coup de grâce.
Par les lettres citées plus haut, notamment celles du 18 octobre au gouverneur du Sénégal et à celui des Rivières du Sud, il est évident que Dinah Salifou, se sentant poursuivi par la vindicte d'Opigez, a tenu à se disculper. Mais un commandant de cercle ne peut guère, en plein exercice, être désavoué par ses chefs. C'est pourquoi les lettres de Dinah demeurent sans réponse tandis qu'Opigez multiplie les démarches pour disqualifier le roi des Nalous, affirmant qu'il a perdu toute autorité et qu'il ne présente plus aucun intérêt pour le gouvernement colonial. Il est plus que temps de lui retirer tout pouvoir et de l'éloigner du Rio Nunez.
Mais l'administrateur sait bien que le chef des Nalous a encore des partisans fidèles. Il lui faut donc agir par ruse. La fin justifiant pour lui les moyens, il n'en est pas à un subterfuge près. Il prétextera la nécessité de tenir palabre avec le roi après tous ces événements. C'est un piège auquel Dinah, dans sa bonne foi, se laissera prendre le plus naïvement du monde.
Opigez lui envoie, dans la journée du 5 novembre, un message d'urgence :
« Le commandant du poste de Boké à Dinah Salifou, roi des Nalous.
Je vous écris cette lettre pour vous annoncer que j'ai reçu votre lettre et entendu ce que vous m'y dites : je vous remercie infiniment sur les renseignements que vous m'avez donnés. ( ... ). Mais je vous annonce qu'il faut vous tenir prêt pour être à Victoria demain, à 2 heures. J'y serai aussi à 2 heures pour que nous nous rencontrions avec le commandant de La Mésange pour avoir une entrevue ensemble. »
Il ne semble pas qu'Opigez ait été présent à ce rendez-vous.
Voici Dinah descendant le cours du Rio Nunez de Caniope à Victoria. Plusieurs anciens de Sokoboly l'accompagnent. Les piroguiers vont vite car le roi des Nalous ne veut pas faire attendre ses interlocuteurs. Son exactitude ne pourra que prouver sa bonne foi.
Arrivée au mouillage de Victoria, la pirogue vient se ranger le long de la jetée en bois où est amarrée La Mésange. Sur la jetée, des fusiliers marins jouent aux cartes. Ils s'interrompent un instant pour regarder les nouveaux venus, puis, indifférents, reprennent leur jeu. Les piroguiers aident les anciens à monter sur la jetée tandis que Dinah, souple et rapide, les a précédés et s'apprête déjà à poser le pied sur la première marche de la passerelle qui relie l'aviso à la jetée. Ainsi, personne pour l'accueillir ! Il aperçoit en haut, le long du bastingage, officiers et matelots qui, nonchalants, fument leur pipe en bavardant. Tout à coup le roi — il est toujours le roi des Nalous — remarque, parvenu aux derniers échelons de la passerelle, qu'une fumée épaisse s'échappe de la cheminée du bateau, comme si La Mésange s'apprêtait à appareiller.
Alors, dans une brève bouffée, des souvenirs lui remontent en mémoire. Il se rappelle son embarquement pour Bordeaux et son arrivée dans le grand port de France. Des gradés en uniforme de gala l'attendaient au pied de la passerelle recouverte d'un tapis rouge. L'équipage lui rendait les honneurs et une fanfare jouait la Marseillaise. Il se souvient aussi de l'accueil cordial auquel il a eu droit sur Le Goéland le jour où il a signé pour Youra Towel le traité d'amitié avec Mengua Sarah. Le commandant du bateau lui témoignait du respect et les jeunes gens galonnés s'empressaient autour de lui. Aujourd'hui tout cela semble appartenir à un rêve lointain et fantastique.
Au moment précis où Dinah franchit la coupée, l'un des matelots, s'éveillant de sa feinte torpeur, se penche sur le bastingage et ordonne aux compagnons du roi, qui ont commencé à monter la passerelle, de redescendre et de demeurer sur la jetée. Dinah fronce les sourcils et proteste, mais le matelot hausse les épaules :
— J'exécute les ordres. Le commandant ne veut que vous.
Le ton est bref, presque insolent et, apparemment, sans réplique. Le fils de Makoumba a un haut-le-corps. Il échange quelques mots en soussou avec les anciens de Sokoboly, pour les rassurer, puis exige d'être conduit sans tarder auprès de M. Opigez et du commandant de l'aviso. L'entendant élever la voix, deux gradés, un lieutenant et un enseigne blond et joufflu, viennent, sans se presser, à sa rencontre. Dinah, pas plus qu'eux, ne fait le geste de tendre la main, comme le voudrait la plus élémentaire courtoisie. Ne voyant toujours pas apparaître ceux qu'il doit rencontrer, il se contente de remarquer, d'un ton très froid
— Me voici, comme il m'a été demandé. Mais je n'aperçois nulle part M. Opigez, qui m'a prié de venir ici m'entretenir avec lui, et le commandant de ce bateau, qui représente, je suppose, M. le Lieutenant-Gouverneur des Rivières. J'espère que M. Opigez arrivera bientôt, s'il n'est déjà là. Je désire rentrer chez moi le plus tôt possible.
Le lieutenant échange un coup d'œil avec l'enseigne de vaisseau, puis répond :
— Opigez ? Non, il n'est pas venu. Nous avons des ordres pour vous conduire à Conakry, précisément auprès du gouverneur, M. Ballay, qui désire vous entendre lui-même.
Dinah veut se rassurer. Si le gouverneur en personne désire le voir, c'est qu'il ne se fie pas aux rapports de M. Opigez. Mais pourquoi cet isolement ? Et l'inquiétude l'assaille de nouveau. Au même instant retentit un grincement de chaînes s'enroulant autour des cabestans : les hommes de l'équipage sont en train de remonter l'ancre et la passerelle. Dinah s'élance. Il est trop tard. Le lieutenant l'agrippe par son burnous et lui dit, d'une voix doucereuse :
— Soyez calme, Majesté. Votre cabine est prête. Il vaut mieux vous y rendre et y demeurer pendant la durée de la traversée.
Dinah se rend compte qu'il est pris au piège. Pour l'apaiser le jeune officier s'incline alors légèrement, esquissant un sourire, et répète :
— Nous partons pour Conakry, où M. le Gouverneur vous attend.
La cabine est petite, mais propre et assez confortable. Le mobilier se compose d'une couchette, d'un vieux fauteuil, ainsi que d'un tabouret sur lequel sont posés une cuvette et un petit broc rempli d'eau. C'est le confort d'un bateau de guerre.
Dinah se laisse tomber sur le lit, cache son visage dans ses mains et lutte contre le découragement. Lui infligerait-on le traitement auquel a toujours échappé Tocba ? Les Français n'ont pas le droit de l'emprisonner au mépris des traités qu'ils ont signés avec lui. Il s'est toujours montré loyal envers eux et fidèle à ses engagements.
Après une journée interminable, l'obscurité envahit enfin la cabine. Parfois quelqu'un marche dans la coursive. Le prisonnier tend l'oreille, persuadé que le commandant se dérange pour lui fournir des explications. Mais personne ne vient, à part le matelot qui lui apporte une lampe à pétrole et son dîner.
La Mésange atteignit Conakry le lendemain dans l'après-midi. Dinah eut à peine un regard pour le gros bourg qui somnolait dans la chaleur humide. Il ignora les comptoirs commerciaux construits par les Blancs vingt-cinq ans plus tôt, mais qui semblaient se dresser là depuis des siècles, avec leurs murs sales et fissurés. La beauté des flamboyants couverts de fleurs somptueuses, le laissa indifférent. Les gamins aux mines futées qui attendaient les bateaux pour réclamer des cadeaux aux marins ne le firent même pas sourire. Il avait hâte de tirer les choses au clair avec M. Ballay.
Le gouverneur n'y alla pas par quatre chemins. Il lui reprocha son ingratitude. La France l'avait couvert de son investiture. Elle l'avait maintenu sur son trône, amenant d'autres rois à conclure avec lui des accords d'amitié et de commerce. Elle lui avait versé les mêmes appointements qu'à son oncle Youra Towel, à la mort de celui-ci, soit la somme de 5.000 francs. Enfin, elle l'avait invité sur son propre territoire, à l'occasion d'une fête exceptionnelle, et l'avait accueilli en grande pompe, avec mille prévenances. En échange, elle n'avait rien exigé de lui, sauf son concours dans une guerre contre un ennemi commun. Mais il s'était mal battu. Il avait même, disait-on, fui le champ de bataille...
Cette dernière insulte fit frémir Dinah. Il reconnaissait bien là les calomnies du sieur Opigez. Mais il ravala sa colère pour se défendre avec hauteur et passion.
Non, il n'avait pas manqué à son devoir ! A contraire, il s'était toujours évertué à satisfaire le Français. Même lorsqu'il dut faire de son cousin qui le haïssait le chef de Victoria. Il s'y était cependant résigné pour ne pas contrarier le commandant de cercle, mais il avait cru en même temps de son devoir de souligner les dangers d'un tel choix. M. le Gouverneur se remémorait certainement ses nombreuse lettres à ce sujet. Pourquoi étaient-elles demeurée sans réponse ? Si l'on avait tenu compte de ses mises en garde, il n'aurait pas eu à tuer Tocba, puis Bourang pour sauver sa propre vie. Les Diolas et les Tanda se seraient tenus tranquilles.
Il est vrai qu'il a eu le dessous dans son dernier combat. La faute en revient en partie à Opigez. Si celui-ci s'était montré moins pressé, Dinah aurai mieux préparé cette guerre et mis toutes les chance de son côté. Insuffisamment pris en main, ses allié l'ont très vite abandonné. Mais personne ne peut les accuser, ni lui ni ses guerriers, de s'être conduits comme des lâches. Accablés par le nombre, les Nalous et le Bagas se sont défendus de leur mieux.
Si M. le Gouverneur ne le croyait pas, avait conclu Dinah, il lui était possible de questionner les uns et les autres. Dans tout le pays des Rivières du Sud personne ne lui dirait le contraire.
Malgré cette véhémente protestation, M. Ballay ne changea rien à son opinion. M. Opigez avait longuement préparé le terrain... Il décréta d'un ton cassant :
— Vous vous expliquerez sur tout cela avec M. le Gouverneur du Sénégal. Je vous accompagnerai à Saint-Louis. Il vous interrogera et décidera de votre sort.
Quelque peu romancée bien sûr, cette évocation n'a rien pourtant, quant aux faits, d'imaginaire. Une chose alors paraît certaine : l'heure a sonné, pour Dinah Salifou, de la destitution et de l'exil.
Désapprouvant cet acte, M. de Lamothe, alors gouverneur du Sénégal, dira que ce fut un véritable « enlèvement ».
« Je ne demande qu'à retourner dans mon pays dans quelles conditions que ce soit. J'accepterai tout ce que le gouvernement français m'exigera dans mon pays, pourvu que j'y aille et jouisse de la tranquillité, c'est tout ce que je veux. »
Cette humble requête se trouve dans une lettre que Dinah Salifou écrivit, de Saint-Louis du Sénégal, à ce même M. de Lamothe. Elle est datée du 3 juillet 1892. Le gouverneur, à cette date, était en France et, Dinah espérait encore qu'une intervention personnelle de sa part auprès du ministre des Colonies pourrait lui être favorable. Il ne demande qu'à revenir dans son pays, sans aucune contestation, aucune revendication. Tout ce qu'il veut, c'est y jouir de la tranquillité...
Mais revenons quelques mois en arrière.
Traité avec égards dès son arrivée à Saint-Louis, et cela sur les ordres mêmes du gouverneur, réputé homme juste et fraternel, Dinah Salifou n'a pas été dans l'immédiat pleinement conscient, semble-t-il, de sa nouvelle situation. C'était un malentendu. Il y serait bientôt mis bon ordre.
Dinah demeure libre de ses mouvements. Il habite une assez pauvre case aux confins de la ville, à deux pas du fleuve. Il doit se contenter, pour toutes dépendances, d'une cour de dimension modeste et n'a, pour le servir, qu'une vieille paysanne. Tout cela contraste avec son ancienne opulence, mais il ne s'en attriste pas. Son temps est en grande partie consacré à la lecture du Coran et à celle des journaux que lui apporte assez régulièrement un domestique de M. de Lamothe. Souvent il se promène au bord de la mer. Le cimetière marin, dans les sables, avec ses filets de pêcheurs tendus entre les tombes, est son lieu de méditation favori. Mais il aime bien également flâner sur les berges du Sénégal. De temps à autre il parcourt les rues de la ville. Avec ses maisons blanches, ses mosquées aux coupoles bleues, vertes et dorées, ses vieilles maisons coloniales aux balcons ajourés, ses églises, celle-ci est belle tout le jour, mais plus encore aux premiers rayons du soleil ou sous le clair de lune. Elle lui paraît ressembler parfois aux cités étonnantes que les marchands diolas et les nomades Foulbés évoquaient dans leurs récits. Ces hommes fréquentaient les étrangers dans tous les ports de la côte. Du temps de Youra Towel, ils s'arrêtaient volontiers à Sokoboly, sûrs d'être toujours bien reçus. Ils remplaçaient les griots dans les veillées. Jeunes et vieux étaient suspendus à leurs lèvres quand ils répétaient les histoires merveilleuses qu'ils avaient apprises des négociants venus de Perse, d'Arabie et des Indes lointaines. Que de souvenirs !
Mais chaque fois qu'il songe ainsi aux siens et à son pays, Dinah retrouve l'angoisse un instant oubliée. Voici plus d'un mois qu'il se morfond dans sa solitude. Son arrivée remonte au début de décembre. Maintenant le mois touche à sa fin. M. le Gouverneur a-t-il oublié sa promesse ? Ne lui a-t-il pas dit qu'il le verrait bientôt ?
Ce matin encore ses pensées retournent auprès de ceux qu'il aime. Levé longtemps avant l'aube, il est allé jusqu'au fleuve. D'habitude le spectacle des pêcheurs dans leurs barques, des femmes qui jacassent en lavant leur linge ou des gosses qui nagent avec des cris de joie suffit à l'apaiser. Aujourd'hui son cœur est lourd tandis qu'il observe d'autres gamins, adolescents, qui luttent ensemble pour le plaisir de mesurer leur force et leur courage. Il pense à son fils Ibrahima, aussi vigoureux, brave et adroit qu'eux. Mais quand reverra-t-il son premier-né ?
C'est alors qu'il aperçoit sa vieille servante. Elle accourt aussi vite que le lui permettent ses vieilles jambes pour l'avertir qu'un envoyé du gouverneur l'attend dans sa case. Il rentre en hâte. C'est, enfin, une bonne nouvelle : on lui fait savoir que les siens sont en mer pour venir le rejoindre.
C'est arrivé ! Ils sont là. Le soleil qui a éclairé cette journée de bonheur a disparu depuis longtemps. Les épouses de Dinah, son fils Ibrahima et ses frères et sœurs plus jeunes dorment dans la case, bien exiguë pour abriter tant de monde. En tendant l'oreille il entend leurs respirations calmes. Assis dans la petite cour, il tient dans ses mains les lettres qu'Ibrahima lui a remises, écrites par quelques chefs amis. Il les connaît par cœur maintenant, les ayant lues et relues tout au long du jour. Elles sont révélatrices. C'est bien Opigez qui a tout manigancé contre lui et qui continue d'ailleurs à le dénigrer, à tout faire pour que son retour au pays devienne impossible. Et, pourtant, tous les chefs lui écrivent « pour lui dire leur respect, leur dévouement et lui exprimer leurs vœux et leurs souhaits de le voir revenir le plus tôt possible à la tête du pays des Nalous ».
La réalité, hélas ! se présente tout autrement. L'interprète du poste de Boké est venu récemment à Dakar et a rapporté des faits bien décourageants qui confirment ce que les chefs lui disent par ailleurs dans leurs lettres. M. Opigez, abusant de son autorité et misant sur la crainte qu'il inspire à de nombreux témoins, a soumis ceux-ci à de fréquents interrogatoires « dans des conditions de partialité extrême ». Aussi va-t-il répétant à qui veut l'entendre que le peuple nalou s'oppose au retour de Dinah Salifou — ce qui, comme le prouvent les lettres qu'il a reçues, est absolument à l'encontre de la vérité.
Submergé par l'infortune, Dinah fait preuve, même alors, d'une grande patience et d'une timidité qui seraient excessives si l'on ne comprenait combien il est abattu, désorienté. C'est dans cet état d'esprit qu'il écrit une nouvelle fois au gouverneur, le 7 mai 1891 :
« J'ai l'honneur de m'adresser à votre haute bienveillance pour vous prier de vouloir bien écouter avec indulgence ce que je vais vous dire.
Tout d'abord, mille pardons de ce que peut-être je vous importune avec mes lettres, mais j'espère que celle-ci sera sinon la dernière, mais du moins une des dernières.
Ceci dit, j'entre en matière.
Depuis quelque temps je remarque que M. le Commandant du poste de Boké agit à mon égard avec une certaine animosité. Chaque fois que dans ses occupations de commandant de poste, mon nom vient à être prononcé, il ne peut se défendre de lancer à mon adresse quelques mois très mal placés.
Et je prends à témoin de ce que j'avance M. Ibrahima Diav, l'interprète du poste de Boké ( ... ). »
Et Dinah signe : « De votre très humble serviteur. »
Opigez craignait-il, en raison de ces plaintes contre lui, une intervention de M. de Lamothe ? Toujours est-il qu'il ne désarme pas. Il sait bien qu'il ment lorsqu'il prétend que les chefs nalous sont montés contre Dinah. Il doit même redouter qu'ils réclament au contraire le retour de leur roi car, bientôt, il va jusqu'à solliciter la déportation de celui-ci dans les geôles du Gabon, c'est-à-dire le plus loin possible du territoire des Rivières du Sud. Il semble qu'il ait réussi à saisir le ministère des Colonies pour que Dinah soit soumis à cette mesure.
En effet, trois mois après la protestation de Dinah contre les agissements du commandant de cercle, M. de Lamothe reçoit, du sous-secrétariat d'Etat aux Colonies à Paris, une dépêche ordonnant qu'il soit procédé à la déportation de l'ex-roi. Au Gabon, ou même plus loin au Congo. Il y a déjà un an et demi que Dinah Salifou est assigné à résidence à Saint-Louis. Pourquoi ajouter à sa disgrâce cette peine qu'on n'inflige qu'aux insurgés ? C'est l'époque où, au Sénégal même, le chef religieux des Mourides, le cheikh Amadou Bamba, subira ce genre d'exil. Mais à aucun moment Dinah, pour sa part, ne s'est exposé à une telle rigueur. Au Rio Nunez il a toujours été un allié loyal et ici, à Saint-Louis, il n'a provoqué aucune agitation, son comportement est des plus réservés. On ne peut relever à son passif aucune intrigue, aucun complot.
Prenant sur lui de faire acte de justice mais aussi de courage, M. de Lamothe câble aussitôt en retour à Paris pour demander l'autorisation de surseoir à l'exécution de la mesure exigée. Il obtient gain de cause. Un mois plus tard, il explique au sous-secrétaire d'Etat, par sa lettre du 16 septembre, les motifs qui l'ont amené à prendre la défense de Dinah, « ancien roi des Nalous ».
L'intervention de ce haut fonctionnaire colonial (gouverneur du Sénégal et dépendances), dans de telles circonstances, ne manque pas de noblesse. On ne peut que le reconnaître si on lit attentivement certains passages de sa lettre. Sans doute M. de Lamothe ne peut-il, malheureusement, faire que Dinah Salifou retrouve ses prérogatives royales. Trop de calomnies ont été répandues contre lui et ont fait leur œuvre. Mais le gouverneur tient à mettre les choses au point et n'a garde de ménager le peu recommandable Opigez:
« Au mois de juin dernier, écrit-il, lorsque j'ai visité les Rivières du Sud, je me suis parfaitement rendu compte que le retour de Dinah Salifou dans son royaume n'est plus possible. Toutefois il est malheureusement certain que son impopularité venait surtout de la situation difficile dans laquelle il s'était trouvé placé du fait même de l'administration des Rivières du Sud, ou pour parler plus exactement d'un des fonctionnaires de cette administration. En vérité, la seule charge à relever contre Dinah Salifou, et je ne veux pas en diminuer ici l'importance, est son insuccès dans une guerre qu'il n'avait entreprise que sur l'ordre de M. l'Administrateur de Boké. »
Si par ailleurs M. de Lamothe reconnaît, à propos du meurtre de Tocba et de Bourang, que Dinah s'est « compromis maladroitement », il rappelle aussitôt que c'était « en exécution d'ordres donnés par un représentant de l'autorité française ». Et il souligne avec insistance : « J'en ai sous les yeux la preuve écrite. » Nul doute que Dinah lui ait remis, pour instruire son dossier, la trop fameuse lettre : « Je veux avoir ces deux têtes. » Comptabilisant tous les déboires de Dinah, le gouverneur se dit qu'il est l'image même de ce qu'il appelle « la fidélité malheureuse ». Au passage, pour couper court aux insinuations d'Opigez, il tient à rendre hommage à la loyauté de cet homme accablé par le sort :
«... Je ne crois pas que la présence de Dinah à Saint-Louis soit de nature à entretenir une agitation nuisible à la pacification du Rio Nunez. Je dois d'ailleurs reconnaître que la conduite de cet ancien roi, depuis qu'il est au Sénégal, a été complètement correcte et n'a donné lieu à aucune observation défavorable. »
Enfin M. de Lamothe, dont les qualités humaines paraissent indéniables, s'élève avec la plus grande fermeté contre les compromissions dont l'administrateur de Boké s'est rendu coupable. Compromissions « peu compatibles avec le prestige qu'il est nécessaire de conserver à la France ». Pour maintenir ce prestige, affirme-t-il, il faut faire preuve d'« une rectitude absolue de procédés ». Et l'honnête gouverneur conclut, en s'adressant à l'homme politique de Paris :
« Je n'oserais pas affirmer que les circonstances qui ont accompagné l'enlèvement et l'internement de Dinah correspondent entièrement à cet idéal. »
Avec beaucoup de ménagements M. de Lamothe a fait comprendre à Dinah qu'il ne pouvait plus être le roi des Nalous. A aucun moment en effet il n'accepte de le tromper. Il semble avoir cru, cependant, qu'il pourrait obtenir qu'il soit mis fin à son exil. Dinah, manifestement, s'est accroché à cet espoir. Certes il ne s'est pas trompé sur la qualité de l'homme qui a pris en main ses intérêts. Mais M. de Lamothe n'est pas tout-puissant. Durant des mois, néanmoins, l'exilé accumule toutes les pièces qui peuvent le disculper et les remet au gouverneur.
Au milieu de l'année suivante (1892), celui-ci faisant un séjour à Paris, Dinah Salifou lui écrit encore une fois ; toujours impatient et anxieux :
« Je viens par la présente vous rappeler de ma situation. Je pense que vous ne m'oubliez pas auprès du ministre pour mon affaire... »
Et puis, ces quelques mots, combien émouvants :
« Je sais bien, M. le Gouverneur, que vous ne m'oubliez pas, mais je tiens à vous écrire pour vous renouveler ma confiance et vous informer que je rêve que vous viendrez ici m'annonçant mon départ pour Sokoboly. »
C'est par cette même lettre (3 juillet 1892) que l'on apprend une partie des démarches faites par M. de Lamothe en faveur de Dinah :
« Je ne cesse de louer Dieu pour vous vous vous êtes donné tant de peines. Sans vous je serai loin du Sénégal.
Vous avez fait en sorte que je touche ma rente de 5 000 francs. Sans vous je mourrais de faim au Sénégal. Sans vous encore, j'étais au Congo, comme les rois qui ont porté les armes contre la France. »
Il est clair que Dinah est plein de reconnaissance pour celui qu'il appelle « un homme de bienfaits ». Nulle flatterie dans les compliments qu'il lui adresse.
L'accent en est parfaitement sincère et quand il dit :
« Je ne puis être que votre griot, chantant toujours vos louanges ».
C'est, venant d'un Nalou, le plus bel hommage qu'il puisse rendre à cet homme juste et bon.
Il n'est pas du tout certain que l'on ait apprécié en haut lieu les jugements très sévères sur les méthodes de colonisation portés par le haut fonctionnaire en exercice qu'était M. de Lamothe. En tout cas les impératifs de la politique coloniale empêcheront, à eux seuls, le gouverneur du Sénégal (et dépendances!) d'obtenir le retour de Dinah, un Nalou parmi d'autres, à Sokoboly. Pis encore, et bien qu'Opigez ne soit plus là (il est mort à Boké en juin 1892), les années suivantes verront s'aggraver le statut de l'ancien roi. Il semble que, du Rio Nunez, on se soit acharné sur lui. Des intérêts particuliers et la nécessité de satisfaire la cupidité de quelques-uns peuvent expliquer les nouvelles mesures prises.
Déjà l'exploitation des biens de Dinah échappe à ceux des siens qui sont demeurés au pays nalou, comme son frère Sayon. Tous les bénéfices qui lui en revenaient, en vertu du traité signé avec la France, sont de fait confisqués au profit de tiers. Mais cela ne suffit pas. Sa pension versée au Sénégal a été ramenée de 5 000 à 1200 francs. Ces traités qu'il a scrupuleusement observés sont devenus, pour, l'administration, de vulgaires « chiffons de papier ».
Quand il apprend la réduction de pension de Dinah, M. de Lamothe est indigné. Il la trouve totalement « imméritée ». Il prend note de ce que « la colonie de la Guinée française continue à recueillir les avantages matériels » du traité signé par Dinah Salifou et « dont jamais les clauses n'ont été violées par lui ». Par lui, souligne le gouverneur, qui formule « toutes réserves » sur une telle politique.
Et pourtant la décision sera maintenue.
Vivant chichement, ayant perdu tout espoir, Dinah Salifou n'en a plus pour longtemps. Il meurt, à Saint Louis du Sénégal, en novembre 1897.
Ainsi finit, bien tristement, l'histoire de Dinah Salifou — que prolonge, tout aussi triste, celle de son fils Ibrahima, dont on ne peut davantage taire l'injustice.
Garçon fier et intelligent, le petit-fils de la vieille Makoumba a pu, grâce à M. de Lamothe, commencer des études au lycée d'Alger. L'inlassable sollicitude du gouverneur avait veillé à compenser ainsi, faiblement il est vrai, la réduction de rente de son père par des sommes votées au Conseil général du Sénégal, et permettant au jeune homme de « terminer utilement ses études ». Remède précaire qui, de ce fait, n'atteindra guère son but.
Treize ans après la mort de son père, on retrouve Ibrahima à Paris. Il a 31 ans. Terriblement démuni, il s'efforce d'obtenir justice pour Dinah Salifou et pour lui-même. On lui offre une compensation tellement dérisoire qu'elle en est injurieuse. C'est que la fin de la grande époque coloniale n'est pas encore arrivée. Cependant un organisme, qui s'intitule dans le style d'alors « Comité de protection et de défense des Indigènes », s'efforce de limiter les dégâts qu'entraînent les conquêtes. Mélange de bonne foi et de bonne conscience, c'est à la demande de ce comité qu'est rédigé un rapport — dit rapport Delmont — qui conclut à la réhabilitation du roi des Nalous et à l'indemnisation des torts subis, en faveur de son fils. Le comité, dans sa séance du 18 janvier 1910, « après avoir entendu la lecture du rapport », décide « à l'unanimité » d'appuyer les revendications d'Ibrahima auprès du gouvernement français.
L'étude de M. Delmont, outre la relation très précise des faits, comporte une analyse détaillée des spoliations dont le fils de Dinah Salifou est la victime. Le bilan se chiffre par une somme de 799 000 francs, ce qui, à l'époque, est loin d'être négligeable. Bien que le rapporteur, dans sa conclusion, ne soit pas d'un optimisme excessif quant à la décision gouvernementale, il la rédige cependant avec la plus grande fermeté :
« En justice absolue, Ibrahima Dinah Salifou pourrait réclamer la restitution de tout le pays sur lequel il était appelé normalement à régner. Si la France ne croit pas devoir lui restituer son royaume parce que aujourd'hui les Rivières du Sud sont devenues une colonie française, il a le droit d'être indemnisé du préjudice matériel que lui a fait subir l'exil de son père.
Il y a lieu d'espérer que le sentiment de la justice et de l'équité déterminera le gouvernement à réparer pour partie, tardivement il est vrai, en ce qui concerne Ibrahima Dinah Salifou, les conséquences des mesures dont son père et lui ont été les innocentes victimes. »
On attendra longtemps une suite positive à cet appel sans équivoque. En vain. L'espoir fait vivre, dit-on. C'est vrai, souvent. Mais quand il est trop continûment déçu, il fait mourir parfois.
...Comme ce fut le cas pour Dinah Salifou, comme ce fut le cas pour son fils, Ibrahima.
Chronologie comparative
| Dates | Rivières du Sud, royaumes de Basse-Guinée | Afrique | Reste du monde |
| 1720 | Arrivée des Nalous dans le Rio Grande | ||
| 1725/1726 | Dispersion des Nalous venus du Foréah et du Fouta, entre Kassini et Kokandi, sous la conduite de Yotpez et Yani | Révolution théocratique au Fouta-Djallon | Introduction de la culture du café aux Antilles |
| 1754 | Formation de petits royaumes nalous sous le commandernent de descendants de Yotpez vers la côte et les îles, et de Yani autour de Kakandi-Boké | Naissance d'Othman Dan Fodio au Gobir (Nigeria) | Congrès d'Albany |
| 1794 | Tentative de regroupement de principautés rivales. Les cinq principales familles s'unissent en deux tendances | Naissance d'El-Hadj Omar au Fouta-Tooro | Abolition de l'esclavage dans les colonies françaises |
| 1804/1805 | Date probable de la naissance de Dinah Salifou | Création de l'empire de Sokoto | |
| 1825 | Avènement du frère cadet de Dinah Salifou | ||
| 1827 | Passage de René Caillé à Boké | ||
| 1830 | Renforcement de l'installation française à Boké | Prise d'Algerpar les Français | Révolution en France: changement de dynastie |
| 1857 | Traité entre les chefs nalous de Kassini et le lieutenant de vaisseau Vallon | Siège de Médine | Indes : révolte des Cipayes |
| 1860 | Tentative espagnole de traite négrière à Boké, contrecarrée par les Français. | ||
| 1865 | 25 novembre — Traité entre le gouverneur du Sénégal Pinet-Laprade et Youra Towel, roi des Nalous ; versement d'une rente et liberté du commerce | Etats-Unis: fin de la guerre de Sécession et assassinat de Lincoln | |
| 1866 | Douka, roi du Landoumantaye, refuse de payer l'impôt aux Almamys du Fouta-Djallon. Les Fulbés envahissent le Landoumantaye | Livingstone à Zanzibar — Samori à Bisandougou — Fondation de Dar Ef-Salam | Bataille de Sadowa |
| 1867 | Les rois Youra et Douka invités à Freetown par le gouverneur de Sierra Leone | ||
| 1870/1875 | Famines et guerres dans les Rivières du Sud | ||
| 1877 | Youra, âgé et malade, abdique en faveur de Dinah Salifou. Guerres civiles | Stanley à Boma (Congo) | Invention du phonographe |
| 1882 | Année de paix | Les Britanniques occupent l'Egypte après la bataille de Tell el Kebir | |
| 1884/1885 | Guerre civile. Les Français soutiennent Dinah Salifou. 31 août : investiture officielle de Dinah Salifou | L'Allemagne occupe le Sud-Ouest africain Chute de Khartoum, mort du Mahdi | Conférence internationale de Berlin |
| 1886 | Affrontements entre partisans et adversaires de Dinah Salifou | Siège de Sikasso par Samori | L'Inde annexe la Birmanie |
| 1887 | Fin de l'agitation et des troubles | Cecil Rhodes en Afrique australe | |
| 1889 | Dinah Salifou à Paris à l'occasion de l'Exposition universelle | ||
| 1890 | Le commandant de Boké contre Dinah Salifou | Protectorat britannique sur Zanzibar | |
| 1891 | Décision de déporter Dinah Salifou au Gabon ou en Guyane | ||
| 1895 | Décision d'une subvention pour l'éducation du fils de Dinah Salifou, Ibrahima, au lycée d'Alger | Fin de la guerre sino-japonaise | |
| 1897 | Mort de Dinah Salifou à SaintLouis du Sénégal dans la misère | Signature du quatrième protectorat français sur le Fouta-Djallon | Naissance du sionisme Premier vol en avion |
| 1909/1910 | Voyage à Paris du fils de Dinah Salifou pour tenter de rentrer dans ses droits et de réhabiliter la mémoire de son père | Prise de Ouagadougou par la France. Retour d'exil d'Alfa Yaya. Création de l'Union sud-africaine | Révolution des Jeunes-Turcs |
Contact :info@webguine.site
webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2013 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.